1- Base philosophique de la réflexion
Le point de départ de ma réflexion est la pensée d’Épicure :
- « aponie », absence de douleurs physiques (faim, froid, maladie, etc.)
- « ataraxie », absence de troubles (insécurité, angoisse, oppression, etc.)
- et autosuffisance.
Ce philosophe vivait avec une communauté d'amis (ouverte aux hommes libres, aux femmes –y compris prostituées- et aux esclaves) dans le Jardin (son école philosophique créée 306 avant Jésus-Christ) près d’Athènes, en Grèce.
Épicure y enseignait les moyens de parvenir au plaisir par la suppression des douleurs et des angoisses. Santé du corps et sérénité de l’esprit. Sa méthode consistait à identifier les besoins naturels et nécessaires et de tempérer ou rejeter les autres, sources de frustration et de violences.
Bien qu’Épicure recommande de « Vivre caché » et de ne pas s’impliquer dans la vie politique, ses successeurs, les philosophes épicuriens de l'époque romaine, se sont progressivement orientés vers un épicurisme politique : un bien-être étendu à la société.
2- Prolongements : de l’éthique à la politique
Plusieurs philosophes des Lumières (au XVIIIème siècle) ont été les héritiers naturels d’Epicure (matérialisme philosophique, athéisme …) et ont prolongé sa réflexion.
Plusieurs systèmes politiques ont été successivement (ou parallèlement) envisagés :
- la monarchie avec un « bon » roi éclairé par le philosophe (projet de Philodème de Gadara) ;
- la monarchie parlementaire avec un roi éclairé par une assemblée de citoyens instruits, éduqués par les philosophes (projet du baron d’Holbach) ;
- la république dirigée directement par un parlement ou mieux : une fédération de républiques provinciales / régionales (projet d’Helvétius) ;
- et la fédération de communes (projet de Jean Meslier).
Personnellement, pour éviter les abus de pouvoir, je suis favorable à un émiettement du pouvoir. J’écarte donc naturellement les deux premières options qui sont monarchiques ou oligarchiques. Restent les deux dernières qui ne diffèrent en réalité que par l’ordre de grandeur du découpage territorial.
3- Structure politique souhaitable
Pourquoi le « fédéralisme » plutôt qu’un Etat monolithique, uniforme, ou pire une Union d’Etats sous une autorité supranationale ?
Parce que l’administration centralisée est le meilleur moyen d’éloigner ceux qui prennent les décisions de ceux qui les subissent.
Trois exemples historiques de volonté d’uniformisation peuvent être énoncés :
- le jacobinisme en France au XVIIIème siècle ;
- la bureaucratie soviétique dirigée par une nomenklatura autoritaire ;
- et, de nos jours, la technocratie de l’Union Européenne, dirigée par des commissaires, qui impose ses normes et ses grandes orientations de politique économique à plus de 500 millions de personnes.
Ces trois exemples illustrent la doctrine qui tend à organiser le pouvoir de façon très administrative (bureaucratie) et très centralisée (centralisation) et à le faire exercer par une petite élite de techniciens (technocratie) qui étendent leur compétence à tous les échelons géographiques et à tous les domaines de la vie sociale afin de les rendre uniformes ; ce qui en fait l'adversaire absolu du « fédéralisme/régionalisme/communalisme ».
Personnellement, comme le philosophe Jean-Jacques Rousseau et contrairement à ce que pense par exemple l’encyclopédiste Denis Diderot, je crois que la volonté générale n'est pas universelle, elle est propre à un corps politique particulier, tout au plus à une région ou mieux encore à une commune, comme l’affirment respectivement Claude-Adrien Helvétius et Jean Meslier.
La « société épicurienne » pourrait donc être une constellation de microsociétés autonomes, si possible autosuffisantes, avec toutefois des liens culturels (éducation commune) et défensifs (sécurité vis-à-vis des agressions extérieures).
Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis emploie d’ailleurs le terme d'autonomie, dont il rappelle l'étymologie, "auto-nomos", qui renvoie à l'idée d'une création lucide et réflexive du nomos de la société (lois, normes, etc.). Il affirme en ce sens qu'« être autonome, pour un individu ou une collectivité, ne signifie pas « faire ce que l’on désire », ou ce qui nous plaît dans l’instant, mais « se donner ses propres lois. ».
Cette fédération de communautés s’appuierait ainsi sur l'institution d'une « démocratie radicale », c'est-à-dire à la fois d'une démocratie directe sur le plan politique, et d'une autogestion de la production sur le plan économique.
4- Quel découpage territorial/démographique retenir ?
La comparaison d’Etats contemporains (Suisse, Canada, Australie, France, etc.) a permis de révéler différents ordres de grandeur dans le découpage des « communautés / territoires » constituant la fédération :
- des territoires peuplés de quelques millions de personnes correspondraient à nos régions françaises actuelles (ou aux « provinces » pour reprendre la terminologie du Canada) ;
- des territoires peuplés de quelques centaines de milliers de personnes correspondraient à nos départements français actuels (ou aux « cantons » pour reprendre la terminologie de la Suisse) ;
- des territoires peuplés de quelques dizaines de milliers de personnes correspondraient à nos cantons français actuels ;
- et des territoires peuplés de quelques milliers de personnes correspondraient à nos communes françaises actuelles.
5- De la communauté à la commune
Historiquement, la commune française est l'héritière de la communauté ou de la paroisse de l'Ancien Régime. La communauté était une circonscription fiscale qui portait aussi le nom de paroisse fiscale (dans les villes à deux ou plusieurs clochers) ou de collecte. Son ressort pouvait correspondre, ou pas (Languedoc), à la paroisse ecclésiastique.
Au XXIe siècle, la commune correspond :
• soit à un espace rural, avec un chef-lieu (bourg ou simple village) et des écarts (tout lieu habité distinct du chef-lieu, c'est-à-dire les « hameaux » et les habitations dispersées)
• soit à une ville isolée
• soit à une partie d'agglomération multi-communale.
Sa superficie et sa population peuvent varier considérablement. Paris est la commune la plus peuplée avec 2 249 975 habitants (données 2011), tandis que la commune habitée la moins peuplée, Rochefourchat, a un seul habitant ; et que six communes déclarées « villages morts pour la France » n'ont aucun habitant.
Il existe actuellement (données 2017) 35 416 communes en France. Compte tenu du nombre d’habitants, 66 990 856 (données juin 2017), cela fait une moyenne de 1891 habitants par commune.
Cette échelle de la commune me semble la plus à même de répondre aux besoins particuliers des habitants. Les nombreux exemples de « villes en transition » (et autres initiatives) rapportés par le film documentaire Demain démontrent que ce fonctionnement est tout à fait possible.
Cette échelle de grandeur (quelques milliers d’habitants) correspond d’ailleurs à ce que le philosophe et utopiste socialiste Charles Fourier (1772-1837) préconisait pour ses phalanstères (« Un phalanstère est un ensemble de bâtiments à usage communautaire qui se forme par la libre association et par l'accord affectueux de leurs membres. Pour Charles Fourier, les phalanstères formeront le socle d'un nouvel État. »). Le nombre très précis de membres était selon lui 1620 personnes.
Pour le défunt président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez, le redécoupage de son pays en communes ou communautés, devait s’appuyer sur des groupes de 200 à 400 familles (soit approximativement entre 1000 et 2000 personnes). Nous le verrons plus bas dans le chapitre 7, les exemples contemporains de quartiers libertaires ou de communes en transition oscillent également entre 1000 (Christiania) et 8000 (Totnes) habitants.
Charles Fourier
Hugo Chavez
6- Exemples de cités, villages ou communautés passées ayant adopté la démocratie directe (cité autonome, confédération de nations …) et/ou l’autogestion (guildes d’artisans, navires pirates …)
Les premières expériences d’un régime politique démocratique ont lieu pendant l’Antiquité, dans la cité grecque d’Athènes. Le terme « démocratie » vient d’ailleurs du grec ancien « dêmos », qui signifie « peuple », et « kratos », qui réfère au pouvoir : la démocratie est donc, littéralement, le « pouvoir du peuple ». Il faut toutefois savoir que, pour les Athéniens, le peuple se limite aux citoyens, c’est-à-dire aux hommes libres, nés de pères athéniens. Le groupe des citoyens n’inclut donc pas les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves; environ 10 % de la population du territoire d’Athènes fait ainsi partie des citoyens.
Évidemment, la démocratie athénienne, fort différente de nos républiques modernes, ne s’est pas implantée du jour au lendemain. La mise en place d’un régime politique où l’ensemble des citoyens pouvait participer à la prise de décision était inédite dans le monde grec. C’est donc graduellement que les institutions démocratiques ont vu le jour à Athènes.
Au VIIIe siècle av. J.-C. est fondée la Cité-État d’Athènes, une cité autonome (pólis) qui englobe non seulement la ville d’Athènes, mais également les territoires avoisinants. Plutôt qu’être dirigée par un roi, Athènes est alors gouvernée par un petit groupe de puissants aristocrates : c’est ce qu’on appelle une oligarchie.
C’est au cours de cette période oligarchique, ponctuée de quelques épisodes de tyrannies et de crises sociales, que se mettent en place les fondements de la démocratie athénienne. Des réformateurs instaurent progressivement des mesures politiques et législatives qui favoriseront la participation des citoyens à la vie publique. D’abord, à la fin du VIIe siècle av. J.-C., Dracon rédige un code de lois qui constitue une première tentative d’instituer un droit écrit commun pour tous les citoyens.
Au début du VIe siècle av. J.-C., c’est au tour de Solon de mettre en œuvre des réformes judiciaires et politiques, notamment l’abolition de l’esclavage pour dettes et l’affranchissement de citoyens pauvres en état de dépendance envers les riches aristocrates. Enfin, un troisième réformateur, Clisthène, joue un rôle primordial à la fin du VIe siècle av. J.-C. pour remanier les institutions politiques d’Athènes et permettre la naissance de la démocratie. Clisthène répartit les citoyens en 10 tribus territoriales. De la sorte, tous les citoyens d’une portion de territoire, peu importe leur fortune ou leur naissance, font partie d’une même tribu. Cette réforme affaiblit la puissance de l’ancienne aristocratie et permet véritablement l’isonomie, c’est-à-dire l’égalité de tous les citoyens devant la loi, qu’ils soient riches ou pauvres.
Au début du Ve siècle av. J.-C., Athènes et les autres cités grecques entrent en guerre contre les Perses : ce sont les guerres médiques (490-479 av. J.-C.) au cours desquelles a lieu la bataille de Marathon. Le peuple joue un rôle important dans les victoires grecques et, après la guerre, il se fait entendre activement dans la vie publique athénienne. C’est après les guerres médiques, au milieu du Ve siècle av. J.-C., qu’a ainsi lieu l’âge d’or de la démocratie athénienne.
Source : http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-democratie/1434-origines-de-la-democratie-d-athenes-a-aujourd-hui
Francis Dupuis-Déri, dans son livre Démocratie, histoire politique d’un mot, aux États-Unis et en France (2013) souligne l’exemple formidable des communautés villageoises au Moyen Âge.
Extraits pages 40 et suivantes :
« Démocratie » et ses dérivés sont rarement utilisés avant le XIXe siècle. Jusqu’alors, il s’agit plutôt de termes savants qui font référence à l’Antiquité gréco-romaine. Pourtant, au Moyen Âge et pendant la Renaissance européenne, des milliers de villages disposaient d’une assemblée d’habitants où se prenaient en commun les décisions au sujet de la collectivité. Les « communautés d’habitants », qui disposaient même d’un statut juridique, ont fonctionné sur le mode de l’autogestion pendant des siècles. Les rois et les nobles se contentaient de gérer les affaires liées à la guerre ou à leurs domaines privés, d’administrer la justice et de mobiliser leurs sujets par des corvées. Les autorités monarchiques ou aristocratiques ne s’ingéraient pas dans les affaires de la communauté, qui se réunissait en assemblée pour délibérer au sujet d’enjeux politiques, communaux, financiers, judiciaires et paroissiaux. […]
La participation à l’assemblée était obligatoire et une amende était imposée aux absents quand l’enjeu était important. Un quorum de deux tiers devait alors être respecté pour que la décision collective soit valide, par exemple celle d’aliéner une partie des biens communs de la communauté (bois ou pâturage). Il était si important que la communauté s’exprime que même lorsque la peste a frappé dans la région de Nîmes, en 1649, l’assemblée a été convoquée dans la campagne sur les deux rives d’une rivière, pour permettre de réunir à la fois les personnes ayant fui la ville et celles qui y étaient restées. En général, le vote était rapide, à main levée, par acclamation ou selon le système de « ballote » distinguant les « pour » des « contre » par des boules noires et blanches. Lorsque la décision était importante, les noms des personnes présentes et ayant voté étaient portés au procès-verbal. […]
En plus des assemblées de la communauté, des assemblées fédérales réunissaient plusieurs communautés d’une même vallée, par exemple, pour traiter des affaires communes. […]
En plus de ces assemblées municipales, des assemblées au sein des guildes de marchands et d’artisans. […]
La démocratie médiévale, bien vivante alors, mais aujourd’hui si méconnue, permettait au peuple de traverser de longs mois sans contact direct avec des représentants de la monarchie, une institution qui offrait finalement très peu de services à sa population composée de sujets, et non de citoyens. […]
Les communautés d’habitants et les guildes de métiers perdent peu à peu de leur autonomie politique non pas en raison d’un dysfonctionnement de leurs pratiques démocratiques, qui se poursuivent d’ailleurs dans certains cas jusqu’au XVIIIe siècle, mais plutôt en raison de la montée en puissance de l’État, de plus en plus autoritaire et centralisateur. [Lire La fin des Corporations de Steven L. Kaplan.] Vers les XVIe et XVIIe siècles, les royaumes monarchiques se transforment peu à peu en États, soit un nouveau système politique qui développe plusieurs stratégies pour accroître son pouvoir d’imposition, de taxation et de conscription, alors que la guerre coûte de plus en plus cher, en raison des développements technologiques de la marine et de l’armement (arquebuses, canons). En effet, ces États modifient petit à petit les lois et règlements qui encadrent les villes et villages, pour maximiser leur capacité d’appropriation des revenus et des hommes. […]
L’assemblée d’habitants est alors un espace où s’organise la résistance face à cette montée en puissance de l’État. Par exemple, en protestation contre une conscription jugée illégitime, les assemblées choisissent un handicapé pour servir dans la milice. Lorsqu’on annonce de nouvelles taxes, les cloches convoquent l’assemblée et le démos se transforme parfois en foule émeutière, en plèbe : elle attaque les prisons pour libérer les prisonniers endettés, incendie la maison du « gabeleur », voire l’assassine. En guise de représailles, les troupes royales confisquent les cloches et les fondent. Finalement, les assemblées d’habitants sont tout simplement interdites et le roi nomme des préfets à la tête des communautés.
Source : http://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2015/04/innombrables-experiences-democratiques.html
Les immigrants européens venus en Amérique à l’époque coloniale cherchaient la liberté. Ils en ont trouvé l’exemple dans la confédération des Iroquois, comme chez d’autres nations indiennes du continent. Des rapports égalitaires régissent les relations entre membres d’une même tribu, car les Amérindiens éprouvent une aversion pour la subordination.
Le chef, nommé par tous les membres du clan ou de la tribu (tout dépendant de la structure sociale) est remplacé selon le bon vouloir de ces derniers. Il joue un rôle de porte-parole, ses fonctions sont symboliques et son pouvoir limité. De plus, il ne retire aucun privilège de sa fonction. Ces concepts se sont largement propagés au sein des anciennes colonies britanniques, comme le montrent les propos tenus par Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et John Adams à l’occasion de la Convention constitutionnelle de 1787. Dans tout l’est de l’Amérique du Nord, les nations indiennes avaient formé des confédérations avant l’arrivée des immigrants européens : les Séminoles dans ce qui est aujourd’hui la Floride, les Cherokees et les Choctaws dans les Carolines, et les Iroquois et leurs alliés les Hurons dans le nord de l’État de New York et dans la vallée du Saint-Laurent. […]
La Gayanashagowa, « grande loi qui lie » ou « grande loi de l’Unité » ou « grande loi de paix », est la constitution orale de la confédération des 6 nations Iroquoises. Elle a été édictée au XIIe siècle par le prophète Deganawida (le Grand Pacificateur), et son disciple Hiawatha, qui prêchaient la Grande Paix. Rédigée en 1720, elle est composée de 117 paragraphes. Elle a servi d’inspiration aux Pères Fondateurs des USA, pour sa déclaration d’indépendance et sa constitution, et pour certains fondements constitutionnels de l’ONU. On a même pu écrire que les Indiens iroquois « avaient surpassé le droit romain ». […]
Source : https://matricien.org/societes-gentilices/confederalisme-iroquois/
Pour le cas de la Nouvelle-France, notons l’exemple des Wendats (connus aussi sous le nom de Hurons), qui comptaient quatre niveaux de gouvernement, soient le clan, le village, la nation et la confédération. Le clan regroupait environ 250 personnes, soit une dizaine de familles. Chaque clan avait un chef civil et un ou plusieurs chefs de guerre, nommés souvent par un conseil de femmes. Ces chefs n’avaient pas de pouvoir coercitif leur permettant d’imposer leur volonté. […]
Selon un Français témoin des sociétés amérindiennes au tout début du XVIIIe siècle, le titre de « chef » « ne leur donne aucun pouvoir sur les guerriers ; ces sortes de gens ne connaissent point la subordination militaire non plus que civile. Cela est tellement vrai que si ce grand chef s’avisait de commander quelque chose au moindre homme de son parti, [ce dernier] est en droit de répondre nettement à cette figure de capitaine qu’il ait à faire lui-même ce qu’il ordonne aux autres ». […]
De telles communautés égalitaires et démocratiques attiraient inévitablement les Européens déserteurs de la marine ou de l’armée, les esclaves en fuite et des femmes fuyant un mari violent. Si bien que les autorités coloniales interdisaient les contacts entre les esclaves, par exemple, et les communautés amérindiennes. […]
Source : Francis Dupuis-Déri, Démocratie. Histoire politique d’un mot, aux États-Unis et en France
Marcus Rediker entretient la mémoire des luttes des marins et des pirates contre le capitalisme naissant (fin XVIIe, début XVIIIe), parmi lesquels Pirates de tous les pays (2004).
Extraits des pages 120 et suivantes :
« Chaque vaisseau fonctionne selon les termes d’un contrat court approuvé par l’équipage, établi au début du voyage ou à l’occasion de l’élection d’un nouveau capitaine. C’est en fonction de ces conventions écrites que les équipages confient l’autorité, distribuent le butin et la nourriture et font respecter la discipline”. Ces arrangements font du capitaine la créature de l’équipage. […]
Ayant besoin de quelqu’un qui ait à la fois un tempérament courageux et des compétences de navigateur, les hommes élisent leur chef. Ils veulent un commandement par l’exemple, pas un commandement dû à un statut et à une hiérarchie imposés de fait. Ils n’accordent que peu de privilèges. […]
L’équipage garantit au capitaine une autorité incontestée pour le combat et la chasse, mais « pour tous les autres aspects quels qu’ils soient », il est « gouverné par une majorité. » Un capitaine marchand scandalisé note : « Le capitaine semble n’avoir aucune méthode de commandement, mais quand il s’agit de partir en chasse ou d’engager un combat, alors il a le pouvoir absolu. » [Comme les chefs amérindiens qui n’ont de pouvoir qu’en temps de guerre.] De la même façon que la majorité élit, elle peut démettre. Certains sont démis de leurs fonctions pour couardise, cruauté ou pour avoir refusé de « capturer et de piller des vaisseaux anglais. » Un capitaine doit subir une colère inspirée de la conscience de classe de son équipage pour s’être comporté « comme un gentleman. » Occasionnellement, en cas de despotisme, il peut être sommairement exécuté.[…]
Souvenons-nous du commentaire de Walter Kennedy affirmant que la plupart des bandits des mers, « ayant auparavant souffert des mauvais traitements infligés par leurs officiers, se protègent soigneusement d’un tel mal ». La sélection démocratique des officiers apparaît ainsi en contraste total et significatif avec l’organisation quasi dictatoriale du commandement dans le service marchand et la Royal Navy.[…]
Afin d’éviter les abus d’autorité, les pirates élisent un officier appelé le quartier-maître, dont les pouvoirs contrebalancent ceux du capitaine. William Snelgrave explique qu’il « est chargé de l’inspection générale de toutes les affaires, il contrôle souvent les ordres du capitaine. Cette personne est aussi celle qui doit être la première lors de l’abordage de n’importe quel bateau ». Un autre prisonnier, le capitaine Richard Hawkins, qualifie le quartier-maître de « directeur en chef » du vaisseau pirate. […]
Le quartier-maître est donc le gardien de la tradition pirate, celui qui émet les jugements définitifs concernant la pratique culturelle. Comme un tribun dans la Rome antique, il protège le peuple contre les puissants, les plébéiens contre les patriciens. Dans le service marchand, le quartier-maître n’est pas considéré comme un officier mais simplement comme un marin « dégourdi », c’est-à-dire bien informé et expérimenté. Chez les pirates, il est élevé à une position suprêmement valorisée de confiance, d’autorité et de pouvoir. […]
Le rôle du quartier-maître consistant à maintenir l’autorité au sein d’un exécutif dualiste et représentatif est un principe propre à l’organisation sociale des pirates, et il influence la création de nouveaux bateaux. Le quartier-maître, tribun, médiateur, trésorier et partie prenante du maintien de la paix à bord d’un navire, devient souvent le capitaine d’un nouveau vaisseau lorsqu’un bâtiment est capturé puis converti. […]
Et pourtant, ni le capitaine ni le quartier-maître ne représentent l’autorité la plus élevée sur le bateau pirate. Cet honneur revient au conseil commun, qui réunit régulièrement tous les hommes, du capitaine jusqu’à l’homme du beaupré. Les décisions ayant le plus de conséquences sur le bien-être de l’équipage sont prises lors de réunions ouvertes où les débats sont houleux. En rendant l’équipage souverain, les pirates s’appuient sur une ancienne coutume maritime tombée dans l’oubli vers 1700, suivant laquelle le maître d’un navire marchand consultait tout son équipage (qui était souvent en partie propriétaire de la cargaison) pour la prise de décisions vitales. Les flibustiers connaissent également la tradition navale militaire – le conseil de guerre – au cours duquel les officiers supérieurs d’un navire ou d’une flotte se retrouvent afin de définir une stratégie. La réunion de la communauté flottante accréditait la réalité du vieux proverbe qui affirme : « Nous sommes tous ensemble sur ce bateau. » […]
Les décisions prises par le conseil sont sacro-saintes. Même le capitaine le plus courageux n’ose les affronter. Les conseils ont démis un certain nombre de capitaines et d’autres officiers de leur poste. Thomas Anstis perd sa fonction de capitaine : il est, selon l’expression des marins, « remis au pied du mât », c’est-à-dire qu’il redevient un marin ordinaire sur le bateau qu’il a auparavant commandé. Charles Vane, étiqueté comme couard par son équipage, est démis de ses fonctions de capitaine. Charles Martel perd son titre en raison de sa cruauté envers l’équipage et les prisonniers, un homme « plus juste » est nommé à sa place. Parce qu’une majorité de l’équipage de Bartholomew Roberts considère que le « vieux pirate » David Simpson est devenu vicieux depuis qu’il est quartier-maître, il est « viré par les hommes ».[…]
La démocratie à bord des navires peut paraître étouffante. Certains équipages font en permanence appel au conseil, « décidant toutes choses à la majorité des votes ». D’autres l’organisent comme un tribunal. « Ils aiment voter », déclare un capitaine capturé, « toutes les affaires des pirates sont traitées de cette façon ». En réalité, il y a « tellement peu de gouvernement et de subordination » parmi les pirates qu’« ils sont, selon l’occasion, tous capitaines, tous chefs ». Le capitaine de marine militaire Humphrey Orme, qui capture et interroge un gang de pirates en 1723, résume succinctement la situation : « Les plaisirs tirés d’une fonction sont très précaires à bord des bateaux pirates et reposent entièrement sur le bon vouloir et le bien-être de l’équipage. »[…]
La distribution du butin est explicitement régulée par la charte du navire. Les pirates font appel à un système de partage précapitaliste afin de répartir leurs prises. Le capitaine et le quartier-maître reçoivent entre une part et demie et deux parts ; les canonniers, maîtres d’équipage, seconds, charpentiers et docteurs reçoivent entre une part et un quart et une part et demie ; tous les autres ont droit à une part chacun”. Ce système de rémunération prend une distance radicale avec les pratiques de la marine marchande, de la Royal Navy et des corsaires. Il institue un système élaboré de niveaux hiérarchiques de revenus, qui réduit drastiquement les disparités entre le haut et le bas de l’échelle. En réalité, il s’agit probablement de l’un des programmes d’attribution des ressources les plus égalitaristes du XVIIIe siècle. Si comme le suggère Philip Gosse, éminent historien de la piraterie, « les meilleurs des marins sont les pirates », la distribution équitable du butin et la conception du partenariat peuvent être comprises comme l’œuvre d’hommes qui accordent de la valeur et du respect aux compétences de leurs camarades.[…]
En expropriant un navire marchand (après une mutinerie ou une capture), les pirates s’approprient les moyens de production maritimes et déclarent qu’ils sont la propriété commune de ceux qui travaillent à son bord. Ils abolissent la relation salariale qui se trouve au cœur du processus d’accumulation capitaliste.
Source : Makus Rediker, Pirates de tous les pays, éditions Libertalia, 2014
Remarque : Libertalia (ou Libertatia) est le nom d'une supposée colonie libertaire fondée par des pirates sur l'île de Madagascar, qui aurait existé pendant environ vingt-cinq ans à la fin du XVIIe siècle, sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'une réalité ou d'une légende. L'histoire de cette colonie apparaît pour la première fois dans Histoire générale des plus fameux pirates, du capitaine Charles Johnson (probablement un pseudonyme de Daniel Defoe).
L’anthropologue David Graeber et l’économiste Amartya Sen rappellent que la pratique de s’assembler pour délibérer au sujet des affaires communes a existé un peu partout, depuis fort longtemps, y compris en Europe au Moyen Âge et dans les siècles suivants, et dans les territoires que l’Europe a conquis et colonisés.
7- Exemples de communes ou communautés contemporaines ayant adopté la démocratie directe et/ou l’autogestion d’entreprises et/ou l’autosuffisance (alimentaire et/ou énergétique)
Christiania (Fristaden Christiania) est un quartier de Copenhague au Danemark, autoproclamé « ville libre de Christiania », fonctionnant comme une communauté intentionnelle autogérée, fondée en septembre 1971 sur le terrain de la caserne de Bådsmandsstræde par un groupe de squatters, de chômeurs et de hippies. Ce quartier est une rare expérience historique libertaire toujours en activité en Europe du Nord. C’est devenu un endroit libre où on ne paye pas de taxes et qui a ses propres règles. De nouveaux habitants ont rejoint la communauté et cette expérience sociale d'un mouvement de libre-penseur est devenue une partie permanente de la ville. En 2003, la cité comptait près de 1 000 habitants sur 34 hectares, possédait sa propre monnaie et toutes sortes d'activités culturelles et sportives, ainsi qu'un vaste espace agricole.
Sous l’impulsion de Juan Manuel Sánchez Gordillo, élu maire en 1979, à Marinaleda, ville d’Andalousie (Espagne), 2 778 habitants, toutes les décisions du village sont soumises à la démocratie directe, qui est la seule véritable démocratie. Autrement dit, pour être adoptées, chacune d’entre elles doit faire l’unanimité au sein de la population, qu’il s’agisse d’impôts, d’équipements, d’emploi, de salaires, … du coup, des centaines d’assemblées sont organisées chaque année. Le chômage est quasi-inexistant, la plupart des habitants travaillant pour la coopérative (de production et de conditionnement des olives et du blé). Les jeunes qui veulent construire une maison peuvent bénéficier gratuitement des matériaux, d’un architecte et des maçons qui vont avec. Le tout pour pas un rond, ou presque car ensuite le loyer est de 15€ par mois. Des terres, du travail, du logement, de la sécurité, une démocratie vivante : Marinaleda a tout pour endosser un rôle de modèle. : http://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2017/03/une-ville-en-democratie-directe.html
La commune de Saillans (Drôme), 1231 habitants, première dans son genre en France, a choisi lors des élections municipales de 2014 une liste «collégiale et participative» composée de candidats défendant un «modèle de démocratie directe». : http://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2017/07/saillans-lautogestion-au-milieu-du-gue.html
La commune d’Ungersheim (Haut-Rhin), 2094 habitants, en France, a non seulement décidé de fonctionner en « démocratie participative » sous l’impulsion de son maire Jean-Claude Mensch (« Débats, conférences, expositions, ici la parole et l’écoute sont liées, et chacun apporte ses idées. ») mais en plus en « indépendance énergétique » (la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace se trouve ici) et en « autosuffisance alimentaire » (« Une filière qui s’appelle “De la graine à l’assiette” a relevé le défi : grâce à 8 hectares d’exploitation maraîchère, elle emploie une trentaine de personnes, produit 300 paniers hebdomadaires et fournit tous les repas scolaires, déjeuners et goûters quotidiens, 100 % bio. Un jardin communal est également accessible à toute la population. »). Mais ce n’est pas tout ! Depuis le 13 juillet 2013, Ungersheim fait partie des rares communes françaises ayant lancé sa propre monnaie complémentaire. Avant de procéder à son impression (financée par un sponsor), un concours a été lancé auprès de la population pour baptiser cette monnaie et c'est le RADIS ou RADIG (en alsacien) qui a remporté la mise. Ungersheim est une ville en transition. : http://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2017/07/ce-village-francais-anticapitaliste-et.html
Dans le documentaire Demain (2015) plusieurs autres exemples sont fournis : https://www.youtube.com/watch?v=7wmWRXo_mLQ&t=226s
Il existe plus de 1200 « villes en transition » dans le monde, comme Totnes (au sud-ouest de l’Angleterre), avec Rob Hopkins fondateur du mouvement.
Rob Hopkins
Détroit (Etats-Unis) et ses fermes urbaines (comme « Keep growing Detroit ») et péri-urbaines (comme « D-Town Farm ») sont imités par des milliers d’autres.
Suivant l’exemple de Todmorden (Grande-Bretagne) et ses « Incroyables comestibles » (« Incredible Edible ») qui met la nourriture au cœur des rues, depuis 2013, le district de Calderdale a mis à disposition de ses 200.000 habitants tous les terrains vacants pour y cultiver de nourriture. Et ce sont plus de 800 groupes dans le monde qui ont imité les « Incroyables comestibles ».
Copenhague (Danemark) avec ses 570.000 habitants veut devenir la première capitale neutre en carbone d’ici 10 ans. Elle développe les espaces pour les piétons, les pistes cyclables et les transports en commun. Elle investit aussi dans l’isolation thermique des bâtiments et logements. « Les villes réussissent là où les nations échouent. Elles prennent la relève. » (Morten Kabell, maire de Copenhague)
Pour Reykjavik (Islande), un avenir sans carburant fossile est possible ; notamment grâce à l’hydroélectricité et à la géothermie.
A Sainte-Suzanne (île de la Réunion), les éoliennes et les panneaux photovoltaïques approvisionnent tous les habitants. L’entreprise Akuo Energy associe les panneaux photovoltaïques avec les serres pour l’agriculture locale.
Dans l’écoquartier BO-01 de Malmö (Suède) les 4000 habitants sont approvisionnés à 100% en énergies locales et renouvelables (soleil, vent et eau).
La ville de San-Francisco (Californie, Etats-Unis) recycle à 80% ses déchets et approvisionne les fermes environnantes en compost.
Bristol (Grande-Bretagne) possède une monnaie locale qui permet le développement économique local, une résilience face aux crises et un respect de l’écologie (par la réduction des transports).
A Kuthambakkam (près de Chennai, Tamil Nadu, Inde), les habitants appliquent le principe de l’auto-gouvernance (démocratie directe) avec l’objectif de créer la République des villages imaginée par le « Mahatma » Gandhi. 900 autres villages ont imité cette initiative mise en place par le ex-maire Elango Rangasawmy.
8- Extension du modèle politique au monde de l’entreprise
Le nombre d’entreprises en France est fourni par l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379705
« 3,14 millions d’entreprises marchandes non agricoles dont 243 grandes entreprises employant 30% des salariés, 5.000 entreprises de taille intermédiaire, 138.000 petites et moyennes entreprises (PME) et 3 millions de micro-entreprises. »
Auxquelles il faut ajouter « 450.000 exploitations agricoles » : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906726?sommaire=1906743
Soit un total de plus de 3,5 millions d’entreprises (mille fois plus que de communes).
Actuellement, le principe de base de fonctionnement de ces entreprises est le salariat (des écarts de salaire de 1 à 100 en moyenne dans les entreprises françaises) avec un rapport de force inévitable entre employeurs et employés, et même, dans les grandes entreprises (celles qui sont cotées en bourse, mais qui ne sont finalement que 243 en France) un rapport de force entre actionnaires (les propriétaires du capital) et travailleurs.
Pour désamorcer ces conflits incessants depuis plus de deux siècles, il suffirait d’abolir les statuts d’employeurs et d’employés, comme dans les coopératives agricoles, tout le monde devenant associé ; et surtout d’abolir la distinction entre actionnaires, avides de dividendes, et travailleurs, avides d’augmentations de salaires. Il suffirait que les travailleurs soient tous copropriétaires de leurs entreprises et que les « capitalistes financiers » soient obligés d’exercer un travail au sein des entreprises dont ils se réclament (sous peine d’en être exclus).
C’est d’ailleurs le principe général de la nouvelle organisation économique de l'Espagne anarchiste (dès 1936-37) :
- « socialisation de la terre par et pour les travailleurs » (socialisation et non étatisation comme en U.R.S.S)
- « collectivisation de la grande propriété terrienne, respect de la petite propriété » (preuve que la propriété privée n’est pas abolie ; on distingue simplement, selon les termes de Bernard Friot : « propriété d’usage » et « propriété lucrative » ; cette dernière devenant interdite)
- « collectivisation de la grande industrie, des services publics et des transports »
- « réquisition et collectivisation de toutes les entreprises abandonnées par leurs propriétaires »
- « collectivisation des grandes entreprises distributives »
- « contrôle ouvrier des banques jusqu’à la nationalisation complète du système bancaire »
- « contrôle ouvrier sur toutes les entreprises qui constituent l’artisanat et la petite industrie »
- « résorption intégrale, dans l’agriculture et l’industrie de tous les chômeurs ».
Ou alors, au minimum, il faudrait que ces capitalistes deviennent de vrais investisseurs qui apportent leur contribution financière (en achetant une part de l’entreprise) mais sans toucher de dividendes. Les bénéfices seraient ventilés entre salaires et investissements pour que l’entreprise s’améliore et prenne de la valeur (ce qui permettrait donc aux actionnaires de gagner sur du long terme). C’est le cas dans l’entreprise Pocheco près de Lille où (entre autres) les salaires vont de 1 à 4 alors que la moyenne est de 1 à 100 dans les entreprises françaises.
Selon sa taille, l’entreprise pourrait donc être une propriété privée (micro-entreprise avec un seul propriétaire) ou une propriété collective (pouvant compter plusieurs milliers de copropriétaires qui seraient autant de travailleurs au sein de cette grande entreprise). Les décisions y seraient prises en démocratie (autogestion), comme au sein des communes. Cela n’exclurait bien entendu pas les domaines de compétences (la comptabilité aux comptables, la technique aux techniciens, etc.) mais certaines décisions (salaires, etc.) seraient décidées par l’ensemble des membres.
Concernant la clé de voute de l’économie actuelle, le domaine bancaire, les anarchistes espagnols préconisaient le « contrôle ouvrier des banques jusqu’à la nationalisation complète du système bancaire ». « Le projet libertaire dans l’Espagne de 1936-1939 esquissa même la possibilité d’une société sans argent » … mais je corrige « sans argent émis par l’État ou les banques privées » et non « sans argent tout court » parce que le papier monnaie avait en réalité été remplacé par des coupons donnés aux travailleurs par les coopératives. Il s'agissait bien d'une nouvelle monnaie qui s'adossait non sur une réserve d'or ou d'argent mais sur la valeur du travail horaire.
Actuellement, il existe deux types de banques privées (malheureusement souvent imbriqués) :
- les banques de dépôt
- et les banques d'affaires.
Les banques de dépôt reçoivent l'épargne des particuliers et/ou des entreprises (compte d'épargne, compte courant) et peuvent ensuite le prêter à d'autres particuliers et/ou d’autres entreprises en réalisant un bénéfice : des intérêts (ce qui était jadis considéré comme de l'usure et interdit par la religion chrétienne catholique ; mais permis par la religion juive).
Au sens strict, une banque d'affaires n'est ni une banque de dépôt, ni un établissement de crédit, mais une société de conseil stratégique et financier qui travaille exclusivement pour des entreprises pour des activités de « corporate finance ». Ses seules ressources sont les honoraires qu'elle facture aux clients pour ses conseils juridiques et financiers pour le montage de ces opérations. Elle n'a généralement donc pas de conflit d'intérêt avec des activités de crédit ou de financement dont elle est indépendante lorsqu'il s'agit d'une banque d'affaires indépendante mais peut l'être si elle est intégrée à une banque généraliste ayant également un département spécialisé. Selon certaines interprétations anciennes, les banques d'affaires sont des banques de capitaux au long terme, spécialisées dans le financement d'entreprises. De fait, en France, la réforme de 1945 entérinait la spécialisation des banques. Ainsi, les banques d'affaires ne pouvaient plus posséder de capitaux au court terme. Elles prenaient et géraient des participations dans des entreprises existantes ou en création et accordaient des crédits à long terme sur la base de leurs fonds propres ou d'autres ressources à long terme. Elles étaient soumises à la même réglementation que les banques de détail ou banques de dépôt (court terme). Par abus de langage, banque d'affaires prend aujourd’hui la même signification que banque d'investissement, étant donné que les banques commerciales classiques sont elles-aussi en mesure de proposer les services offerts par une banque d'affaires. À ce jour, les établissements de crédit ont un agrément (CECEI), en général universel, qui a donc fait disparaître la distinction de court et moyen terme. Les prestataires de services d'investissement recouvrent en pratique les anciens statuts d'« agent de change », de commissionnaires agréés (marchandises) ou de « maisons de titres » et n'interviennent pas sur leurs fonds propres. Une banque d'affaires est généralement chargée de négocier des fusions acquisitions (sociétés non cotées ou offre publique d’achat (OPA), ou offre publique d’échange (OPE), des augmentations de capital (non coté ou introduction en bourse), des émissions d'obligations « corporate »). L'appellation ancienne, dont Lazard Frères était la meilleure illustration française, a donc repris tout son sens. On distingue les grandes banques d'affaires internationales Rothschild ou JP Morgan des plus petites banques d'affaires internationales indépendantes que l'on appelle des « boutiques » comme Conquest Advisory LLP ou Oddo et Cie.
Si les banques sont nationalisées à la façon marxiste, ou de préférence collectivisées à la façon anarchiste (employés et déposants devenant copropriétaires), elles deviennent des sortes de mutuelles. L'application d'un taux d'intérêt éventuel vient couvrir deux besoins : les salaires des travailleurs au sein de la banque et une sorte d'assurance pour éponger les pertes éventuelles (pour les prêts non remboursés).
En Suisse, il faut signaler l’existence de la banque Wir (à Bâle) qui émet une monnaie (le wir) destinée exclusivement aux PME. Les avoirs (fonds déposés sur un compte) sont sans intérêts) et les prêts sont proposés à des taux très bas.
Sur le fonctionnement économique, les échanges entre les différents agents économiques, de la société anarchiste espagnole des années 1936-1939, je retiendrai :
« La rétribution du travail se fait par coupons. Tous les membres de la commune se trouvent dans les mêmes conditions et il n’y a aucun privilège. La distribution se fait par les coopératives, créées depuis la révolution. Tout membre de la collectivité prend d’après ses besoins et paye en coupons. Le commerce particulier n’existe plus. »
La monnaie n'a donc pas disparu. Celle basée sur l'argent ou sur l'or, oui, peut-être, mais elle a été remplacée par une autre monnaie (locale, entrepreneuriale) : les coupons basés sur le travail, la rétribution du travail. Par contre, pour les échanges intercommunaux et surtout internationaux, il faudra conserver une monnaie nationale indexée sur l’or.
« Dans les villages où il y a, à côté de la collectivité, des petits paysans, la coopérative reçoit tous leurs produits, les leur paye en coupons et leur assure le nécessaire. L’échange entre les communes se fait directement de collectivité à collectivité ou par l’intermédiaire des fédérations inter locales, toujours en nature. »
C’est bien ce que j’annonçais plus haut : la propriété privée existait encore, à toute petite échelle. Et dès qu'un outil de production demande plusieurs personnes, la gestion et la propriété sont collectives.
« Les petits paysans ont le droit de cultiver la terre qu’ils possédaient avant, mais sans exploiter le travail d’autrui. Dans les villages entièrement collectivisés, il était courant que les papiers administratifs alimentent un grand feu de joie sur la place, de sorte qu’il ne reste aucune trace écrite des anciens droits de propriété. »
C'est la relation employeur-employé qui est totalement transformée. Désormais, il s'agit d'associés dans les collectivités, les fermes collectives ou les usines collectives.
La grille des salaires sera négociée dans chaque entreprise autogérée mais on peut déjà anticiper que les écarts de salaire (entre associés, entre coopérateurs) seraient bien plus réduits qu’aujourd’hui. A titre d’exemple, on peut citer :
- le « revenu universel » de Bernard Friot qui s’échelonne de 1 à 4 (1500€ à 6000€) selon le niveau de formation
- ou la répartition des butins à la façon des pirates libertaires des XVIIème et XVIIIème siècles qui s’échelonnait de 1 à 2 (« Le capitaine et le quartier-maître reçoivent entre une part et demie et deux parts ; les canonniers, maîtres d’équipage, seconds, charpentiers et docteurs reçoivent entre une part et un quart et une part et demie ; tous les autres ont droit à une part chacun »).
Bernard Friot
Au niveau national, on peut envisager une « assemblée des 3,5 millions d’entreprises » composée de tirés au sort parmi les membres de la population active. Cette assemblée s’occuperait de coordonner les décisions économiques locales. Elle ferait écho à « l’assemblée des 35000 communes » composée de tirés au sort parmi toutes les catégories d’âge (y compris les enfants, les adolescents et les personnes trop âgées pour travailler).
Depuis douze ans, il existe aux Etats-Unis un réseau équivalent, nommé « mouvement Balle », qui regroupe 80 réseaux locaux composés de 35000 entrepreneurs. Ils croient à la communauté contre la mondialisation et le chacun pour soi. « Our vision is to create within a generation a global network of interconnected economies that work in harmony with nature to support a healthy, prosperous and joyful life for all people » (Notre objectif est de créer, en une génération, un réseau mondial d’économies interconnectées qui travaillent en harmonie avec la nature pour apporter une vie saine, prospère et heureuse à tous les gens). Michelle Long, directrice de Balle, explique que « les entreprises qui grossissent et se mondialisent sont très fortes pour créer des $ mais très peu de gens en voient la couleur. Pour créer plus d’emplois, plus de richesses, pour plus de gens, il faut accroître la densité et la diversité des entreprises locales. ». D’ailleurs, Mickael Schuman, économiste et co-fondateur de Balle, précise que la pire méthode pour soutenir l’économie et créer de l’emploi, sous prétexte de développement, est de payer très cher pour attirer ou retenir les multinationales. Chaque $ dépensé dans une entreprise locale et indépendante va générer 2 à 4 fois plus d’emplois (et donc d’impôts locaux, et donc de subventions caritatives …) qu’une multinationale.
9- De l’expérience locale (communale) à un système général (national/étatique) pérenne
Bien que l’échelle de la commune autonome (au sens étymologique : « qui produit ses propres règles ») soit la plus à même de correspondre aux désirs de ses habitants, il faut s’assurer que la « fédération » pourra fonctionner sur la durée et surtout résister aux agressions extérieures ; car il ne faut pas oublier que l’Histoire est entachée de nombreux massacres sanglants pour empêcher le peuple de décider par lui-même.
Certaines fonctions relèvent d’une échelle bien supérieure à la commune (ne serait-ce que le réseau routier entre les communes, le réseau de télécommunication, etc.). Il faut les organiser, les coordonner, à un niveau qui regroupe l’ensemble des communes, l’ensemble du territoire, bref, qui relève de l’Etat.
Le système que je préconise n’est donc pas de l’anarchisme « pur », sans Etat, mais un Etat décentralisé au maximum et qui ne conserve que quelques prérogatives.
Pour identifier ces prérogatives étatiques, j’ai appliqué, au niveau de l’ensemble de la population, le même raisonnement qu’Épicure au niveau individuel : quels sont les besoins naturels et nécessaires d’un peuple pris dans son ensemble ?
Le « tronc commun » (sous-entendant un Etat minimaliste, « minarchiste ») qui m’est apparu spontanément comprend :
- la défense,
- la sécurité intérieure,
- la justice,
- et l’éducation
J’ajoute qu’un Etat minimaliste devra adopter une « éthique minimale » selon la définition de Ruwen Ogien (1949-2017). Ce philosophe libertaire français a essayé de réduire les différents principes de l’éthique minimale à un seul : « Ne pas nuire aux autres, rien de plus » en suivant le raisonnement suivant :
1- Nous n’avons aucun devoir moral à l’égard de nous-mêmes. Nous avons seulement des devoirs moraux à l’égard des autres.
2- Les devoirs moraux à l’égard des autres peuvent être ou bien positifs (aider, faire le bien) ou bien négatifs (ne pas nuire, ne pas faire le mal).
3- L’option positive s’exprime dans un ensemble de principes d’assistance, de charité, de bienfaisance qui risque d’aboutir au paternalisme, cette attitude qui consiste à vouloir faire le bien des autres sans tenir compte de leur opinion.
4- Pour éviter le paternalisme, il vaut mieux s’en tenir au seul principe négatif de ne pas nuire aux autres.
Ruwen Ogien
Finalement, ce que Ruwen Ogien appelle « éthique minimale », c’est une éthique qui exclut les devoirs moraux envers soi-même et les devoirs positifs paternalistes à l’égard des autres. Elle tend à se réduire au seul principe de ne pas nuire aux autres.
Rapportée à la politique, cette éthique peut s’interpréter ainsi : les personnes concernées doivent décider elles-mêmes ce qui est mieux pour elles ; sans se soumettre à un dictateur, un élu ou un « expert ».
Le « bien commun » sera celui de la communauté de proximité, de la commune ; à la seule contrainte de ne pas nuire aux autres.
La force militaire destinée à la sécurité extérieure devra être exclusivement de Défense. L’Etat, ou « confédération des communes », devra adopter une politique internationale de neutralité (comme certains pays scandinaves de nos jours ou encore comme la Suisse – Confédération helvétique). D’ailleurs, en Suisse, pour que l'armée ne se retourne pas contre la population, c’est une armée de métier minimum qui a été adoptée. Chez les Helvètes, 5% seulement des effectifs, du personnel militaire, sont des professionnels. Les autres sont des citoyens qui ont leur matériel (arme y comprise) chez eux.
La sécurité intérieure devrait elle aussi être assurée par des citoyens, en roulement ; une sorte de milice sans connotation péjorative.
La justice devra être la plus homogène et démocratique possible sur tout le territoire ; en combinant la compétence des magistrats professionnels avec des jurés tirés au sort, comme dans les cours d’assisses.
Pour un fonctionnement optimal, la justice de la « confédération des communes » devrait posséder un magistrat par commune, en moyenne, soit un peu plus de 35000 magistrats ou encore : un magistrat pour 1900 habitants.
Actuellement, le nombre exact de magistrats en France est souvent contesté. L’obligation d’établir des listes électorales pour les élections professionnelles (à la commission d’avancement et pour l’élection du nouveau Conseil supérieur de la magistrature) permet néanmoins de donner un chiffre précis.
En France, la justice est assurée par à peine 8355 magistrats (données 2010) dont 2586, soit presque un magistrat sur trois (30,95%) en région parisienne. Cela signifie qu’il existe un magistrat pour 7900 habitants.
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) a comparé les systèmes judiciaires des 47 pays du Conseil de l’Europe (Le Monde du 26 octobre 2010). La France a peu de juges (9,1 pour 100 000 habitants), contre 19,9, en Autriche, ou 24,5 en Allemagne, très peu de procureurs (3 pour 100 000 habitants) contre 15,4 en Norvège ; peu de personnel ou d’avocats, avec, en revanche, une nette surreprésentation du nombre de notaires.
En s’élevant au niveau de l’Allemagne, pour la proportion de juges, et au niveau de la Norvège, pour la proportion de procureurs, on approcherait le niveau optimal envisagé : 40 magistrats pour 100.000 habitants (soit un magistrat pour 2500 habitants). Les juges français – signe du poids d’une profession dans la société – ne sont pas, pour l’Europe, bien payés. En revanche, ils ne sont guère sanctionnés et l’efficacité du système judiciaire, si elle est moins catastrophique qu’en Italie, est discutable.
En outre, on ne peut pas dire que la Justice soit indépendante en France puisqu’une partie des magistrats (les procureurs) sont nommés par l'exécutif ; et que le (la) Garde des Sceaux lui (elle)-même fait partie du gouvernement (l’exécutif).
L’éducation nationale (le terme d’ « instruction » étant d’ailleurs plus approprié) à fournir aux jeunes citoyens a été décrit dans l’article précédent « Après Epicure (3) - De l’éducation idéale à une ébauche de société épicurienne » (pages 38 à 43).
A l’instar de la décentralisation politique décrite pour la « confédération de communes » envisagée, il faudrait une décentralisation de l’Education nationale, comme en Finlande où la bureaucratie a été réduite au strict minimum et l’accent mis sur la formation des professeurs.
Marie-France Garaud
Marie-France Garaud, fondatrice en 1982 de l'Institut international de géopolitique (IIG), qu'elle préside encore aujourd'hui, considère pour sa part que les quatre droits régaliens d’un Etat sont :
- battre la monnaie
- faire les lois
- rendre la justice
- et décider de la guerre ou de la paix.
Ce qui me permet d’ajouter à la liste :
- la création monétaire étatique pour les échanges extérieurs (internationaux) et intérieurs (intercommunaux) ; ce qui n’exclut pas la possibilité de monnaies locales, communales.
Pierre-Joseph Proudhon
En 1848, dans Solution du problème social, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) élabore la théorie du crédit à taux zéro qui anticipe le fonctionnement des mutuelles d’aujourd'hui. Il imagine la création d’une banque d’échange ou « banque du peuple », dont le but est l’abolition de la monnaie, du salariat, la suppression de toute prise d’intérêt et de toute réalisation de profit dans le cadre des structures d’échange entre les individus.
Marie-France Garaud confirme aussi le rôle de l’Etat pour :
- la défense (« choix de la guerre ou de la paix »)
- et la justice.
Quant aux lois, certaines pourront être décidées au niveau national, d’autres au niveau communal.
Ne faudrait-il pas y ajouter une forme de « sécurité sociale » (pour les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées, les sans-emploi …) ?
Cela correspondrait à la deuxième des « trois lois fondamentales et sacrées qui couperaient racine aux vices et à tous les maux d’une société » d’Etienne- Gabriel Morelly (1717-1782) :
- abolition de la propriété privée
- système étatique organisant l’éducation, l’assistance et la solidarité
- système de coopération non sans rappeler l’aphorisme de Saint-Simon, « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses œuvres ».
Pour répondre de façon plus détaillée à mon interrogation sur la « sécurité sociale », je cite une nouvelle fois Jean Meslier (1664-1729): "L'état de civilisation doit permettre, par la loi, de réaliser la justice; pour avoir chaque jour de quoi :
- se nourrir (sainement et suffisamment tous les jours)
- se vêtir (dignement),
- se loger (vivre et dormir dans une maison propre et chauffée)
- la possibilité d'être soigné en cas de maladie
- assurer correctement l'éducation des enfants,
- mais aussi pour jouir de la liberté naturelle,
- puis travailler en vue de l'utilité publique et du bien commun."
Jean Meslier
Cela implique :
- une autosuffisance alimentaire, si ce n’est de la commune alors du pays ;
- un plan coordonné nationalement pour que chaque ménage possède son logement (selon le principe de la «propriété d’usage » définie par Bernard Friot) ;
- avec une autosuffisance énergétique, si ce n’est de la commune alors du pays (pour avoir des logements chauffés, éclairés, etc.)
- et système de santé pour tous ; la volonté politique devant primer sur les contraintes financières.
Même réduit au strict minimum par une limitation de ses prérogatives et une décentralisation maximum, l’Etat aura tout de même un coût de fonctionnement. Il faudra des impôts (et des fonctionnaires de l’administration fiscale) pour le financer.
Les anarchistes espagnols des années 1930 avaient décrété : « Suppression de tous les impôts indirects. ». C’est bien la preuve qu'ils n'allaient pas renoncer à une certaine administration (fiscale) et à certaines prérogatives d'un pouvoir exécutif (plus ou moins décentralisé).
Ils n'auraient donc gardé que les impôts directs (sur les salaires et les bénéfices des entreprises), qui pèsent sur les producteurs de richesse (population active), renonçant à la TVA (« taxe sur la valeur ajoutée ») qui impacte les consommateurs et qui, pourtant, rapporte quasiment la moitié de ce que l’État français perçoit de nos jours (51% en 2015, 48% en 2016).
Si l'on supprime les impôts indirects (qui sollicitent l'intermédiaire des commerçants), il faudra renforcer les impôts directs. Peut-être en s'inspirant paradoxalement de ce qui se pratiquait sous l'Ancien Régime (taille, dîme et corvée) ... mais sans les exemptions et autres privilèges qui permettaient aux plus riches (seigneurs, religieux puis grands bourgeois) d'échapper à leur contribution. Voir : http://revolution.1789.free.fr/les_impots.htm et https://fr.vikidia.org/wiki/Corv%C3%A9e_(imp%C3%B4t)
Une autre option consisterait à conserver les impôts indirects et à les pondérer selon des critères s’appuyant sur la classification des besoins d’Epicure :
- biens et services « naturels et nécessaires »
- biens et services « naturels et non nécessaires »
- biens et services « non naturels ».
On pourrait aussi s’inspirer d’une autre taxe sur les produits qui est utilisée, entre autres, sur l’île de la Réunion : « l’octroi de mer ». Ce sont les produits importés qui viennent concurrencer des produits locaux qui sont taxés. Ceux dont l’équivalent n’existe pas localement ne sont pas impactés par cet « octroi ». Cela favoriserait la production locale (favorable à l’emploi) et réduirait les transports (coûteux en carburant et polluants).
Selon Claude-Adrien Helvétius, l’Etat doit taxer les citoyens dans l'unique perspective « des dépenses publiques nécessaires à la réalisation de la félicité nationale. Toute levée de taxes injustifiée par une ligne budgétaire indexée sur le bien public s'apparente au vol. » Helvétius défend l'accès à la propriété terrienne pour tous. « Pas d'excès de travail; la production de richesses dans la seule perspective que chacun puisse :
- pourvoir aux nécessités de la vie quotidienne
- et s'acquitter des taxes utiles à l'Etat pour assurer la sûreté et la protection du territoire national, la défense de la justice - les soldats, les magistrats, les policiers. » (Michel Onfray)
10- Comment y parvenir ?
En 2007, Gaetano Manfredonia a proposé une relecture des courants historiques de l’anarchisme sur la base de trois modèles.
- Le premier, « insurrectionnel », englobe autant les mouvements organisés que les individualistes qui veulent détruire le système autoritaire avant de construire, qu’ils soient bakouniniens, stirneriens ou partisans de la propagande par le fait.
- Le second, « syndicaliste », vise à faire du syndicat et de la classe ouvrière, les principaux artisans tant du renversement de la société actuelle, que les créateurs de la société future. Son expression la plus aboutie est sans doute la Confédération nationale du travail pendant la révolution sociale espagnole de 1936. Noam Chomsky et David Graeber se réclament de cet « anarcho-syndicalisme ».
- Le troisième est « éducationniste réalisateur » dans le sens où les anarchistes privilégient la préparation de tout changement radical par une éducation libertaire, une culture formatrice, des essais de vie communautaires, la pratique de l'autogestion et de l'égalité des sexes, etc. Ce modèle est proche du gradualisme d'Errico Malatesta et renoue avec « l’évolutionnisme » d'Élisée Reclus.
Personnellement, j’exclus d’emblée le modèle « insurrectionnel » parce que les insurgés violents vont posséder un pouvoir coercitif sur le reste de la population dont ils risquent d’user et abuser ; parfois jusqu’à l’établissement d’une dictature aussi autoritaire que le pouvoir que ces mêmes révolutionnaires ont voulu balayer. Il reste les réformes non violentes qui prennent généralement beaucoup de temps ; mais qui peuvent tout de même être réalisées graduellement.
A titre d'exemple, pour sortir de l'Ancien régime (monarchique, féodal), il a fallu :
- la mise au point de l'imprimerie de Gutenberg (1452) - puis les révolutions britannique (1689, monarchie constitutionnelle)
- et française (1789, monarchie constitutionnelle puis république bourgeoise) malgré la résistance des monarchistes et des fascistes sous forme de dictatures militaires (jusqu'aux années 1870 en France mais jusqu'aux années 1970, en Espagne, avec Franco en l'occurrence). Soit au moins 400 ou 500 ans !
La mise au point d’Internet (le réseau informatique mondial accessible au public), dès le début des années 1960, et plus particulièrement du World Wide Web (WWW), au début des années 1990, marque une révolution digne de l’imprimerie. Les individus peuvent communiquer ; reste à construire le monde de demain …
Au cœur du projet anarchiste, on trouve l'éducation populaire, la libération des esprits. L'éducateur type est Francisco Ferrer, le fondateur de l’École moderne, qui fut condamné à mort et exécuté en 1909, accusé d'avoir mené le mouvement s'opposant à la guerre contre le Maroc. Mais l'éducation fut aussi une préoccupation d'hommes de terrain, d'hommes de conflits armés. La grande ambition de Buenaventura Durruti et Francisco Ascaso (qui se sont surtout fait remarquer par leurs actions militaires pendant la révolution espagnole) était de créer dans toutes les grandes villes du monde, des librairies libertaires.
Francisco Ferrer
Ascaso et Durruti
Ce n'est pas parce que les individus ne seraient pas d'emblée autonomes qu'il faudrait, selon Cornelius Castoriadis, renoncer ou patienter pour ce qui concerne l'institution d'une société autonome, car, de la même manière qu'une société hétéronome engendre des individus hétéronomes qui à leur tour reproduisent l'hétéronomie sociale, une société tendant vers l'autonomie tendra à engendrer des individus autonomes, qui en retour pourront (et voudront) travailler à l'institution d'une société autonome. Il accorde ainsi une grande importance à diverses pratiques et modalités du pouvoir d'alors, tels la rotation des mandats, les tirages au sort, la révocation des élus, la possible participation de tout citoyen à certaines assemblées, etc.
11- Exemples passés et présents de sociétés à l’échelle d’une région ou d’un pays
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_communaut%C3%A9s_anarchistes
L’État libre islandais (Þjóðveldisöld en islandais) désigne l’État qui a existé en Islande de l’établissement de l’Althing (Alþing en islandais) en 930 au serment de vasselage (Gamli sáttmáli) prêté en 1262 au roi de Norvège. La structure de l’Islande médiévale était peu commune. Sur le plan national, l’Althing constituait à la fois un tribunal et une chambre législative ; il n’y avait ni roi, ni pouvoir exécutif central. C’étaient les chefs de clans (goðar) qui représentaient le peuple dans le parlement Althing ; une structure donc plutôt oligarchique. Néanmoins, selon une théorie exprimée par l’économiste David Friedman, la société islandaise aurait été « anarcho-capitaliste » pendant ses trois siècles d’indépendance, l’Althing s’apparentant plus à une chambre de commerce qu’à un corps de législation souverain.
Remarque : L’anarcho-capitalisme est un courant de pensée politique inspiré par le libéralisme philosophique, selon laquelle l’existence de l’État est illégitime et inutile. Ce courant est une branche du libertarianisme, différent du minarchisme, qui soutient quant à lui l'existence d'un État minimal pour tous (« État veilleur » dont l’unique fonction est de protéger la propriété privée). Il se sépare du libéralisme classique, lequel reconnaît la nécessité d’un État et ne vise qu’à limiter de façon stricte son domaine et ses modes d’intervention. Il se distingue aussi des courants historiques traditionnels (socialistes, fédéralistes, individualistes) de l’anarchisme par son acceptation sans limite de la propriété privée, et accessoirement, son appartenance aux libertariens, son absence de critique de la religion entre autres. Les anarchistes traditionnels considèrent plutôt que l'anarcho-capitalisme appartient à l'aile droite des libéraux et pas au courant historique de l'anarchisme, en dépit de son rejet de l'État ; ceci du fait qu'il ne partage pas avec l'anarchisme historique son « souci de l'égalité économique et [de] la justice sociale ». Il en va de même pour la plupart des anarchistes individualistes. Certains comme Noam Chomsky vont même jusqu'à dire que l'anarcho-capitalisme tend plus vers l'anomie que vers l'anarchie.
La Commune de Lyon est un mouvement révolutionnaire mené en 1870 par des républicains et des militants de plusieurs composantes de l'extrême-gauche de l'époque qui a pris le pouvoir à Lyon et mis en place un pouvoir autonome. La commune organise des élections et se dissout après avoir rétabli une normalité républicaine, ce qui frustre les éléments les plus avancés, qui espéraient une révolution différente. Ces derniers tentent deux fois de reprendre le pouvoir sans succès.
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui dura un peu plus de deux mois, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. Cette insurrection contre le Gouvernement, issu de l'Assemblée nationale qui venait d'être élue au suffrage universel, ébaucha pour la ville une organisation proche de l'autogestion. Elle est en partie une réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et au siège de Paris.
18 mars 1871 : Les Parisiens, essentiellement ouvriers, refusant la défaite et se sentant trahis, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers, qui a quitté Paris pour Versailles et ordonné l'enlèvement des canons de la Garde nationale suite à la signature de l'armistice avec la Prusse. 26 mars 1871 Élections des membres du Conseil de la Commune.
28 mars 1871 : Proclamation du Conseil de la Commune, surnommé « Commune de Paris », à qui le Comité central de la Garde nationale attribue les pouvoirs.
29 mars 1871 : Pour gouverner, la Commune se dote d'une Commission exécutive, à la tête de 9 commissions.
19 avril 1871 : La Commune présente son programme dans sa « Déclaration au peuple français » : séparation de l'Église et de l'État, instruction laïque gratuite et obligatoire, amélioration des conditions de travail.
1er mai 1871 : La Commission exécutive est remplacée par un organisme plus autoritaire : le Comité de Salut public.
16 mai 1871 : Démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial.
21-28 mai 1871 : La Semaine sanglante met fin à la Commune de Paris. Procès, exécutions et déportations des prisonniers communards.
La Révolution cantonale, en Espagne (1873-1874), fut un mouvement politique qui eut lieu durant la Première République espagnole et qui consista en une réorganisation d'une partie du territoire espagnol en cantons, c'est-à-dire des États indépendants volontairement réunis dans la Fédération espagnole (Federación española), proche d'une certaine manière du modèle suisse. Elle commença par une grève révolutionnaire déclenchée à Alcoy en juillet 1873. Ce mouvement était partisan d’un fédéralisme de caractère radical et a essayé d’établir une série de villes ou de confédérations de villes (cantons) indépendantes qui se fédèreraient librement. L’idéologie cantonale eut une grande influence sur le mouvement ouvrier naissant, et surtout sur l’anarchisme. La majorité des cantons a supprimé les monopoles, a reconnu le droit au travail, la journée de huit heures et a supprimé les impôts sur la consommation (droits d’octroi). La Première République espagnole et la Révolution cantonale prennent fin en décembre 1874 avec le coup d'État militaire du général Martínez-Campos.
La Révolution mexicaine (en espagnol Revolución mexicana) fut une série de soulèvements armés, de coups d'État et de conflits militaires entre factions ; notamment celles : de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza dans l'État de Coahuila, de Pancho Villa dans l'État de Chihuahua, et d'Emiliano Zapata au Morelos qui luttait pour la restitution des terres communales spoliées par les grands propriétaires. Ces différentes révolutions se produisirent au Mexique entre 1910 et 1920. Parmi elles, il faut souligner la tentative de République socialiste de Basse-Californie, Mexique (1911).
Le 29 janvier 1911, le Parti libéral mexicain (de Ricardo Flores Magón, photo ci-contre) planifie l'invasion du territoire de Basse-Californie du Nord, (Rebelión de Baja California) pour en faire une base opérationnelle du PLM dans la guerre révolutionnaire. Conduits par Simon Berthold et Jose Maria Leyva, les guérilleros (au nombre de 30) du PLM prennent Mexicali (300 habitants), en comptant sur la force de seulement 18 hommes, qui se retrouvent rapidement 500. Parmi eux, une centaine d'internationalistes armés sont membres de l'Industrial Workers of the World (Travailleurs Industriels du monde, syndicat révolutionnaire américain fondé en 1905) dont Frank Little (1879-1917) et Joe Hill (1879-1915), chanteur engagé. Jack London écrit une affiche en faveur de ces révolutionnaires, dans laquelle il garantit l’appui du cœur et de l’âme des « socialistes, anarchistes, vagabonds, voleurs de poules, proscrits et citadins indésirables des États-Unis d’Amérique ». Les tentatives des troupes fédérales pour reconquérir Mexicali échouent. Le 8 mai 1911, Tijuana (100 habitants) est prise par les combattants du Parti libéral mexicain. Le district nord de la Basse Californie est maintenant presque entièrement entre leurs mains. Les « magonistes » incitent le peuple à prendre possession collectivement de la terre, à créer des coopératives et à refuser l'établissement d'un nouveau gouvernement. Durant cinq mois, ils vont faire vivre la Commune de Basse-Californie, expérience de communisme libertaire : abolition de la propriété, travail collectif de la terre, formation de groupes de producteurs, etc. Ils sont finalement battus, en juin 1911, ce qui marque la fin de leur rêve d'établir une république socialiste libertaire en Basse Californie.
L’Ukraine libertaire (novembre 1918–1921), ou Makhnovchtchina, est un mouvement révolutionnaire paysan d'inspiration anarchiste visant à l'établissement d'une société sans état sur un territoire situé dans le sud de l'Ukraine actuelle, pendant la guerre civile russe. Des communes libres se forment à Gouliaï Polie et ailleurs sous la protection de l'Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne organisée par Nestor Makhno (photo ci-dessous), qui lutta d’abord contre les troupes d'occupation austro-hongroises, après la signature du traité de Brest-Litovsk, puis contre les blancs. En 1920 elle fut déclarée hors-la-loi et éliminée par les bolcheviks, avec lesquels elle s'était précédemment alliée contre les blancs. Les derniers combattants cessent le combat l'année suivante.
Localisation approximative de la Вільна територія (Territoire libre) makhnoviste.
L’anarchisme commence en Corée en 1894, quand le Japon envahit la Corée sous prétexte de la protéger de la Chine. C’est parmi les exilés qui s’enfuirent vers la Chine pendant le mouvement d’indépendance de 1919 que le mouvement anarchiste coréen se développe. Le conflit pour l’indépendance de la Corée vis-à-vis du Japon est connu sous le nom de « Soulèvement du 1er mars 1919 »; les anarchistes y jouèrent un rôle important notamment Kim Chwa-chin, Ha Ki-Rak, Park Yeol et Sin Chaeho. Parmi eux, Kim Chwa-chin est connu pour avoir organisé la Région autonome de Shinmin, en Mandchourie, près de la frontière-nord de la Corée (1929–1932).
Shinmin fut formée grâce à la collaboration entre la Fédération Anarchiste Coréenne en Mandchourie et la Fédération Anarcho-communiste Coréenne. Le projet consistait à créer un système de coopératives auto-gérées indépendantes contre l’impérialisme japonais. Après l’assassinat de Kim Chwa-chin, le mouvement anarchiste en Mandchourie et en Corée fut la victime d’une répression massive. Le Japon envoya ses armées attaquer Shinmin par le sud, pendant que leurs anciens alliés, de la République soviétique chinoise, attaquaient par le nord.
La révolution sociale espagnole de 1936 (revolución social española de 1936), couramment désignée sous le nom de révolution espagnole (revolución española), englobe tous les événements de type révolutionnaire déclenchés en Espagne, durant la guerre civile, en réponse à la tentative de coup d'État militaire les 17 et 18 juillet 1936. Les principaux représentants de ces mouvements étaient la Confédération nationale du travail (CNT/AIT), la Fédération anarchiste ibérique (FAI), le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM), ainsi que les ailes radicales du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et de l'Union générale des travailleurs (UGT). Les bases idéologiques de cette révolution se rattachent très clairement à l'anarcho-syndicalisme et au communisme libertaire, extrêmement puissant en Espagne dans les années 1930, mais aussi en partie au marxisme révolutionnaire. Les idées reposaient en grande partie sur :
• une très forte décentralisation, appelée « cantonalisme » en Espagne, dans le domaine administratif ;
• la collectivisation et l'autogestion dans le domaine économique ;
• le libéralisme dans les domaines moraux et sociaux ;
• un anticléricalisme virulent dans le domaine religieux ;
• le rationalisme dans le domaine éducatif.
Cette révolution sociale anarchiste eut principalement lieu en Catalogne, Aragon et Andalousie, Espagne de 1936 à 1937.
« Les paysans de ces régions proclament la propriété collective de la terre et des outils. »
Cette appropriation des outils de production par les travailleurs-producteurs correspond aux définitions de Bernard Friot (qui est certes marxiste donc différents des anarchistes). Il n’est pas contre la propriété mais distingue « propriété d'usage » (les outils/les terres aux ouvriers/paysans) qu’il admet et « propriété lucrative » (les outils/les terres aux propriétaires capitalistes seigneurs/industriels) qu’il désapprouve.
« Les assemblées de village désignent des conseils responsables à tout moment devant elles. »
La fédération anarchiste trouve son socle exécutif et législatif au niveau communal, au niveau du village. C'est exactement le projet de société de Jean Meslier (philosophe du début du XVIIIème siècle).
« La discipline au sein de la colonne est librement consentie, les combattants ne se cantonnent pas aux tâches guerrières, aidant les paysans aux champs ou organisant enseignement et activités culturelles. »
Les militaires / miliciens / gardiens de la paix / gardes nationaux, selon le nom qu'on pourrait leur donner, ne devraient majoritairement pas être des militaires de carrière. La force armée, défensive contre les attaques extérieures doit être très largement composée de citoyens au sens démocratique du terme.
Voici l'exemple de la Confédération Helvétique :
« La particularité de l'armée suisse est son système de milice. Les soldats professionnels constituent seulement environ 5 % du personnel militaire. Le reste est formé par des citoyens conscrits âgés de 18 à 34 ans (dans certains cas jusqu'à 50 ans). »
Source : http://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2017/06/politique-et-administration-de-la.html
« Mahatma » Gandhi
En inde, l’idée d’une forme directe de démocratie locale se décline essentiellement, jusqu’à la fin des années 1990, sur le mode rural et s’incarne dans l’assemblée villageoise : « gram sabha ». L’histoire politique de cette institution, pour s’en tenir à l’Inde du XXe siècle, commence avec Mohandas Karamchand Gandhi qui prend dans les années 1920 la tête du mouvement pour l’indépendance, mené par le parti du Congrès. Celui qu’on appellera bientôt le Mahatma (« la grande âme ») invente une stratégie politique destinée non seulement à libérer l’Inde du colonisateur britannique, mais aussi à préparer la construction d’une Inde nouvelle, plus prospère et plus juste. Dans cette perspective, Gandhi imagine un système politique fondé, à la fois moralement et pratiquement, sur les centaines de milliers de villages indiens. Il s’appuie pour cela sur les écrits des Orientalistes relatifs au système politique de l’Inde ancienne (par exemple Maine, 1890 ; Baden-Powell, 1899), qui font état de l’existence de « républiques villageoises » [Charles Metcalfe, un haut fonctionnaire de la Compagnie des Indes orientales (qui préfigure le gouvernement de l’Inde britannique), avait qualifié, en 1810, les villages indiens de « petites républiques » – une expression qui fera date. Après les Orientalistes, l’historiographie nationaliste indienne, à partir des années 1910, découvre et célèbre les républiques, au sens large de « gouvernement par la discussion » (Muhlberger, 1998), qui ont coexisté avec les monarchies à l’époque bouddhiste (du Ve siècle avant notre ère au IIe siècle) dans le Nord et l’Est de l’Inde. Des recherches plus récentes (Altekar, 1958 ; Sharma, 1968) ont montré que ces républiques existaient soit à l’échelle de villes-états, soit à une échelle supérieure, et qu’il faut donc les distinguer des conseils de villages qui perdurent jusqu’à l’époque coloniale, mais dont les attributions sont limitées à l’arbitrage des disputes.], et propose de restaurer ce qui apparaît comme un âge d’or politique, en construisant le nouveau système politique sur une myriade de communautés villageoises matériellement auto-suffisantes et fonctionnant selon le principe de la recherche du consensus.
[…] La Constitution indienne, promulguée en 1950, ne comportera aucune clause relative au gouvernement local, sinon l’article 40 (à valeur directive uniquement) déclarant que « chaque État prendra les mesures adéquates pour organiser des panchayat de village et les investira des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour leur permettre de fonctionner comme des unités d’auto-gouvernement ».
[…] De fait, les deux premières décennies qui suivent l’indépendance (en 1947) sont marquées par les choix politiques de Nehru (qui, tout en étant très proche de Gandhi, a une vision diamétralement opposée du chemin que doit emprunter l’Inde pour son développement), puis de sa fille, Indira Gandhi. Alors que Gandhi préconisait un développement économique fondé sur l’agriculture et l’artisanat rural, Nehru lance l’Inde dans la voie d’une industrialisation pilotée par l’État [Nehru soutient personnellement la décentralisation, qu’il considère comme un facteur de démocratisation du système politique, mais son entourage ne le suit pas (Kumar, 2006, pp. 19-20).]. Alors que Gandhi préconisait une architecture institutionnelle accordant une place majeure aux villages et à leurs conseils, l’exercice du pouvoir d’Indira Gandhi, qui devient Premier ministre en 1966, est caractérisé par une centralisation croissante des processus décisionnels.
La vision gandhienne d’une démocratie fondée sur les villages perdure pourtant bien après la mort de Gandhi en 1948, mais les figures qui l’entretiennent ont quitté le Congrès. Jaya Prakash Narayan, dit « J. P. », est la plus importante de ces figures. Associé à la mouvance socialiste au sein du Congrès, J. P. devient le fidèle disciple de Gandhi. Après l’indépendance, il est de plus en plus critique vis-à-vis de la politique menée par Nehru et cultive une vision alternative (considérée comme utopique par ses contempteurs) : celle d’une démocratie qu’il qualifie de « communitarienne », et qu’il présente ainsi dans un manifeste publié en 1959 : « Si nous voulons que nos institutions politiques aient des bases solides, si elles doivent se nourrir de la terre indienne, et en retour, soutenir, revigorer et fortifier tout le tissu social indien, elles doivent être liées au génie social de l’Inde, et leur texture doit être tissée à nouveau avec une vie communautaire organiquement auto-déterminée, auto-développée, dans laquelle les occupations, les professions et les fonctions sont intégrées dans la communauté » (Narayan, 1959). […]
Le contenu de la notion de participation fluctue amplement […]. La participation au sens strict s’incarne dans l’assemblée villageoise, une idée radicale (car pour Gandhi, J. P. et leurs disciples, la gram sabha doit constituer le socle de la démocratie indienne) qui peine à se traduire concrètement. La gram sabha fait bien partie des politiques de décentralisation mises en œuvre par la plupart des États dans les années 1960 (elle existe dès 1947 au Bihar et en Uttar Pradesh), mais elle ne fonctionne vraiment nulle part (Kumar, 2006, p. 205). En 1978, […], le Comité Ashoka Mehta définit la gram sabha comme une institution parallèle aux conseils élus, qui sont la véritable colonne vertébrale du schéma décentralisateur préconisé ; la gram sabha est alors conçue comme un appendice de la démocratie locale. Enfin, les débats parlementaires entourant le projet de politique de décentralisation à la fin des années 1980 font référence à la vision gandhienne, et présentent la gram sabha comme une institution majeure du gouvernement local. Mais la gram sabha mise en œuvre à partir de 1994 n’a qu’un rôle consultatif. […]
Pour Gandhi, les communautés villageoises pouvaient s’autogouverner dans l’harmonie, à travers la recherche du consensus, atteint par des discussions – on dirait aujourd’hui des délibérations. Dans cette perspective, les partis politiques, conçus comme se nourrissant des oppositions, pour ne pas dire du conflit, entre les électeurs, étaient considérés comme une nuisance, et Gandhi affirmait qu’ils n’avaient pas leur place dans la démocratie locale [...]
[…] Le parti du Congrès récupère l’idée de régénérer la démocratie en la consolidant au niveau local. La politique de décentralisation de 1992 est souvent qualifiée d’historique, parce qu’elle accorde un statut constitutionnel au gouvernement local, qui devient ainsi partie intégrante de la structure gouvernementale indienne. La décentralisation a pour objectif une plus grande efficacité de l’administration, mais aussi un approfondissement de la démocratie indienne : elle rend la représentation plus inclusive et « élargit l’entonnoir de la représentation », selon les termes de Rajiv Gandhi (Sivaramakrishnan, 2000, p. 17), d’abord parce qu’elle se traduit par plus de trois millions de nouvelles positions électives du seul fait de la mise en œuvre obligatoire des élections locales (qui concernent les conseils au niveau des villages, des cantons et des districts), mais aussi parce qu’elle impose des quotas pour les catégories sociales jusqu’alors les plus politiquement marginalisées : ainsi un tiers des circonscriptions locales est réservé aux femmes, tandis que les ex-intouchables et les tribaux bénéficient de quotas en proportion de leur importance démographique locale. Dans la plupart des États, les réunions de la gram sabha sont obligatoires, assorties d’un quorum, et ses prérogatives sont élargies (discuter du budget et des programmes de développement mis en œuvre par le conseil du village et sélectionner les bénéficiaires des programmes d’assistance publique) [Le Kérala est le seul État indien où un effort réel a été fait pour mettre en place une planification par la base : le « People’s Plan » lancé en 1996 implique que 35 % du budget de la Commission au Plan de l’État soit transféré aux collectivités locales. Une vaste campagne a été lancée pour encourager une large participation populaire dans les débats, notamment à travers la gram sabha.], ce qui constitue une autre innovation institutionnelle de taille.
La mise en œuvre de la politique de décentralisation révèle toutefois que de nombreuses résistances s’opposent à une véritable délégation des fonctions, des personnels et des fonds aux institutions locales. Ces résistances émanent des élus régionaux et nationaux, de l’administration à tous les niveaux, mais aussi des groupes localement dominants en termes de caste et de classe. […]
Le Kérala, le Rajasthan, le Karnataka et le Bengale occidental apparaissent aujourd’hui comme les États où la décentralisation est la plus aboutie.
Drapeau de l’Etat du Kérala (membre de l’Union Indienne)
Les choses sont différentes là où s’applique le Panchayati Raj (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) adopté en 1996. Cette législation dote la gram sabha de pouvoirs accrus dans les régions comprenant une population tribale majoritaire (huit États fédérés sont concernés). La gram sabha y est dotée d’un droit de veto sur les décisions concernant les ressources naturelles locales (terres, forêt, étangs etc.). L’objectif est de préserver le mode de vie traditionnel des communautés tribales, étroitement lié à l’usage collectif de ces ressources, et de limiter, dans ces régions dont le sous-sol est généralement riche en ressources minérales, un comportement prédateur de l’État. Ce renforcement du pouvoir de la gram sabha repose sur l’idée que, dans ces communautés relativement égalitaires, l’assemblée villageoise peut être le site d’une discussion ouverte.
Hors des zones tribales, ce sont deux politiques publiques récentes qui ont, indirectement, conféré une importance nouvelle à la gram sabha. La première est le droit à l’information (Right to Information Act) adopté au niveau de l’Union indienne en 2005. Cette loi oblige l’administration publique à tous les niveaux à fournir, à qui la demande, une information complète sur telle ou telle décision. Cette loi, qui vise à promouvoir la transparence et l’imputabilité de l’administration, constitue potentiellement (car sa mise en œuvre rencontre bien des obstacles) une arme puissante de lutte contre la corruption. Dans les villages, elle permet à la gram sabha de discuter en connaissance de cause de l’usage qui a été fait des fonds publics par ceux par qui ils transitent – élus et bureaucrates locaux. La deuxième politique publique est un programme d’emplois publics, le National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), également adopté en 2005. Cette loi garantit, à tout ménage rural qui le demande, cent jours d’emploi par an sur des chantiers publics (construction de routes, de canaux d’irrigation etc.) [Ce programme est actuellement mis en oeuvre dans 330 districts (sur un total de 593 dans tout le pays) considérés comme les moins développés ; il garantit une rémunération sur la base du salaire minimum, avec des taux égaux pour les hommes et pour les femmes (alors que les femmes sont toujours sous-payées en milieu rural).] Pour éviter que ce programme connaisse le même sort que ses prédécesseurs, la loi comporte une disposition selon laquelle la gram sabha est chargée de l’« audit social » de la mise en œuvre du programme : autrement dit, les électeurs sont invités à vérifier que les registres de l’administration correspondent à la réalité, qu’il s’agisse du nombre de bénéficiaires du programme, de leur identité, du salaire qui leur a été versé ou de la mesure du travail accompli.
[…]Le droit à l’information est l’aboutissement du travail d’analyse et de mobilisation mené depuis 1996 par une ONG basée au Rajasthan, le Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Union pour le pouvoir des travailleurs et des paysans, MKSS), qui mobilise les pauvres autour de la question des salaires minimaux et de la redistribution des terres. Derrière cette organisation pionnière, beaucoup d’autres contribuent à la mise en œuvre de cette législation. Le Rajasthan est aujourd’hui l’un des États où la mise en œuvre du programme d’emplois ruraux est considérée comme la plus satisfaisante, et la mobilisation autour du droit à l’information par les militants du MKSS y est pour beaucoup. Plus généralement, la présence locale des ONG apparaît comme un facteur important de « succès » de la décentralisation : les ONG contribuent à mobiliser les électeurs par leur travail de diffusion de l’information, par exemple au sujet de la tenue et des objets des réunions de la gram sabha . Signe de la légitimité nouvelle de l’engagement du secteur non gouvernemental dans des activités touchant à la politique, les ONG se présentent volontiers, désormais, comme des « groupes de citoyens ».
Ce deuxième tournant est enfin lié à un troisième : la participation se développe également dans les villes. La politique de décentralisation de 1992 comporte en effet un volet urbain : trois types de municipalité sont définis (en fonction notamment de la taille de la population), des quotas pour l’élection des conseillers municipaux y sont également mis en œuvre pour les femmes, les ex-intouchables et les tribaux, et l’équivalent urbain de la gram sabha est le ward committee, supposé rassembler élus, administration municipale et représentants de la société civile, pour gérer les affaires locales à l’échelle de la circonscription municipale (le ward). Mais contrairement à la gram sabha, la composition du ward committee est laissée à la discrétion des États, et tous, sauf le Kérala, interprèteront cette clause de façon très restrictive : le ward committee n’inclut le plus souvent aucun représentant de la société civile et ne constitue qu’un échelon décentralisé d’interaction entre élus et administration municipale. Dans les grandes villes indiennes, la notion d’une participation directe des résidents à la gestion des affaires locales s’incarne en fait dans des dispositifs lancés par le gouvernement, comme le programme Bhagidari à Delhi, qui affiche pour objectif la mobilisation des « groupes de citoyens ». La description de ce programme-étendard par l’un de ses inventeurs, le chef de l’administration de la ville-État de Delhi, résume la synthèse opérée ces dernières années entre les visions politique et managériale de la participation. S. Reghunatan, évoquant Gandhi, reprend à son compte la vieille méfiance vis-à-vis des partis : « Une partie des problèmes de gouvernance en Inde sont dus aux élus et à l’administration... le seul moyen d’y remédier est de revenir au peuple... Les ward committees ont été circonscrits, c’est l’une des raisons pour laquelle j’ai voulu le programme Bhagidari... nous voulions éviter les interférences politiques », explique-t-il.
L'Armée zapatiste de libération nationale (espagnol : Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) est un groupe révolutionnaire politico-militaire insurgé basé au Chiapas, l'un des États dont les habitants sont parmi les plus pauvres du Mexique, pays qui est depuis ces dernières années une importante puissance économique mondiale en termes de PIB. L'EZLN affirme représenter non seulement les droits des populations indigènes, au nombre de 957 255 personnes appartenant à diverses ethnies (soit 22,3 % de la population du Chiapas en 2005, ces diverses ethnies sont les descendantes des mayas et représentent moins de 1 % de la population totale du Mexique qui compte plus de 112 millions d'habitants) mais aussi de toutes les minorités.
L'organisation est devenue pour certains un symbole de la lutte altermondialiste. Après dix années de préparation et d'organisation clandestine dans les villages de la jungle (selva) et des hauts plateaux (los altos) du Chiapas commence, le 1er janvier 1994, une insurrection indigène. Ce soulèvement a lieu le jour même de l'entrée en vigueur de l'ALENA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la date est donc choisie pour montrer un rejet du néolibéralisme.
Les combattants zapatistes, au visage caché par des paliacates ou des passe-montagnes, déclarent la guerre au gouvernement fédéral et à son armée, et parviennent à occuper San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Altamirano et Ocosingo.
Après douze jours de guerre menée par l'EZLN, dont le bilan varie entre 46 morts (selon l'EZLN) et 145 (selon le gouvernement), le gouvernement décrète un cessez-le-feu unilatéral sous la pression de la société civile nationale et internationale, et entame un premier dialogue avec l'EZLN dans la cathédrale de San Cristóbal de Las Casas. L'évêque de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, sert de médiateur. Pour prouver sa bonne volonté, le gouvernement libère les prisonniers zapatistes et l'EZLN livre son unique otage, le général Absalón Dominguez, ancien gouverneur du Chiapas.
À partir de décembre 1994, les zapatistes constituent peu à peu des communes autonomes, indépendantes de celles gérées par le gouvernement mexicain. Marcos décrit comment ces communes mettent en œuvre des pratiques concrètes d'autogestion pour rendre leur fierté aux peuples indigènes, pauvres et qu'ils jugent trop méprisés par le pouvoir. Ainsi, l'EZLN met en œuvre des services de santé gratuits, des écoles là où il n'en existait pas, un système de justice, un système de police, tout cela avec le support de partenaires. Ces municipalités autonomes sont regroupées par caracol; il en existe cinq : Morelia, municipalité de Amatán, La Realidad, municipalité de Ixtacomitán, Roberto Barrios, municipalité de Palenque, La Garrucha, municipalité de Ocosingo et Oventik.
La pancarte indique en espagnol : « Vous vous trouvez en territoire rebelle zapatiste. Ici le peuple commande et le gouvernement obéit. Zone nord. Conseil de bon gouvernement. Le trafic d'armes, la production et la consommation de drogues, de boissons alcoolisées et les ventes illégales d'essences d'arbres sont strictement interdites. Non à la destruction de la Nature. » (Photo prise en 2005 sur l'autoroute 307, au Chiapas)
Depuis quelques années maintenant, les zapatistes affirment être armés mais ne pas vouloir s'en servir. Ces méthodes presque non-violentes peuvent expliquer l'aura entourant le mouvement. La prise du pouvoir, que ce soit par la force ou l'électoralisme, perpétue le système de hiérarchie coercitive, ce que les zapatistes veulent supprimer. Il faut donc partir du bas : modifier les consciences individuelles, pour arriver à un changement spontané. « Les dictateurs appliquent une guerre génocidaire non déclarée contre nos peuples, c'est pourquoi nous te demandons ta ferme participation en appuyant ce plan qui est celui du peuple mexicain qui lutte pour le travail, la terre, un toit, manger, la santé, l'éducation, l'indépendance, la liberté, la démocratie, la justice et la paix. »
Au Venezuela, le gouvernement d'Hugo Chávez fait adopter la loi des Conseils Communaux (Ley de los Consejos Comunales) publiée le 10 avril 2006 dans la Gaceta oficial de la Republica Bolivariana. Elle créé plus de 18 000 conseils communaux, ruraux et urbains. Prévu pour regrouper entre 200 et 400 familles vivant dans une même zone; le conseil communal, à la différence des institutions traditionnelles, définit lui-même ses frontières. Le droit de vote est abaissé à 15 ans. À terme, ces conseils communaux devraient remplacer les municipalités actuelles. Selon l'article 4 de la loi : « la commune (ou le quartier) est la cellule vivante qui forme l'unité de base de la vie politique et de laquelle tout provient : la citoyenneté, l'interdépendance, la confédération et la liberté ».
Hugo Chavez
Assemblée constituante islandaise de 2011. L'Islande était un pays prospère, dont la population était la plus heureuse du monde, selon l'indice du bonheur établi par l'université Erasmus de Rotterdam, en dépit de la corruption de sa classe dirigeante. Mais en septembre 2008, les banques islandaises sont en faillite (scandale Icesave), le pays (c'est-à-dire les contribuables) est alors sommé par le FMI de rembourser aux gouvernements britannique et néerlandais le montant des dépôts effectués par les clients qu'ils se sont chargés de dédommager. Les Islandais, qui devraient travailler plusieurs siècles à cette fin, assiègent le Parlement. Un accord est signé par le nouveau gouvernement de gauche : les Islandais ne verseraient que 50 % de leur PIB ! Le président refuse de promulguer la loi votée par le Parlement et il la soumet au référendum en mars 2010 : 93 % des votants refusent de payer. Lors d'un deuxième référendum, en avril 2011, 60 % des votants refusent encore de payer. Entre-temps, dès 2009, des manifestations incessantes mobilisèrent quotidiennement une grande partie de la population, pendant des mois. Les manifestants de la « révolution des casseroles » (objets qu’ils utilisaient pour faire du bruit devant le bâtiment du gouvernement ou carrément devant le domicile du premier ministre) exigeaient la démission du gouvernement et des gouverneurs de la banque centrale. Quand ils obtinrent gain de cause (2010), les citoyens décidèrent de ne pas renflouer les banques privées qui avaient spéculé avec leur argent. Le 6 novembre 2010, 950 citoyens furent tirés au sort et se réunirent pour définir les grandes priorités pour le pays. Le 25 novembre 2010, 25 d’entre eux furent élus pour élaborer un projet de Constitution pour le pays. Tout le monde pouvait suivre les délibérations en direct et participer en ligne. Les questions récurrentes étaient :
- Comment rendre nos élus responsables de leurs actes ?
- Introduire de la transparence pour voir ce qu’ils font ;
- Répartir les pouvoirs pour éviter la corruption.
Le 29 juillet 2011, le « groupe des 25 » remit officiellement le texte au parlement. Le pouvoir des politiques, des entreprises et des banques y est encadré par les citoyens. Un référendum consultatif, le 20 octobre 2012, approuve à 66 % le projet, mais il est entendu que celui-ci doit être voté dans les formes constitutionnelles par deux Parlements successifs. Il ne restait plus aux parlementaires qu’à entériner le texte ... mais les députés conservateurs l’ont bloqué ; et la situation dure ainsi depuis 5 ans !
Le Rojava (« l'ouest » en kurde) ou Kurdistan occidental (en kurde : Rojavayê Kurdistanê) ou Kurdistan syrien (en arabe کوردستان السورية Kurdistan Al-Suriyah), est une région de facto autonome qui se situe au Moyen-Orient et se trouve dans le nord et le nord-est de la Syrie. Le 17 mars 2016, les Kurdes de Syrie proclament une entité « fédérale démocratique » dans les zones contrôlées et qui comprennent notamment les trois « cantons » kurdes d'Afrine, de Kobané et de la Djézireh, dans ce qui était jusqu'à présent une zone d’« administration autonome ». Cette entité est également dénommée Rojava-Syrie du Nord. Dans sa constitution de décembre 2016, son nom officiel est celui de Système fédéral démocratique de Syrie du Nord, en kurde : Sîstema Federaliya Demokratîka Bakûrê Sûriyê, en arabe: النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا. Cette déclaration a été faite à Rmeilane par le Parti de l'union démocratique (PYD) en présence d'autres partis kurdes, arabes, assyriens. Depuis 2012, la majorité du Kurdistan syrien est contrôlé par des milices kurdes. En novembre 2013, des représentants kurdes, arabes, assyriens et d'autres minorités plus petites ont déclaré un gouvernement de facto dans la région. Deux millions de Kurdes vivent sur ce territoire.
Le système politique du Rojava est inspiré par le confédéralisme démocratique théorisé depuis le milieu des années 1990 par Abdullah Öcalan, le leader idéologique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) emprisonné à vie. Öcalan a été profondément influencé par les thèses d'un militant et intellectuel anarchiste américain, Murray Bookchin, qui a théorisé le municipalisme libertaire.
Murray Bookchin
Abdullah Öcalan
En janvier 2014, le Rojava s'est doté d'un Contrat social, qui fait office de constitution. Les grandes lignes du « confédéralisme démocratique » sont définies par un projet de démocratie assembléiste proche du municipalisme libertaire, une économie de type collectiviste, un système de fédéralisme intégral entre communes et une coopération paritaire et multiethnique dans des systèmes organisationnels et décisionnels autogérés. Le « municipalisme libertaire » ou communalisme libertaire, désigne la mise en œuvre locale de l'écologie sociale élaborée par le théoricien communiste libertaire et écologiste politique américain Murray Bookchin. Ces termes sont utilisés pour décrire un système politique dans lequel des institutions libertaires, composées d'assemblées de citoyens, dans un esprit de démocratie directe, remplaceraient l'État-nation par une confédération de municipalités, de communes, libres et autogérées. Le projet repose sur l'idée que la commune constitue une cellule de base capable d'initier une transformation sociale radicale.
12 - Conclusion provisoire … Du localisme au confédéralisme municipal
A l’instar des « localistes » (définition : qui privilégient ce qui est local sans toutefois se fixer de limites frontalières, entendant favoriser ainsi la démocratie participative, la cohésion sociale et la production de proximité, donc l'emploi local et la préservation de l'environnement via une moindre empreinte écologique liée au transport de marchandises), je pense que la solution non-violente va venir d’actions « locales », de petite envergure mais de plus en plus nombreuses. Vouloir s’opposer massivement au pouvoir en place (avant-hier monarchique, hier soviétique, aujourd’hui ultralibéral) comme lors d’insurrections passées, ou en manifestant vainement, comme les altermondialistes, pour demander aux gouvernements corrompus d’appliquer des lois (exemple : la taxe Tobin) qui iront à l’encontre des intérêts de leurs corrupteurs, est voué à l’échec ; ou pire : à déclencher la violence des grands possédants réactionnaires.
Les consciences doivent s’éveiller progressivement ; par l’information, par l’éducation.
Dans le même temps, les citoyens doivent passer à l’action en se regroupant autour de projets collectifs : des ateliers constituants pour développer l’autonomie et d’autres, plus matériels, pour tendre vers l’indépendance (alimentaire, énergétique, etc.). Nul besoin de briguer une révolution mondiale ; des projets d’envergure communale seront amplement suffisants (et déjà pas si faciles à réaliser).
Au-delà de cette échelle limitée à quelques milliers de personnes, comme l’a pressenti Claude-Adrien Helvétius (« ligue de républiques »), parce qu’il existe des spécificités locales, c’est le fédéralisme (ou « communalisme » ou « confédéralisme municipal » ou « république des villages ») qui devra s’imposer.
Helvétius avait préconisé l’échelle de la province tandis que Jean Meslier, relayé aujourd’hui par Murray Bookchin, en passant par Mahatma Gandhi, avaient choisi l’échelle de la commune.
Chaque communauté devra écrire ses lois, c’est-à-dire, au sens étymologique du terme « être autonome » ; l’idéal étant, qu’en plus, elles soient « indépendantes » ou, dit autrement, « autosuffisantes » en termes alimentaires et énergétiques.
Pour leur survie, les communes autonomes devront néanmoins se fédérer ; ne serait-ce que pour assurer leur Défense nationale.
Le premier danger viendra de l’extérieur (exemple : Les anarchistes espagnols de 1936-37 qui ont manqué d'une logistique militaire suffisante et qui ont été massacrés par les fascistes de Franco mais aussi trahis par les républicains et les staliniens).
Mais le danger viendra aussi de l’intérieur. Pour éviter que les « hommes de génie couronnés de vertu » (dixit Mikhaïl Bakounine) ne mettent en place un système de domination étatique « qui crée en permanence ses élites et ses privilèges », même si au départ ce système est animé d’un paternalisme bienveillant, il faudra limiter la bureaucratie à un rôle de coordination, sans coercition, hormis en période de guerre.
L’État devra assurer :
- la sécurité (intérieure et extérieure)
- la justice la plus homogène et démocratique possible sur tout le territoire (en combinant la compétence des magistrats professionnels avec des jurés tirés au sort comme dans les cours d’assisses)
- la protection de ses citoyens contre la maladie, la faim, le froid, … et l’aide aux plus démunis face à la vieillesse, au handicap ...
- et enfin une cohésion culturelle de la confédération grâce à l’éducation.
Les anarchistes espagnols affirmaient être contre « l’État », mais en réalité ils étaient contre l'appareil politico-bureaucratique. Plus la décision est centralisée, au sommet d’une administration hiérarchique, plus les risques de corruption sont grands, plus le risque qu’une décision soit prise en faveur d’une minorité (riche et/ou influente), contre l’intérêt du plus grand nombre, est grand ; plus les risques d’abus de pouvoir sont grands.
Si une administration est mise en place pour gérer ce qui relève des prérogatives de l'Etat, il faudra veiller à ce qu'elle soit la plus décentralisée possible afin de rapprocher ceux qui prennent les décisions et ceux qui les subissent. « Pour éviter qu'une dictature nouvelle se bâtisse, quelle que soit sa couleur politique, il faut limiter les pouvoirs de l’État central par une définition très précise de ses prérogatives et par des contre-pouvoirs, des organes de contrôle populaire, démocratique. »
Ainsi, L’Etat (la « Confédération communale » ou « République des communes » ) devra s’effacer chaque fois que possible pour respecter la volonté de ses communautés constituantes, selon le principe de « l’éthique minimale » de Ruwen Ogien. Cet Etat devra s’en tenir à ses prérogatives, très importantes certes, vitales même, mais en nombre limité (défense, sécurité, justice, éducation, émission monétaire nationale, auxquelles on doit ajouter santé).
Epilogue
Ainsi s’achève mon cheminement intellectuel. De la communauté d’amis d’Epicure, dans son Jardin, aux communautés rebaptisées villages, communes ou encore « villes en transition » respectueuses de la nature, j’ai personnellement (re)découvert le courant politique de l’anarchisme (le seul véritablement démocratique), son histoire contemporaine (au XIXème et début du XXème siècles) et surtout ses bases très anciennes (dans la plupart des sociétés premières dites « primitives »).
Il n’y a donc pas qu’une alternative (sous-entendue « la dictature communiste ») à l’ultralibéralisme dominant, à ce « nouvel ordre mondial » qui se prétend inéluctable, avec une centralisation extrême et un pouvoir absolu dans les mains des banquiers internationaux. Il demeure l’espoir des communes autonomes (et indépendantes) et des entreprises autogérées.
Un
coucher de rideau aux couleurs du drapeau rouge et noir (mélangeant « socialisme »
et « anarchisme ») sans oublier une touche de vert pour l’écologie libertaire
…
Anarcho-syndicalisme Ecologie libertaire
L'écologie
libertaire, qui s'appuie sur les travaux théoriques des géographes français Élisée Reclus (1830-1905 ; « Voter, c’est abdiquer ») et russe Pierre
Kropotkine (1842-1921), critique en effet l'autorité, la hiérarchie
et la domination de l'homme sur la nature. Elle propose l'auto-organisation, l'autogestion des collectivités, le mutualisme.
Élisée Reclus
Pierre (Piotr) Alekseïevitch
Kropotkine
C’est
un courant très proche de l'écologie sociale élaborée par l'américain Murray
Bookchin. Et
cette écologie libertaire s’accorde parfaitement avec le symbole du « Jardin »
d’Epicure.










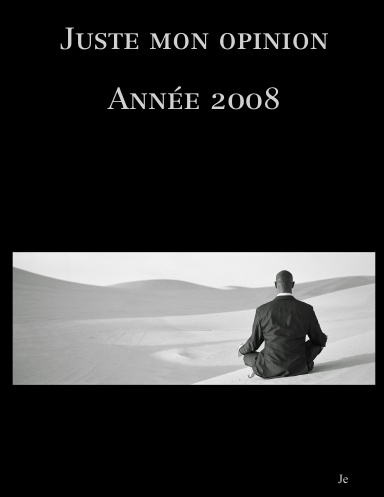
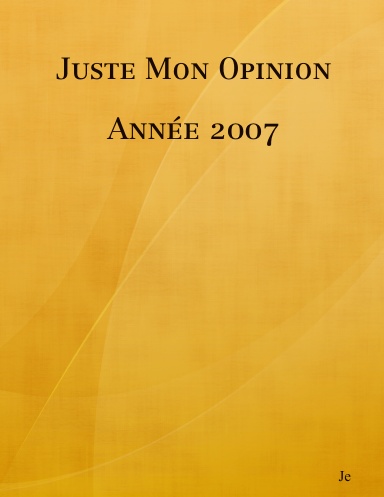

















































7 commentaires:
J'aurais pu développer le chapitre 8- "Extension du modèle politique au monde de l’entreprise" en donnant plus d'exemples d'autogestion ...
Dans sa définition classique, l’autogestion (du grec autos, « soi-même », et « gestion ») est le fait, pour un groupe d’individus ou une structure considérée, de prendre les décisions concernant ce groupe ou cette structure par l’ensemble des personnes membres du groupe ou de la structure considérée.
Il existe cependant une autre définition, plus politique ; y sont intégrés d'autres paramètres avec une certaine variabilité. Ses postulats sont :
- la suppression de toute distinction entre dirigeants et dirigés,
- la transparence et la légitimité des décisions,
- la non-appropriation par certains des richesses produites par la collectivité,
- l'affirmation de l'aptitude des humains à s'organiser sans dirigeant.
Cette conception se construit en général explicitement contre des pratiques qualifiées de hiérarchiques, autoritaires, verticales, contre des formes de dépossession que constitueraient certains modes d'organisation. En d'autres termes, ce type d'autogestion permettrait une réappropriation d'une forme d'organisation collective.
Par ailleurs, cette définition permet des pratiques d'autogestion qui ne se limitent pas au seul champ économique.
L'autogestion n'impliquant pas d'intermédiaire gouvernemental, elle s'inscrit dans la philosophie anarchiste, dans sa dimension collectiviste, individualiste, et anarcho-communiste (ou anarcho-socialiste).
Parmi les exemples pérennes contemporains, j'aurais notamment pu parler des kibboutz.
Un kibboutz (de l'hébreu : קיבוץ, au pluriel : קיבוצים : kibboutzim ; « assemblée » ou « ensemble ») est une communauté ou un village collectiviste d'Israël développée par le mouvement sioniste d'influence socialiste. Le premier kibboutz est fondé à Degania en 1910.
Il s'agit à l'origine de communautés rurales, mais des activités industrielles ont commencé à y être développées dès les années 1940-1950.
Historiquement, les membres des kibboutzim ont été perçus comme une élite, particulièrement militante et engagée. Ainsi, dans les années 1980, les officiers issus des kibboutzim représentaient près de 25 % du corps des officiers, pour à peine 3 % de la population.
Cependant le poids idéologique ou humain des kibboutzim est clairement en baisse relative depuis les années 1970, et ils ne pèsent plus que 1,8 % de la population israélienne en 2005. Leur population ne se réduit pas vraiment, mais surtout elle ne progresse plus dans une société israélienne en développement démographique rapide. Malgré cette baisse du poids démographique, ils représentent encore 10 % de la production industrielle israélienne, 40 % de sa production agricole et 6 % de son PIB en 2010.
Une personne vivant dans un kibboutz est appelée kibboutznik (pluriel kibboutznikim).
Il y eut aussi des kolkhozes en URSS ; à distinguer des sovkhozes.
Un kolkhoze (en russe колхоз, prononciation) était une coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils, le bétail étaient mis en commun. Il remplaça les artels. Le mot kolkhoze est une contraction de коллективное хозяйство (kollektivnoïé khoziaïstvo), « économie collective », alors que sovkhoze est une contraction de советское хозяйство (littéralement « économie soviétique »). Les kolkhozes et sovkhozes étaient les deux composantes du système agricole socialisé qui a commencé à émerger après la révolution d'octobre de 1917.
Le membre d'un kolkhoze était appelé kolkhoznik ou kolkhoznitsa au féminin (en russe : колхозник ou russe : колхозница). Les kolkhozniks étaient payés en parts de la production du kolkhoze et du profit fait par le kolkhoze proportionnellement au nombre d'heures travaillées. Les kolkozniks étaient en plus autorisés à posséder des terres, de l'ordre de 4 000 m2, et un peu de bétail. Ces avantages en nature rendaient le kolkhoze beaucoup plus attrayant aux yeux des Soviétiques par rapport au sovkhoze, dans lequel les sovkhozniks étaient salariés.
Un sovkhoze (en russe совхоз) était une ferme d'État de l'URSS. Le mot est la contraction de советское хозяйство, soit « ferme soviétique ». Les sovkhozes furent créés lors de l'expropriation des « koulaks » lors de la campagne de collectivisation lancée par Staline après 1928.
Une personne travaillant dans un sovkhoze était un sovkhoznik (en russe : совхозник ; au féminin sovkhoznitsa / russe : совхозница). Dans un sovkhoze, les ouvriers agricoles étaient salariés, sans être propriétaires. Les salaires n'étaient pas (ou peu) indexés sur la productivité du sovkhoze.
Afin de pallier une faible productivité et donc une production insuffisante, des lopins de terre privés furent tolérés dans les sovkhozes. Leur surface fit ensuite l'objet de diverses réformes.
J'aurais également pu décrire la répartition des entreprises françaises entre les différentes catégories "microentreprises", "petites et moyennes entreprises (PME), "entreprises de taille intermédiaire" (ETI; 250 à 4999 employés) et "grandes entreprises".
Et les différents secteurs d'activités (hors agriculture; données 2010) :
- Industrie manufacturière, industries extractives et autres (effectifs 3,2 millions soit 19% du total)
- Construction (1,5 million soit 9%)
- Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration (5,3 millions soit 31%)
- Information et communication ( 0,7 million soit 4%)
- Activités financières et d'assurance (0,8 million soit 5%)
- Activités immobilières (0,2 million soit 1%)
- Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien (2,6 millions soit 15%)
- Enseignement, santé humaine et action sociale (1,9 million soit 11%)
- Autres activités de services (0,8 million soit 5%)
Ou encore le tirage au sort pour désigner les membres de l'assemblée des "3,5 millions d'entreprises" parmi les 28,6 millions de personnes de la population active (données 2014) "de 15 ans ou plus en France métropolitaine. Elle regroupe 25,8 millions d'actifs ayant un emploi et 2,8 millions de personnes au chômage. Le reste de la population âgée de 15 ans ou plus constitue la population inactive au sens du Bureau international du travail (BIT), c'est-à-dire les personnes ne travaillant pas et ne recherchant pas activement un emploi ou n'étant pas disponibles rapidement pour en occuper un."
Deux remarques sur les kibboutz.
D'abord sur ses origines agricoles.
L'origine des Kibboutz se trouve au sein du parti Ha'poel Hatzaïr, un parti politique non-marxiste, influencé par le socialisme populiste russe et l'œuvre de Tolstoï, dont le principal inspirateur est Aharon David Gordon. L'idéal est celui d'un socialisme rural, anti-industriel et anti-autoritaire, très marqué par l'anarchisme avec le refus des structures élues.
Seconde remarque.
Le mouvement anarchiste contemporain est volontiers critique sur certains aspects des kibboutzim. Exemple de ces critiques anarchistes, l'essayiste et « anarchiste socialiste » (selon la définition qu'il donne de lui-même) américain Noam Chomsky a ainsi exprimé sa vision dans deux interviews, la première, disponible sur internet, dans l'émission de radio américaine Democracy Now présentée par Amy Goodman, la seconde dans un livre d'entretiens. Chomsky s'est lui-même installé en 1953, pour une durée de six semaines, dans un kibboutz près de Haïfa.
Les critiques faites par les anarchistes sont pour les plus importantes :
- Le kibboutz demande normalement à ses membres l'appartenance à la communauté juive (il existe des exceptions, comme celle de Joseph Ribas, militant de la CNT anarchiste espagnole, ancien combattant de la Guerre d'Espagne, qui s'installa après la Seconde Guerre mondiale avec femme et enfants dans le Kibboutz Hahotrim, au sud de Haïfa). L'anarchisme de son côté insiste généralement sur les principes d'universalisme et d'antinationalisme.
- Les kibboutzim ont une relation très poussée avec l'État : la réussite économique des kibboutzim est partiellement due aux subventions de l'état, et ceux-ci lui fournissent des troupes d’élite, pilotes, agents de renseignement, officiers gradés, etc. L'anarchisme rejette quant à lui le principe même d'État.
- Chomsky considérait qu'il existe dans le kibboutz un « autoritarisme du groupe » extrêmement fort, engendrant un machisme et un conformisme très puissant : par exemple, presque aucun habitant de kibboutzim ne refuse de faire son service militaire.
- L'utilisation de salariés non-membres dans les entreprises des kibboutz réintroduit des inégalités sociales et de pouvoir (ils ne votent pas dans les prises de décisions collectives) que combat l'anarchisme.
Enregistrer un commentaire