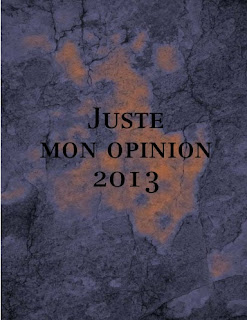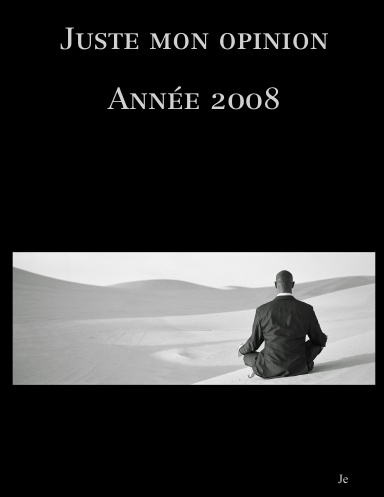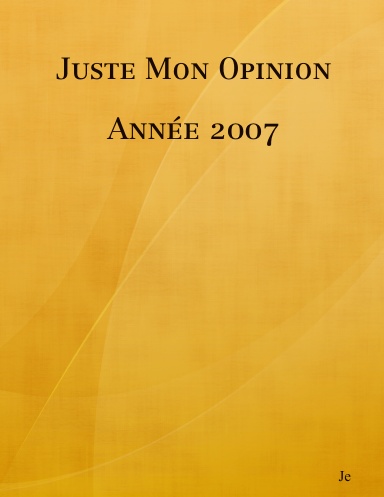Notes de lecture 23 Juin 2014
Les «Notes de lecture» sont une publication apériodique.
Dette: 5000 ans d’histoire
David Graeber
Editions Les liens qui libèrent
621 pages, 29,90 €
(Notes de lecture de J-P Allétru)
Vertigineux!
On ne sort pas indemne de cette lecture, on ne voit plus le monde de la même
façon. David Graeber, anthropologue, démolit les fondements les plus sacrés de
la «science» économique, renouvelle le regard sur le monde antique, sur le Moyen-âge,
sur la naissance du capitalisme, sur la situation actuelle...
Qu’est-ce
que la monnaie? La dette? Que sommes-nous, en tant qu’êtres humains?
On n’épuise
pas un tel livre, qui balaie 5000 ans d’histoire, en une seule lecture, et
pourtant il est facile à lire. [On pourra
être effrayé : 621 pages... Mais le livre proprement dit ne compte «que» 478
pages, il y a en plus 72 pages de bibliographie, et 70 pages de notes. Ces
notes sont souvent intéressantes, mais il est regrettable qu’elles n’aient pas
été mises en bas de page].
Ces notes de
lecture visent à vous donner un aperçu. Si vous lisez le livre, vous y
découvrirez à votre tour de nombreux abîmes de réflexion...
Le point de
départ, c’est cette sentence qui semble de bon sens: «il est clair qu’on doit toujours
payer ses dettes».
On voit bien
ce qui fait sa force: ce n’est pas vraiment un énoncé économique, c’est un
énoncé moral.
C’est
pourquoi la pensée altermondialiste – l’auteur, David Graeber, se présente
comme tel- a parfois du mal à faire son chemin dans l’opinion: elle semble
contredire le bon sens, la morale...
Le livre
s’ouvre sur une conversation entre l’auteur et une interlocutrice, à propos de
la dette du Tiers Monde.
-
«Nous
voulons l’abolir», dit Graeber.
-
«Mais ils
l’ont emprunté, cet argent. Il est clair qu’on doit toujours payer ses dettes».
-
«J’aurais pu
lui dire que ces emprunts avaient été contractés par des dictateurs non élus
qui avaient mis directement l’essentiel des fonds sur leur compte personnel en
Suisse; lui paraissait-il juste d’exiger que les créanciers soient remboursés
en ôtant le pain de la bouche d’enfants affamés ? J’aurais pu lui faire
remarquer que nombre de ces pays pauvres avaient déjà remboursé trois ou quatre
fois la somme empruntée, mais que par le miracle des intérêts composés, leurs
versements n’avaient toujours pas sensiblement réduit le principal. Ou lui faire
mesurer l’écart qu’il y a entre refinancer des prêts et imposer à des pays une
politique économique libérale que leurs citoyens n’avaient jamais acceptée et
n’accepteraient jamais. Ou encore lui dire que la politique économique
qu’imposait le FMI ne fonctionnait même pas. Mais il y avait un problème plus
fondamental: le postulat selon lequel les dettes doivent être remboursées.
Ce qu’il
faut comprendre, c’est que l’énoncé «on doit toujours payer ses dettes» n’est
pas vrai. Tout prêteur est censé prendre un certain risque. Si l’on pouvait se
faire rembourser n’importe quel prêt, même le plus stupide, les effets seraient
désastreux. C’est pourtant cette situation que le FMI a créée au niveau
mondial.
C’est ainsi
qu’à Madagascar, l’Etat a été contraint par le FMI à réduire ses dépenses sur
un programme d’éradication du paludisme. Il y a eu 10000 morts. Etait-il
justifié de perdre 10
000 vies
pour que la Citybank n’ait pas à reconnaître ses pertes sur un seul prêt
irresponsable, d’ailleurs sans grande importance pour son bilan? Mon
interlocutrice répondait oui. Il est clair qu’on doit toujours payer ses
dettes...»
Pourquoi la
dette? La dette des consommateurs est le sang qui irrigue notre économie. Tous
les Etats modernes sont bâtis sur le déficit budgétaire. La dette est devenue
le problème central de la politique internationale. Mais nul ne semble savoir
exactement ce qu’elle est, ni comment la penser.
On trouvera
ci-après, non un résumé du livre, mais des extraits, des passages qui m’ont
particulièrement interpelé. Le livre est beaucoup plus riche, bien entendu, que
ces quelques notes.
Où l’on voit
que l’homme, c’est bien plus compliqué que l’homo economicus des économistes...
«D’abord il
y a le troc, puis la monnaie; le crédit ne se développe que plus tard». Ce
récit que font traditionnellement les économistes est un mythe, qui ne repose
sur aucun fondement historique réel. Le Pays du Troc d’Adam Smith n’existe pas.
Newton avait représenté Dieu comme un horloger cosmique qui, après avoir créé
la machinerie physique de l’univers pour qu’elle opère au bénéfice ultime des
humains, la laisse fonctionner toute seule. Adam Smith
tentait de
tenir un raisonnement comparable. La Divine Providence a disposé les choses de
telle façon qu’en poursuivant notre intérêt personnel nous sommes néanmoins
conduits «comme par une main invisible» à promouvoir le bien-être général, si
le marché opère sans entrave. Les principes de base de l’économie sont devenus
aujourd’hui des idées reçues, fondamentalement tenues pour incontestables. Pourtant,
à chaque crise économique majeure, l’économie traditionnelle du laisser-faire a
pris de nouveaux coups. Dans la période qui va, en gros, de 1933 à 1979, tous
les gouvernements ont inversé leur politique et adopté une version du
keynésianisme, en jouant les nounous, et en amorçant la pompe par un déficit
massif pendant les récessions.
En outre,
les composantes des sciences sociales qui revendiquent le plus un statut
«scientifique» -la «théorie du choix rationnel», par exemple- partent des mêmes
postulats que les économistes sur la psychologie humaine: la meilleure
interprétation des êtres humains est de les voir comme des agents intéressés
qui, dans toutes les situations, calculent la façon d’obtenir les meilleurs
termes possibles, le plus de profit, de plaisir ou de bonheur pour le moins de
sacrifice ou d’investissement. C’est curieux, puisque les psychologues expérimentaux
n’ont cessé de montrer et de démontrer que ces postulats sont faux.
L’auteur
danois Peter Freuchen raconte qu’un jour, rentré bredouille et affamé d’une
expédition de chasse au morse chez les Inuits du Groenland, il découvrit que
l’un de ceux qui avaient fait bonne chasse avait déposé plusieurs centaines de
livres de viande. Il se répandit en remerciements. L’homme réagit avec
indignation: «dans notre pays nous sommes humains! Et donc, nous nous
entraidons. Nous n’aimons pas entendre dire merci pour cela. Ce que j’ai
aujourd’hui, tu peux l’avoir demain. Ici, nous disons qu’avec les cadeaux on
fait des
esclaves, et
qu’avec les fouets on fait des chiens».
Il existe
trois grands principes moraux susceptibles de fonder les relations économiques,
tous trois à l’œuvre dans toute société humaine. Je les appellerai le communisme,
la hiérarchie et l’échange.
Le communisme: tout rapport humain fondé sur le principe « de
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Rien à voir avec le
régime de l’URSS, de la Chine ou de Cuba. Ni avec le mythe du jardin d’Eden. En
réalité, le « communisme » n’est pas une utopie magique et n’a rien à voir avec
la propriété des moyens de production. Tout le monde agit en communiste une
bonne partie de son temps. Personne n’agit en communiste tout le temps. Si une
canalisation s’est rompue et que celui qui la répare dise : « passe-moi la clé
anglaise », son collègue ne répondra pas, en général : « et qu’est-ce que
j’aurai en échange ? » - même s’ils travaillent pour ExxonMobil, Burgerking ou
Goldmann Sachs. C’est une question d’efficacité. Au lendemain immédiat des grands
désastres –inondations, pannes d’électricité géantes ou effondrements de
l’économie- les gens se comportent souvent de la même façon : ils reviennent à
un communisme basique. Le communisme est le fondement de toute société humaine.
C’est ce qui rend la société possible. Non seulement personne ne compte, mais
l’idée même de compter paraîtrait blessante, ou extravagante.
L’échange. C’est un aller et retour entre deux parties dont
chacun donne autant qu’elle reçoit.
Dans le cas
de l’échange commercial, dès que l’objet a changé de mains, les deux personnes
ne s’attendent plus à entretenir le moindre rapport. Dans un échange de dons,
l’affaire peut tourner à la compétition : si j’invite un économiste libéral à
un dîner coûteux, ce théoricien va-t-il se sentir un peu diminué
–inconfortablement redevable à mon égard- tant qu’il n’aura pas pu rendre la
politesse ? Pourquoi, s’il se sent en compétition avec moi, sera-t-il enclin à
m’emmener dans un endroit encore plus cher ?
La hiérarchie. Les relations hiérarchiques- celles qu’entretiennent
au moins deux parties dont l’une est tenue pour supérieure à l’autre- ne
reposent absolument pas sur la réciprocité (même si elles sont parfois «
justifiées » par des formules réciproques : « les paysans fournissent
l’alimentation, les seigneurs la protection »). Les relations sont régulées par
un tissu d’habitudes ou de coutumes. Quiconque obtient d’immenses richesses
finit toujours par en donner au moins une partie. Plus cette richesse est issue
du pillage ou de l’extorsion, plus sa
redistribution
prendra des formes somptueuses et autoglorificatrices. Dans les Etats antiques,
les monarques se posaient presque invariablement en défenseurs des faibles, de
la veuve et de l’orphelin et champion des pauvres. La généalogie de l’Etat
redistributeur moderne ne remonte pas à une forme de « communisme primitif »,
mais, en dernière analyse, à la violence et à la guerre.
Nous sommes
tous des communistes avec nos amis intimes et des seigneurs féodaux avec les
petits enfants. Une dette nécessite d’abord une relation entre deux personnes
qui sont des égales au moins potentielles, et qui ne sont pas actuellement sur
un pied d’égalité, mais pour lesquelles il y a moyen de rééquilibrer les
choses. Tant que la dette n’est pas remboursée, c’est la logique de la
hiérarchie qui s’applique.
Dans toutes
les langues indo-européennes, les mots qui signifient «dette» sont des
synonymes de ceux qui veulent dire «péché» ou «culpabilité», ce qui illustre
les liens entre la religion, le paiement et la médiation entre les sphères du
sacré et du profane par la «monnaie».
Geld,
monnaie en allemand; Geild, indemnité ou sacrifice en vieil anglais; Gild,
impôt en gothique; Guilt,culpabilité en anglais. Payer vient à l’origine d’un
terme qui signifie «pacifier, apaiser». Le mot allemand Schuld signifie à la
fois «dette» et «culpabilité». Le mot «liberté», dans la Bible comme en
Mésopotamie, signifiait avant tout «libération des effets de la
dette».
Et on part
pour balayer 5000 ans d’histoire...
Le cycle
dette à esclavage à tensions sociales à effacement des dettes à dette...
En 2400 av.
J.-C. il était déjà courant de voir des administrateurs locaux, ou de riches marchands,
consentir aux paysans en difficulté financière des prêts garantis par un nantissement,
puis s’approprier peu à peu leurs biens s’ils ne pouvaient pas rembourser. Ils
commençaient en général par le grain, les moutons, les chèvres et les meubles,
puis passaient aux champs et aux maisons, ou, à ce même stade ou en dernier
recours, aux membres de
la famille.
Les serviteurs, s’il y en avait, s’en allaient vite, suivis par les enfants,
les épouses et, dans quelques cas extrêmes, jusqu’à l’emprunteur lui-même. Tous
étaient réduits à l’état de péons, pas tout-à-fait des esclaves mais presque,
contraints à servir à perpétuité dans la maison du créancier. Les effets
étaient tels qu’ils menaçaient souvent la société d’éclater. Aussi, les rois
sumériens, puis babyloniens, annonçaient périodiquement des amnisties générales:
la dette était effacée, les péons étaient autorisés à rentrer chez eux.
L’Egypte a
elle aussi pratiqué la prison pour dette, et l’effacement périodique des dettes
(le texte de la fameuse pierre de Rosette, qui a donné la clé permettant de
traduire les hiéroglyphes, annonçait une amnistie des débiteurs et des
prisonniers, décrétée par Ptolémée V en 196 av. J.-C.). Tout indique que
l’esclavage, exceptionnellement apte à arracher des êtres humains à leur
contexte, à les muer en abstractions, a partout joué un rôle crucial dans
l’essor des marchés.
Comment
devient-on esclave? Un sociologue égyptien, Elwahed, en 1931, après une vaste
étude historique, répond: on devient esclave dans des situations où, sans cela,
on serait mort: parce qu’on a été capturé à la guerre, ou victime d’un raid ou
d’un rapt; par une sanction judiciaire pour un crime (entre autres, pour
dettes); par l’autorité paternelle (le père –sur le point de mourir de faim-
vend ses enfants); par la vente volontaire de soi-même (quand on est sur le
point de mourir de faim).
Dans les
premiers textes sumériens, en particulier ceux qui datent, en gros, de 3000 à
2500 av. J.-C., les femmes sont partout –souveraines, médecins, marchands,
scribes, fonctionnaires. Dans le millénaire qui suit, tout change. La place des
femmes dans la vie civique s’érode. Peu à peu, la structure patriarcale qui
nous est familière prend forme, avec son insistance sur la chasteté et la
virginité avant le mariage, l’affaiblissement et, finalement, la disparition
totale du rôle des femmes dans l’Etat et les professions libérales, et la perte
de leur indépendance
juridique,
qui fait d’elles les pupilles de leur mari. Vers 1200 av. J.-C., nous
commençons à voir quantité de femmes séquestrées dans des harems et (dans
certains endroits du moins) assujetties au port obligatoire du voile.
Le monde des
épopées homériques est dominé par des guerriers héroïques qui méprisent le
commerce. Tout changea radicalement quand les marchés commerciaux commencèrent
à se développer, 200 ans plus tard. L’un des premiers effets de l’arrivée d’une
économie commerciale a été une série de crises de la dette comme en connaissaient
depuis longtemps la Mésopotamie et Israël. «Les pauvres, leurs femmes et leurs
enfants étaient les esclaves des riches», résume Aristote. Des factions
révolutionnaires sont apparues, elles ont exigé des
amnisties,
et la plupart des cités grecques sont tombées, au moins pour un temps, sous la
coupe de dictateurs populistes portés au pouvoir, notamment, par l’exigence
d’un allègement radical des dettes. Mais par la suite, les cités grecques se
sont tournées vers une politique d’expansion: elles ont embarqué les enfants
des pauvres sur des navires pour qu’ils aillent fonder des colonies grecques
outre-mer. Très vite, tout le littoral de la Crimée à Marseille a été ponctué
de cités grecques, qui ont servi de conduit à un commerce d’esclaves très
actif.
(Même Platon,
capturé en mer, avait été mis aux enchères sur le marché d’Egine; il dut sa
liberté à un philosophe libyen qui se trouvait là et paya sa rançon...).
L’abondance
soudaine des esclaves possédés en pleine propriété a transformé du tout au tout
la société grecque. Elle a permis même à ses membres les moins fortunés de
prendre part à la vie politique et culturelle de leur cité et d’acquérir un
véritable sentiment de citoyenneté. Et elle a conduit les vieilles classes
aristocratiques à prendre leurs distances avec la vulgarité et la corruption
morale qui leur paraissaient caractériser le nouvel Etat démocratique. Les
aristocrates mettaient un monde du don, de la générosité et de l’honneur
au-dessus de
l’échange
commercial sordide. L’honneur d’une femme se définissait presque exclusivement
en termes sexuels : une question de virginité, de pudeur et de chasteté.
L’habitude assyrienne du voile n’a pas fait tache d’huile au Moyen-Orient, mais
elle a été adoptée en Grèce (cela dût-il contredire complètement nos clichés
sur l’origine des libertés «occidentales»...).
Si l’œuvre
de Platon montre combien la confusion morale née de la dette a modelé en
profondeur nos traditions de pensée, le droit romain révèle à quel point elle a
façonné nos institutions, jusqu’aux plus familières. La notion de propriété
privée absolue dérive en réalité de l’esclavage. Les droits sont fondés en
dernière analyse sur des accords entre personnes. On peut imaginer la propriété
non comme une relation entre des personnes, mais comme une relation entre une
personne et une chose, quand on part d’une relation entre deux personnes dont
l’une est aussi une chose (c’est ainsi que l’esclave était défini en droit
romain: c’était une
personne qui
était aussi une res, une chose.) Le
mot dominium, qui signifie propriété
privée absolue, n’apparaît en latin qu’à la fin de la République, au moment où
des centaines de milliers de travailleurs captifs sont déportés en Italie, et
où Rome commence à devenir une véritable société esclavagiste. Les juristes
romains ont pris un principe d’autorité domestique, de pouvoir absolu sur les
personnes –celle du paterfamilias-, puis défini certaines de ces personnes (les
esclaves) comme des choses, et enfin étendu la logique aux oies, aux chars, aux
granges, aux coffrets à bijoux... C’était tout à fait extraordinaire, même dans
le monde antique, qu’un père ait le droit d’exécuter ses esclaves –sans parler
de ses enfants.
La toute
première législation en matière de dette autorisait les créanciers à exécuter
les débiteurs insolvables. Mais l’élite romaine a fini par comprendre qu’avec
des paysans libres on a une armée plus efficace, et que les armées conquérantes
peuvent ramener des prisonniers de guerre capables de faire tout ce que
faisaient jusque- là les «asservis pour dettes». L’esclavage pour dette a été
interdit, une partie des fruits de l’empire a été utilisée pour payer des aides
sociales. On trouva des esclaves dans tous les foyers.
Les
invasions barbares qui ont remplacé l’empire ont prolongé cette situation: les
nobles étaient les descendants des conquérants germaniques, et le commun peuple
était intrinsèquement à leur service. Et pour finir, ces mêmes idées ont servi
de base à l’institution essentielle qui domine notre vie économique actuelle:
le travail salarié, qui est, de fait, la location de notre liberté, au même
titre que l’esclavage peut être conçu comme sa vente.
Aux yeux
d’un Grec antique, la distinction entre un esclave et un travailleur salarié
endetté aurait sûrement fait figure, au mieux, de subtilité juridique.
Remarque en
passant. La presse ne parle de «violation des droits humains» que lorsqu’on
voit des Etats interférer avec la personne ou les biens d’une victime- par
exemple en violant, en torturant ou en tuant. Mais on ne lit jamais que des
Etats commettent des «violations des droits humains» quand ils suppriment le
soutien au prix des denrées de base, même si cette mesure répand la
malnutrition, ni quand ils rasent des bidonvilles ou chassent les sans-domicile
fixe de leurs abris de fortune.
L’Age axial
(800 av. J.-C.-600 ap. J.-C.)
Des
personnages comme Pythagore (570-495 av. J.-C.), Bouddha (563-483 av. J.-C.) et
Confucius (551-479 av.J.-C.) ont vécu exactement à la même époque, et pendant
cette période, la Grèce, l’Inde et la Chine ont connu en même temps une
soudaine floraison entre écoles intellectuelles rivales, sans qu’aucune de ces
régions, apparemment, ait eu connaissance de l’existence des autres. Pour le
seul règlement des soldes, l’armée d’Alexandre le Grand, qui comptait environ
120000 hommes, nécessitait une demi-tonne d’argent métal par jour. Dans ces
conditions, la conquête signifiait réorganisation du
système
perse d’extraction minière et de monnayage en vue de la satisfaction des
besoins de l’armée d’invasion; et les mines antiques, bien sûr, fonctionnaient
avec des esclaves, dont la plupart étaient des prisonniers de guerre.
En Inde,
Ashoka commença son règne par une guerre de conquête: en 265 av. J. –C., il
détruisit les Kalingas, l’une des dernières républiques restantes, au cours
d’un conflit où des centaines de milliers de personnes furent tuées ou réduites
en esclavage. Il renonça ensuite totalement à faire la guerre et se convertit
au bouddhisme.
Dans les
économies humaines, chacun sait que les motivations sont complexes. Quand un
seigneur fait un don à un vassal, il n’y a aucune raison de douter qu’il est
inspiré par un désir authentique de l’aider, même s’il s’agit aussi d’un geste
stratégique conçu pour s’assurer la loyauté du bénéficiaire et d’un acte de
magnificence visant à rappeler à tous qu’il est grand et que le vassal est
petit. De même, les dons entre égaux sont en général chargés de multiples
couches d’amour, de jalousie, d’orgueil, de dépit, de solidarité communautaire
et de bien d’autres sentiments encore. Les transactions au comptant entre
étrangers, c’est autre chose.
Evaluer la
qualité et s’efforcer de faire une excellente affaire: ces transactions se
réduisent réellement à cela. Pendant l’Age axial, elles ont engendré une nouvelle
façon de penser les motivations humaines, une approche radicalement simplifiée
qui a permis de commencer à user de concepts comme «profit» et «avantage» -et
d’imaginer que c’est cela que les gens
recherchent
vraiment dans tous les domaines. Ce postulat implicite ressemble beaucoup à
ceux des économistes actuels, mais il y a une différence: en ces temps où la
monnaie, les marchés, les Etats et le militaire étaient intrinsèquement liés,
il n’est jamais venu à l’idée de personne qu’il fût possible d’atteindre des
objectifs intéressés par des moyens pacifiques...
Une sorte de
division idéale des sphères d’activité humaine, qui dure jusqu’à nos jours, a
pris naissance pendant l’Age axial : d’un côté le marché, de l’autre la
religion. Si l’on consacre un espace social précis exclusivement à
l’acquisition intéressée de biens matériels, il est pratiquement inévitable
que, très vite, quelqu’un vienne délimiter un autre espace où il prêchera que,
du point de vue des valeurs ultimes, les biens matériels n’ont pas
d’importance, que l’intérêt personnel ou même le moi sont des illusions et
qu’il vaut mieux donner que recevoir. La pure cupidité et la pure générosité
sont des concepts complémentaires
; les deux
sont apparus ensemble partout où est également entré en scène la monnaie physique,
impersonnelle, faite pour payer comptant.
Les seules
collectivités qui aient réussi à abolir l’esclavage dans le monde antique ont
été des sectes religieuses comme les Esséniens –et elles l’ont fait,
concrètement, en se retirant de l’ordre général de la société pour constituer
leurs propres communautés utopiques.
Les
monastères bouddhistes continuent à fonctionner selon les procédés de recherche
du consensus qui existaient dans les cités-Etats démocratiques de l’Inde du
Nord (qui, elles, ont été éliminées par les grands empires), préservant ainsi
un certain idéal démocratique et égalitariste qui, sans eux, auraient été
totalement oublié.
Quand ces
mouvements se sont enracinés, les choses ont commencé à changer. Les guerres
sont devenues moins brutales et moins fréquentes. L’esclavage s’est évanoui en
tant qu’institution, jusqu’à devenir, au Moyen-Age, insignifiant ou même
inexistant dans l’essentiel de l’Eurasie. Partout aussi, les nouvelles
autorités religieuses ont commencé à s’attaquer sérieusement à la désagrégation
sociale causée par la dette.
Le Moyen Age
(600-1450)
Le Moyen Age
a été la période où les deux institutions –marchés des biens et religions
mondiales universelles-ont commencé à fusionner. L’un des effets a été de
maîtriser, ou même interdire, le crédit prédateur. Un autre a été le retour à
diverses formes de monnaie virtuelle de crédit. Pour la plupart des habitants
de la planète, cette époque ne pouvait apparaître que comme une amélioration extraordinaire
après les terreurs de l’Age axial (n’oublions pas que les cités antiques ne
pouvaient se maintenir qu’en pompant les ressources des campagnes. La Gaule
romaine, par exemple, était un réseau de cités liées par les célèbres voies
romaines à une interminable succession de plantations esclavagistes qui
appartenaient aux notables urbains). Si opprimés qu’aient pu être les serfs
médiévaux, leur triste sort n’était rien comparé à celui de leurs homologues de
l’Age axial. Les pièces de monnaie romaine ont cessé de circuler. Le métal a
fini, pour l’essentiel, dans les établissements religieux, les églises, les
monastères et les temples, soit entreposé dans les trésors, soit coulé en
autels et en
objets du
culte. Et surtout il a servi à faire des statues des dieux.
En Inde, une
très grande partie de la population peine en situation de péonage pour un
propriétaire foncier ou un autre créancier. Mais l’islam apparaît vers l’an
1000, et est bien décidé à supprimer complètement l’usure.
Les autorités
chinoises étaient confrontées aux invasions répétées des peuples nomades du
Nord, et à l’agitation populaire permanente, qui opérait à une échelle inconnue
ailleurs dans l’histoire de l’humanité. En 9 ap. J.-C., un haut responsable
confucéen, Wang Mang, s’empare du trône pour régler une crise nationale de la
dette. Il réforme la monnaie, nationalise de grands domaines, promeut des
industries d’Etat, et interdit la détention privée d’esclaves. Mais l’histoire
ultérieure de la Chine regorge d’histoires du même type: inégalité massive,
désordres,
commissions d’enquête officielles, mesures d’allègement des dettes, secours
contre les famines, lois contre la vente des enfants. L’Etat confucéen s’est
vite fait l’actif promoteur des marchés, et les marchés ont été plus développés
en Chine que partout ailleurs. Les confucéens étaient pour le marché (moyen d’échanger
des marchandises en passant par
la monnaie:
M-A-M’), mais contre le capitalisme (art d’utiliser la monnaie pour en avoir
plus encore: A-M-A’).
Vu sous cet
angle, la Chine a été, presque tout au long de son histoire, l’Etat de marché
anticapitaliste par excellence. Elle a maintenu le niveau de vie le plus élevé
du monde (n’étant dépassée, par l’Angleterre, que dans les années 1820).
Le
Proche-Occident: l’Islam.
Pendant
l’essentiel du Moyen-Age, le centre nerveux de l’économie mondiale a été le monde
musulman. Du point de vue de toutes les autres traditions, la différence entre
christianisme et islam est quasiment insignifiante. L’islam médiéval
s’enthousiasmait pour le droit, mais voyait l’Etat comme une regrettable
nécessité que les esprits pieux feraient bien d’éviter. Les chefs militaires
arabes n’ont jamais cessé de se percevoir comme des habitants du désert.
Le Califat a
créé des armées de métier, et a employé des esclaves comme soldats, phénomène
historique sans précédent. Mais le système juridique créé par les religieux, le
droit islamique, interdisait de réduire en esclavage un musulman (ainsi
d’ailleurs que les sujets chrétiens ou juifs du Califat), et s’est attaqué aux
abus les plus notoires de la période antérieure. Il a interdit l’usure (prêt
avec intérêt), mais les juristes islamiques prenaient soin d’autoriser
certaines commissions rémunérant des services, ainsi que d’autres dispositions
garantissant que banquiers et négociants auraient malgré tout une incitation à
prêter. Une alliance très particulière entre les marchands et le peuple s’est
constituée contre l’Etat. L’islam, en effet,
avait une
vision positive du commerce. L’économie s’est développée sur la base du crédit,
au sens de la confiance, de la réputation. L’islam prenait au sérieux un
principe qui serait plus tard consacré dans la théorie économique classique,
mais très inégalement respecté en pratique: le profit est la récompense du
risque. La vénération du marchand s’accompagnait de la première idéologie
populaire du libre marché apparue dans le monde. Affranchi de ses fléaux
antiques, la dette et l’esclavage, le bazar local était devenu pour la plupart
des
gens la plus
haute expression de la liberté humaine et de la solidarité communautaire, qu’il
fallait donc protéger activement des intrusions de l’Etat. «Les prix dépendent
de la volonté de Dieu». Adam Smith s’en est inspiré. La diffusion de l’islam a
fait du marché un phénomène mondial, qui opérait pour l’essentiel
indépendamment des Etats, selon ses propres lois internes.
L’extrême-Occident:
la chrétienté (commerce, crédit et guerre)
Comme les
Etats centralisés avaient disparu, la réglementation du marché était de plus en
plus assurée par l’Eglise. L’usure était vivement condamnée par les Ecritures.
Pour saint Basile, le communisme des apôtres –qui avaient mis en commun tout ce
qu’ils possédaient et qui prenaient librement ce dont ils avaient besoin- était
le seul modèle convenable pour une société vraiment chrétienne. Cependant, si
pour les autres Pères de l’Eglise, le communisme était bien l’idéal, il était
irréaliste, dans ce monde déchu et transitoire. Et si le Deutéronome dit: «tu
prêteras sans intérêt à ton frère», il dit aussi: «à l’étranger tu pourras
prêter à intérêt». Beaucoup soutenaient qu’on ne peut être à la fois marchand
et chrétien.
Là où les
penseurs perses et arabes voyaient le marché apparaître dans le prolongement de
l’entraide, les chrétiens n’ont jamais surmonté leurs doutes à propos du
commerce. La dette était bel et bien le péché –du créancier comme du débiteur.
La concurrence, inhérente à la nature du marché, c’était une guerre non armée
(en général). Les mots signifiant «troquer», «échanger», dérivaient dans toutes
les langues européennes de termes signifiant «truquer», «arnaquer», «embobiner»
ou «tromper». Les cadets de la petite noblesse, ne pouvant hériter, se
regroupaient pour chercher fortune : soit dans des bandes errantes de malfrats
toujours en quête de pillage, soit pour faire la guerre (les Croisades)...
Si l’Age
axial a été celui du matérialisme, le Moyen-âge a été surtout celui de la transcendance.
L’effondrement des empires antiques n’a pas conduit, en général, à la naissance
d’autres empires. Ce sont des mouvements religieux autrefois subversifs qui ont
été catapultés en position d’institutions dominantes. L’esclavage a diminué ou
disparu, le rythme de l’innovation technologique s’est accéléré ; un monde plus
pacifique a offert plus de
possibilités
à la circulation des soieries et des épices, mais aussi des personnes et des
idées.
Notre image
du Moyen-âge comme «âge de la foi» -donc de l’obéissance aveugle à l’autorité –
est un héritage des Lumières françaises. Elle n’a de sens que si on pense le Moyen-âge
comme un phénomène qui s’est produit essentiellement en Europe. Non seulement
l’Extrême-Occident était une région singulièrement violente à l’aune des normes
mondiales, mais l’Eglise catholique était d’une intolérance extraordinaire («sorcières»
brûlées vives, massacre d’hérétiques, ...). Juridiquement, notre notion de
compagnie est un produit du haut Moyen-âge européen. Ce qui a préparé le terrain
pour le capitalisme au sens courant du terme, c’est le début de
l’auto-organisation des marchands en corps éternels, en vue de s’assurer des
monopoles, de droit ou de fait, et d’esquiver les risques ordinaires du commerce.
L’âge des
grands empires capitalistes (1450-1971)
XVème siècle
en Europe: peste noire, guerres endémiques, affaissement de l’économie
commerciale, avancée de l’empire ottoman en Europe centrale; en même temps, du
point de vue de beaucoup de paysans ordinaires et de simples travailleurs des
villes, c’est la meilleure des époques: hausse des salaires, les jours fériés
sont le tiers, voire la moitié de l’année, c’est l’apogée de la vie festive... Au
fil des siècles suivants, tout cela devait être détruit.
Tout a
commencé par une inflation massive: en Angleterre, par exemple, de 1500 à 1650,
les prix ont augmenté de 500 %, et les salaires ont augmenté beaucoup moins
vite, en cinq générations, ils sont tombés à 40 % de leur niveau initial. L’explication
favorite est le gigantesque flux d’or et d’argent qui s’est déversé en Europe
après la conquête du
Nouveau
Monde. Elle ne tient pas. Car en fait, l’essentiel de l’or a fini dans les
temples indiens, et l’écrasante majorité des lingots d’argent ont été expédiés
en Chine.
Le fonds de
l’histoire, c’est que vers 1450, sous les Ming, la Chine a abandonné l’usage du
papier-monnaie, au profit de l’argent métal, tout en revenant à sa vieille
politique: encourager les marchés et intervenir uniquement pour interdire toute
concentration indue de capital. Les marchés chinois ont alors connu un essor
formidable, et la Chine a du importer massivement l’argent de l’Amérique latine
(en y exportant de la soie, de la porcelaine et d’autres marchandises). Ce qui
a vraiment provoqué l’inflation en Europe, c’est que les maîtres ultimes des
lingots –les Etats, les banquiers, les gros commerçants- ont utilisé leur
mainmise sur le métal (il était obligatoire de payer le fisc en métal) pour
commencer à changer les règles du jeu, d’abord en posant que l’or et l’argent
étaient la monnaie, puis en introduisant à leur usage de nouvelles formes de
monnaies de crédit, tout en minant et détruisant lentement les systèmes locaux
fondés sur la confiance qui permettaient aux petites collectivités, dans toute
l’Europe,
d’opérer pour l’essentiel en se passant de monnaie métallique. Les soulèvements
qui s’en sont ensuivis ont été écrasés, les vagabonds ont été expédiés dans les
colonies, enrôlés dans les armées, ou mis au travail dans des usines sur le
territoire national. Ce processus a été mené à bien par une manipulation de la
dette.
Cortès
venait de réaliser le vol peut-être le plus colossal de l’histoire du monde (le
trésor des Aztèques), accompagné de la mort de peut-être 100000 Aztèques, et la
destruction de Tenochtitlan, l’une des plus grandes villes du monde. Mais il
accumulait toujours de nouvelles dettes. En 1626, ses créanciers commencèrent à
saisir ses biens. Quelques années plus tard, il en était réduit à mettre en
gage les bijoux de sa femme pour financer une série d’expéditions en
Californie, où il espérait refaire fortune. Celles-ci s’étant révélées non
rentables, il dut rentrer en Espagne présenter une requête à l’empereur. Le
capital financier qui a soutenu ces expéditions venait de Gènes. La relation
-entre l’audacieux aventurier, le
joueur prêt
à prendre toutes sortes de risques, d’un côté, et de l’autre le financier
prudent dont toutes les opérations s’organisent autour de la production d’une
croissance inexorable, mathématique et soutenue de son revenu-, cette relation
est au cœur même de ce que nous appelons aujourd’hui le «capitalisme».
Pour
l’exploitation des mines d’or et d’argent, par les Indiens survivants, les
colons se sont mis d’accord pour une politique de péonage: décréter des impôts
élevés, prêter de l’argent à intérêt à ceux qui ne pouvaient pas les payer,
puis exiger le remboursement de ces prêts par le travail. Charles Quint
(lui-même très endetté à l’égard des banques de Florence, Gènes et Naples)
tentait d’agir en protecteur des Indiens, mais cela ne changeait rien.
[Graeber
remarque: notons la ressemblance gênante avec la politique mondiale actuelle,
où les Nations-Unies, par exemple, appellent les pays pauvres à rendre
l’éducation gratuite et accessible à tous, après quoi le Fonds Monétaire
International (qui, juridiquement, est une
composante
des Nations-Unies) exige que ces mêmes pays fassent exactement le contraire,
qu’ils imposent des frais de scolarité dans le cadre de «réformes économiques»
générales, et en fait une condition du refinancement de leur dette.]
L’argent a
toujours le potentiel de devenir lui-même un impératif moral. Permettez-lui de
s’étendre, et il pourra vite devenir une morale si impérative que toutes les
autres paraîtront futiles en comparaison. Pour le débiteur, le monde est réduit
à un ensemble de dangers potentiels, d’instruments potentiels et de
marchandises potentielles. Même les relations humaines deviennent une question
de calcul coût/avantages. C’est ainsi, manifestement, que
les
conquistadores voyaient les mondes qu’ils partaient conquérir. Dans le nouvel
ordre capitaliste émergent, la logique monétaire s’était vu accorder
l’autonomie; les pouvoirs
politique et
militaire se sont ensuite progressivement organisés autour d’elle.
Luther a
entamé sa carrière de réformateur par des campagnes féroces contre l’usure. Des
réformateurs plus radicaux sont apparus, qui ont commencé à remettre en cause
la légitimité même du privilège aristocratique et de la propriété privée. Des
rebelles, voulant rétablir le vrai communisme des Evangiles, se sont soulevés.
Plus de 100000 ont été massacrés. Luther a rectifié son discours, et admis que,
si l’usure est un péché, un taux d’intérêt de 4% à 5 % est actuellement légal
dans certaines circonstances, et qu’il fallait respecter la loi. Calvin admit
qu’un taux
d’intérêt raisonnable (en général 5 %) n’était pas un péché, du moment que les
prêteurs agissaient de bonne foi, ne faisaient pas du prêt d’argent leur
activité principale et n’exploitaient pas les pauvres. Les penseurs protestants
ont argumenté que l’intérêt est une indemnisation pour la somme que le prêteur
auraitgagnée s’il avait pu consacrer son argent à un investissement plus
rentable (mais ainsi, la croissance de l’argent devenait un phénomène attendu,
toute somme était censée être un capital). En outre, le postulat voulant que l’usure
se pratique à bon droit contre ses ennemis, donc, par extension, que tout
commerce soit en partie de même nature que la guerre, ne disparaît jamais
entièrement. Ouvrir ainsi les vannes revenait à suggérer qu’on pouvait traiter
n’importe qui, même un voisin, en étranger. L’idée que se faisaient les paysans
de la fraternité communiste ne venait pas du néant. Elle était ancrée dans leur
expérience quotidienne concrète: l’entretien des communaux –champs et forêts-,
la coopération de tous les jours, la solidarité entre voisins. C’est tout aussi
vrai des membres de l’aristocratie, qui savaient faire bloc quand cela comptait
réellement. Le «communisme des riches» est une force puissante dans l’histoire
de l’humanité.
Un siècle
après Luther, Hobbes scandalise ses lecteurs en attaquant l’idée selon laquelle
la société est bâtie sur des liens préalables de solidarité communautaire, et
en prétendant que toute vie humaine peut s’expliquer comme une recherche de
l’intérêt personnel. Et c’est pourtant sur ce postulat qu’il aura été possible
d’édifier toutes les équations de la théorie économique. Mais sous le
déguisement d’une mathématique impersonnelle, se cache
l’idée de
désirs insatiables, car qu’est-ce que l’intérêt, sinon l’exigence que l’argent
ne cesse jamais de croître? Or, comme Augustin l’avait déjà anticipé, des
désirs infinis dans un monde fini signifient une rivalité sans fin. Notre
unique espoir de paix sociale est celui que préconisait Hobbes: des accords
contractuels que l’appareil d’Etat fera strictement respecter.
L’histoire
des origines du capitalisme n’est pas celle de la destruction graduelle des
communautés traditionnelles par le pouvoir impersonnel du marché; c’est plutôt
l’histoire de la conversion d’une économie du crédit en économie de l’intérêt.
En 1700, à
l’aube du capitalisme moderne, existe un gigantesque appareil financier de
crédit et de dette qui opère en pompant toujours plus de travail et en
produisant ainsi un volume de biens matériels en expansion constante. A aucun
moment le capitalisme n’a été organisé essentiellement autour d’une main
d’œuvre libre (esclavage de masse en Amérique, régimes coloniaux d’Afrique et
d’Asie du Sud-Est, suzerains britanniques en Inde, péons
endettés,
...).
Dans presque
toute l’Europe du Nord médiévale, le travail salarié avait été essentiellement
lié à une période précise du cycle de vie. De 12-14 ans à 28-30 ans, tout le
monde était censé servir comme employé dans la maison d’un autre, en attendant
d’avoir accumulé assez de ressources pour se marier et fonder son propre foyer.
La «prolétarisation»
a d’abord revêtu ce sens précis: des millions de jeunes, hommes et femmes, se
sont trouvés bloqués de fait dans une sorte d’adolescence permanente. Ces
apprentis et compagnons n’ont jamais pu devenir des «maîtres», donc ne sont
jamais devenus adultes.
Début d’une
ère encore indéterminée (1971-?)
Aujourd’hui
comme hier, la monnaie moderne repose sur la dette de l’Etat, les Etats
empruntent pour financer des guerres. En décidant que les dollars détenus à
l’étranger ne seraient plus convertibles en or, Nixon provoqua un transfert de
richesses massif des pays pauvres qui n’avaient pas de réserves d’or, aux pays
riches comme les Etats-Unis et
la
Grande-Bretagne, qui en avaient. Les dollars créés par les banques ont remplacé
l’or comme monnaie de réserve mondiale, ce qui a eu pour les Etats-Unis
d’immenses avantages économiques. Les banques centrales étrangères ne pouvaient
guère faire autrement que d’utiliser leurs dollars pour acheter des bons du
Trésor américain. La dette nationale des Etats-Unis est devenue une promesse,
faite à leur peuple mais aussi à toutes les nations de
la terre,
dont chacun sait qu’elle ne sera jamais tenue. Ce qui n’empêche pas les
Etats-Unis d’imposer aux autres pays des politiques monétaires restrictives, et
de rembourser scrupuleusement leurs dettes. Le FMI y veille. Mais sa politique
–exiger que la dette soit remboursée par des fonds pris presque exclusivement dans
les poches des pauvres- s’est heurté à un mouvement de révolte mondiale (le
mouvement dit «antimondialisation», bien que ce nom soit tout-à-fait trompeur),
suivi par une révolte budgétaire directe en Asie Orientale et en Amérique
latine. Puis est venu l’effondrement presque total du secteur financier
américain: l’impérialisme de la dette ne pouvait même plus prétendre qu’il
garantissait la stabilité.
L’irruption
directe de la Chine parmi les grands détenteurs de bons du Trésor des
Etats-Unis a modifié la dynamique. Tout porte à croire que, du point de vue
chinois, ce qui se passe est la première étape d’un long processus visant à
réduire les Etats-Unis à un statut proche de celui de l’Etat-client
traditionnel de la Chine.
Pour
commencer à nous libérer, la première chose à faire est de nous voir à nouveau
en acteurs de l’histoire, capable de faire une différence dans le cours des
événements mondiaux.
Nous devons
bel et bien aux autres tout ce que nous sommes. S’il nous fallait imaginer ce
que nous leur devons comme une dette, elle ne pourrait être qu’infinie. Mais
est-il vraiment raisonnable de penser cela comme une dette?
En fait,
nous n’avons pas «tous» à payer nos dettes. Seulement certains d’entre nous.
Rien ne serait plus bénéfique que d’effacer entièrement l’ardoise pour tout le
monde, de rompre avec notre morale coutumière et de prendre un nouveau départ.
Source : https://local.attac.org/attac92/IMG/pdf/ndl_jpa_201407_23_dette_5000_ans_d_histoire_david_graeber.pdf