Si l’on définit la participation comme un mode d’association des citoyens à la
prise de décision publique non médiée par des représentants élus, alors deux types
de dispositifs peuvent être qualifiés de participatifs dans l’Inde contemporaine.
Le premier est la gram sabha (assemblée du village) qui doit réunir, au moins
deux fois par an, tous les adultes du village pour donner son avis sur diverses
décisions que doit prendre le gram panchayat (conseil du village) [1] composé de
représentants élus. Le deuxième rassemble des programmes de concertation,
au sujet des services urbains, entre associations de quartier et administration
locale, dont l’exemple le plus connu est le programme Bhagidari (« partenariat »)
à Delhi [2] Ces deux types de dispositifs ont pour objectifs la délibération des
citoyens autour de certains types d’action publique, la consultation des citoyens
par les instances en charge de la mise en œuvre de cette action et la surveillance
de ces instances par les citoyens. Ils sont caractérisés par leur nature locale, de
par leur objet, leur mode de fonctionnement et les populations concernées.
Le niveau d’institutionnalisation de ces deux types de dispositifs est toutefois
différent : la gram sabha fait partie de la politique de décentralisation adoptée
(par deux amendements à la Constitution) en 1992 et mise en œuvre par les
différents États indiens à partir de 1994 ; alors que le programme Bhagidari
a été lancé dans la ville-État de Delhi en 2000 par la Ministre-en-chef, Sheila
Dixit, et reste étroitement associé à cette femme politique [3] Mais si la mise
en œuvre de ces dispositifs est relativement récente, l’idée d’une démocratie
locale permettant la participation directe des citoyens à la prise de décision
est, elle, beaucoup plus ancienne. La première partie de cet article retracera
l’itinéraire de cette idée portée par différents leaders et partis politiques, du
Mahatma Gandhi (dans les années 1930) à Rajiv Gandhi (dans les années 1990).
La deuxième partie analysera les fluctuations, au cours de cette histoire, du
contenu de cette idée de participation et notamment son va-et-vient entre
une interprétation « politique » et une interprétation « apolitique ». Enfin, la
troisième partie décrira la synthèse opérée entre ces deux interprétations dans
les années 1990, alors que l’idée d’une forme directe de démocratie locale est
enfin mise en œuvre dans les villages, mais aussi dans les villes.
ITINÉRAIRE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE VILLAGEOISE
L’idée d’une forme directe de démocratie locale se décline essentiellement,
jusqu’à la fin des années 1990, sur le mode rural [4] et s’incarne dans l’assemblée
villageoise. L’histoire politique de cette institution, pour s’en tenir à l’Inde du
XXe siècle, commence avec Mohandas Karamchand Gandhi qui prend dans les
années 1920 la tête du mouvement pour l’indépendance, mené par le parti du
Congrès. Celui qu’on appellera bientôt le Mahatma (« la grande âme ») invente
une stratégie politique destinée non seulement à libérer l’Inde du colonisateur
britannique, mais aussi à préparer la construction d’une Inde nouvelle, plus
prospère et plus juste. Dans cette perspective, Gandhi imagine un système
politique fondé, à la fois moralement et pratiquement, sur les centaines de
milliers de villages indiens. Il s’appuie pour cela sur les écrits des Orientalistes
relatifs au système politique de l’Inde ancienne (par exemple Maine, 1890 ;
Baden-Powell, 1899), qui font état de l’existence de « républiques villageoises » [5],
et propose de restaurer ce qui apparaît comme un âge d’or politique, en
construisant le nouveau système politique sur une myriade de communautés
villageoises matériellement auto-suffisantes et fonctionnant selon le principe de
la recherche du consensus.
Ce projet rencontre l’opposition très ferme de B. R. Ambedkar, leader de
l’émancipation des intouchables et architecte en chef de la Constitution : à
la vision idyllique du Mahatma, Ambedkar oppose la réalité de l’Inde rurale
pour justifier son refus d’inclure dans la Constitution une clause relative aux
conseils de village : « Je tiens que ces républiques villageoises ont été la ruine
de l’Inde [6]. Je suis donc surpris que ceux qui condamnent le provincialisme et
le communalisme [7] s’avancent comme les champions du village. Qu’est-ce que
le village sinon le cloaque du localisme, le repaire de l’ignorance, de l’étroitesse
d’esprit et du communalisme ? » [8]
Malgré les nombreuses voix qui s’élèvent alors contre cette position, la
Constitution indienne, promulguée en 1950, ne comportera aucune clause
relative au gouvernement local, sinon l’article 40 (à valeur directive uniquement)
déclarant que « chaque État prendra les mesures adéquates pour organiser des
panchayat de village et les investira des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour
leur permettre de fonctionner comme des unités d’auto-gouvernement ».
En 1957, un comité placé sous la houlette de Balwantrai Mehta, un fervent
gandhien, est chargé d’évaluer les raisons de l’inefficacité des programmes de
développement locaux mis en place après l’indépendance. Le rapport du Comité
introduit le concept de Panchayati Raj (« gouvernement des panchayat », une
expression due à Gandhi) et recommande la mise en place d’une structure
pyramidale de conseils élus à deux ou trois niveaux (village, canton, district).
En 1959, tous les États sont dotés d’une loi relative aux panchayat, mais dans la
pratique, les résistances de l’administration et des élus régionaux à un transfert
réel de pouvoir vers le niveau local, facilitées par un cadre législatif qui autorise
l’État régional à dissoudre les conseils locaux ou à suspendre indéfiniment
l’organisation des élections, aboutissent à un déclin rapide du gouvernement
local, partout sauf au Maharashtra et au Gujarat.
De fait, les deux premières décennies qui suivent l’indépendance (en 1947)
sont marquées par les choix politiques de Nehru (qui, tout en étant très proche
de Gandhi, a une vision diamétralement opposée du chemin que doit emprunter
l’Inde pour son développement), puis de sa fille, Indira Gandhi. Alors que
Gandhi préconisait un développement économique fondé sur l’agriculture et
l’artisanat rural, Nehru lance l’Inde dans la voie d’une industrialisation pilotée
par l’État [9]. Alors que Gandhi préconisait une architecture institutionnelle
accordant une place majeure aux villages et à leurs conseils, l’exercice du pouvoir
d’Indira Gandhi, qui devient Premier ministre en 1966, est caractérisé par une
centralisation croissante des processus décisionnels.
La vision gandhienne d’une démocratie fondée sur les
villages perdure pourtant bien après la mort de Gandhi en 1948, mais les
figures qui l’entretiennent ont
quitté le Congrès. Jaya Prakash Narayan, dit « J. P. », est la plus
importante de ces
figures. Associé à la mouvance socialiste au sein du Congrès, J. P.
devient le fidèle
disciple de Gandhi. Après l’indépendance, il est de plus en plus
critique vis-à-vis
de la politique menée par Nehru et cultive une vision alternative
(considérée
comme utopique par ses contempteurs) : celle d’une démocratie qu’il
qualifie de
« communitarienne », et qu’il présente ainsi dans un manifeste publié
en 1959 :
« Si nous voulons que nos institutions politiques aient des bases
solides, si elle
doivent se nourrir de la terre indienne, et en retour, soutenir,
revigorer et fortifier
tout le tissu social indien, elles doivent être liées au génie social de
l’Inde, et leur
texture doit être tissée à nouveau avec une vie communautaire
organiquement
auto-déterminée, auto-développée, dans laquelle les occupations, les
professions
et les fonctions sont intégrées dans la communauté » (Narayan, 1959).
Cette vision se radicalise dans les années 1970, tandis que les tendances
autoritaires d’Indira Gandhi deviennent plus évidentes. En 1974, alors que les
mouvements de protestation liés à la crise économique se multiplient dans tout
le pays, J. P. sort de sa retraite politique pour prendre la direction du mouvement
étudiant qui agite le Bihar et appelle à la « révolution totale » : il propose rien
de moins que de refonder la démocratie indienne à travers une architecture
politique pyramidale composée de conseils élus à différents niveaux, avec des
élections au niveau du village, le seul niveau de pratique du suffrage universel ;
dans ce schéma, la gram sabha est l’assemblée souveraine devant laquelle le
panchayat est responsable. J. P. voyage dans tout le pays et mobilise les foules
contre la corruption qui gangrène, selon lui, le gouvernement en place. En 1975,
Madame Gandhi, menacée d’inéligibilité suite à un procès pour fraude électorale,
réagit brutalement au mouvement de désobéissance civile qui prend forme sous
les incantations de J. P. : elle fait arrêter tous les leaders de l’opposition, muselle
la presse et déclare l’état d’urgence, qui durera deux ans. Cet épisode reste dans
les mémoires comme le plus noir de l’Inde indépendante : il est marqué par la
suppression des libertés civiques, mais aussi par une grande violence étatique
contre les pauvres, notamment à travers une politique de stérilisations massives
et une politique d’éradication des bidonvilles au prix de déplacements forcés. En
1977, Indira Gandhi, pensant être réélue, met fin à l’état d’urgence. Le Congrès
perd alors, pour la première fois, les élections au niveau de l’Union indienne et
c’est un gouvernement de coalition, dirigée par un parti hétéroclite, le Janata
Party, et formé des tous les opposants à Indira Gandhi, de la droite hindoue à la
gauche communiste, qui arrive aux affaires.
J. P. Narayan est le maître à penser du gouvernement Janata. L’état d’urgence
faisant figure de repoussoir, les années Janata sont marquées par la tentative de
développer le secteur associatif [10] et le pouvoir des juges afin de faire contrepoids à
l’exécutif. Le gouvernement exhorte alors littéralement les citoyens à se mobiliser :
« Les ressources importantes [des programmes publics de développement
rural] ne peuvent avoir l’effet d’égalisation désiré que dans la mesure où
la pression organisée des bénéficiaires s’oppose à la faiblesse de l’administration
et à l’opposition des intérêts cachés » [11], est-il écrit dans le cinquième Plan
quinquennal.
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle réflexion est
entamée sur la décentralisation, avec la mise en place par le
gouvernement Janata, en 1977, d’un comité
dirigé par Ashoka Mehta (un ancien compagnon de cellule de J. P. durant
le
mouvement pour l’indépendance). Le rapport Ashoka Mehta, remis en 1978,
fera date : il préconise une structure représentative à trois niveaux
mais aussi,
en parallèle, une gram sabha à vocation consultative. Ces recommandations se
retrouveront pour l’essentiel dans la politique de décentralisation adoptée en
1992. Mais dès les années 1980, quelques gouvernements régionaux s’appuient
sur le rapport Ashoka Mehta pour lancer des programmes de décentralisation
innovants. C’est notamment le cas du Bengale occidental, dirigé à partir de
1977 par le principal parti communiste indien, qui considère les conseils locaux
comme un moyen de consolider son assise dans les campagnes.
Au niveau national, le gouvernement Janata est rapidement miné par ses
contradictions internes et se révèle une coalition de circonstance incapable de
dépasser son caractère éminemment hétéroclite. Les élections de 1980 ramènent
donc Indira Gandhi au pouvoir. Rajiv Gandhi, devenu Premier ministre en 1984,
suite à l’assassinat de sa mère, reprend l’idée selon laquelle « les panchayat sont
le point nodal du développement rural » (Lieten, 1996, p. 2700), et entreprend
de conférer un statut nouveau à la démocratie locale, dans le cadre de son projet
de modernisation de l’État. (Les calculs électoraux ne sont pas étrangers à ce
positionnement : il s’agit aussi, pour un Congrès en perte de vitesse, d’aller
mobiliser les électeurs à la base, et si possible de contourner les gouvernements
des États, de plus en plus nombreux à quitter le giron congressiste). En 1989,
Rajiv Gandhi introduit donc un projet de loi de décentralisation, qui deviendra
une réalité quatre ans plus tard.
Ainsi, l’idée de démocratie locale directe est inséparable, au cours de la
deuxième moitié du XXe siècle, d’une vision alternative de la démocratie
indienne, vision toujours présente (car elle est associée au père fondateur
de l’Inde indépendante, Gandhi), mais que les gouvernements successifs ne
cherchent pas à mettre en œuvre – à l’exception, on l’a vu, du gouvernement
Janata. Cette vision se radicalise en même temps qu’elle s’éloigne du Congrès,
parti dominant pendant les deux décennies qui suivent l’indépendance, pour
atteindre le point critique de 1977, où elle s’incarne dans la proposition de
« révolution totale » de J. P. Les premiers gouvernements à mettre en œuvre une
politique de décentralisation seront menés par les partis liés au gouvernement
Janata : Janata Dal au Karnataka, parti communiste au Bengale occidental et au
Kérala – mais dans une version qui privilégie la représentation par rapport à la
participation directe. La politique de décentralisation de 1992, qui accorde un
statut constitutionnel au gouvernement local, et en particulier à la gram sabha,
marque le retour de cette idée dans le giron congressiste.
AMBIGUÏTÉ DE LA PARTICIPATION, ENTRE POLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT
Le contenu de la notion de participation fluctue amplement au cours de
la période évoquée plus haut. La participation au sens strict s’incarne dans
l’assemblée villageoise, une idée radicale (car pour Gandhi, J. P. et leurs disciples,
la gram sabha doit constituer le socle de la démocratie indienne) qui peine
à se traduire concrètement. La gram sabha fait bien partie des politiques de
décentralisation mises en œuvre par la plupart des États dans les années 1960
(elle existe dès 1947 au Bihar et en Uttar Pradesh), mais elle ne fonctionne
vraiment nulle part (Kumar, 2006, p. 205). En 1978, on l’a vu, le Comité Ashoka
Mehta définit la gram sabha comme une institution parallèle aux conseils élus,
qui sont la véritable colonne vertébrale du schéma décentralisateur préconisé ; la
gram sabha est alors conçue comme un appendice de la démocratie locale. Enfin,
les débats parlementaires entourant le projet de politique de décentralisation
à la fin des années 1980 font référence à la vision gandhienne, et présentent la
gram sabha comme une institution majeure du gouvernement local. Mais la
gram sabha mise en œuvre à partir de 1994 n’a qu’un rôle consultatif.
Ce glissement de statut de la gram sabha est étroitement lié à l’évolution de
la vision dominante du rôle des institutions politiques locales : les assemblées
et conseils élus au niveau local ont-ils d’abord un rôle politique ou un rôle
gestionnaire ? En d’autres termes, sont-ils associés à la prise de décision ou
seulement à la mise en œuvre de décisions adoptées aux échelons supérieurs ?
Ces questions universelles sont, dans le contexte indien, indissociables de
la question du rôle des partis politiques au niveau local. Pour Gandhi, les
communautés villageoises pouvaient s’autogouverner dans l’harmonie, à travers
la recherche du consensus, atteint par des discussions – on dirait aujourd’hui
des délibérations. Dans cette perspective, les partis politiques, conçus comme
se nourrissant des oppositions, pour ne pas dire du conflit, entre les électeurs,
étaient considérés comme une nuisance, et Gandhi affirmait qu’ils n’avaient pas
leur place dans la démocratie locale [12].
Cette idée se retrouve en 1957 dans le rapport du comité Balwantrai Mehta,
dont l’objectif premier est de proposer des moyens d’amener la population locale
à participer plus activement aux programmes de développement. Le rapport
soutient que les partis politiques n’ont pas leur place dans le panchayati raj
mais il ne conserve, ce faisant, que l’apparence d’une inspiration gandhienne :
car Gandhi voulait écarter les partis pour les remplacer par un mode alternatif,
plus délibératif et moins antagonistique, de prise de décision ; il s’agissait de
régénérer la démocratie en la transformant à la base. Le rapport Balwantrai
Mehta, quant à lui, ignore la question du rôle des villages dans la démocratie
indienne et recommande une décentralisation apolitique, c’est-à-dire une
nouvelle structure institutionnelle exclusivement destinée à faciliter la mise
en œuvre des programmes de développement lancés par l’État (central ou
régional).
Vingt ans plus tard, alors que le gouvernement local paraît largement
inefficient, le nouveau Comité chargé d’émettre des recommandations à cet égard
prend le contre-pied du rapport Balwantrai Mehta. Le rapport Ashoka Mehta
recommande en effet de redéfinir les panchayat pour en faire des institutions
politiques, plutôt que des agences de mise en œuvre des programmes de
développement, et propose que les partis politiques participent aux élections
locales – recommandation qui sera rapidement suivie d’effet dans les États
dominés par le parti communiste (Bengale occidentale, puis Kérala), qui
deviennent alors des modèles en matière de décentralisation. Mais la politique de
décentralisation adoptée au niveau central en 1992 ne tranche pas complètement
la question de la légitimité des partis politiques au niveau local et dans certains
États, comme l’Orissa, ceux-ci demeurent officiellement exclus des élections
locales – même si les candidats font toujours savoir aux électeurs où vont leurs
préférences et d’où viennent leurs soutiens.
On peut donc distinguer, du rapport Balwantrai Mehta au rapport Ashoka
Mehta puis à la politique de décentralisation de 1992, une évolution de la
vision du rôle des assemblées et conseils élus au niveau local : d’un rôle
apolitique, gestionnaire, de facilitation de la mise en œuvre de programmes
de développement adoptés aux échelons supérieurs, à un rôle politique de
mobilisation des citoyens autour des enjeux locaux. C’est ainsi que la gram sabha
est présentée en 1992 comme la pierre de touche de la dimension démocratique
du nouvel édifice institutionnel : la participation doit conférer une profondeur
politique nouvelle au gouvernement local.
Or, la participation devient aussi, à la même époque, le mot d’ordre du secteur
non gouvernemental. Les organisations non gouvernementales (ONG) se voient
reconnaître par l’État indien, dès le début des années 1980, un rôle légitime dans
la mise en œuvre des programmes de développement et elles se multiplient au
fur et à mesure que l’État leur délègue partie ou totalité de certains programmes,
notamment dans le secteur de la santé. Les organisations internationales d’aide
au développement, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, encouragent
fortement ce développement du secteur non gouvernemental, considéré comme
une alternative à une bureaucratie notoirement inefficace, notamment du fait
de la corruption qui y prévaut. Ces organisations internationales véhiculent
une doctrine en matière de développement d’autant plus efficacement qu’elles
sont une source de financement majeure pour de nombreux programmes. Or,
le début des années 1990 voit l’irruption, dans cette doctrine, de l’idée que
la participation des personnes concernées est indispensable à l’efficacité des
programmes. Cette idée s’incarne dans des pratiques qui se généralisent très
vite, telles que « l’évaluation participative rurale » (participatory rural appraisal)
ou encore la formation de « comités d’usagers » (users committees).
Cette appropriation de l’idée de participation par le
secteur non gouvernemental la dépouille de ses qualités politiques pour
plusieurs raisons. Tout
d’abord, les ONG qui mettent en œuvre les programmes de développement
(et notamment leur volet participatif) se définissent largement par leur
nature
apolitique : c’est souvent la condition sine qua non de leur financement par des
organisations internationales, mais c’est aussi, pour les ONG qui se consacrent à
la défense de certaines causes (advocacy groups) un gage de leur liberté d’opinion
et d’expression. Ensuite, les programmes de développement sont caractérisés par
le ciblage des populations concernées : au sein d’un village, seuls certains sont
invités à (ou sommés de) participer. Enfin et surtout, l’objet comme les modalités
de la participation sont imposés d’emblée : les membres d’un groupe d’usagers
ne sont pas supposés discuter d’autres sujets que celui qui est au fondement
de la formation du groupe (l’irrigation des terres du village, l’exploitation des
ressources forestières locales, etc.), ni des autres moyens de faire valoir leurs
préférences (manifestation, grève, etc.). En Inde comme dans beaucoup d’autres
pays du Sud, le développement ressemble ainsi à une « machine anti-politique »
(Ferguson, 1990).
Dans le cas indien, le fait que des dispositifs participatifs soient mis en
œuvre au même moment dans le cadre de la politique de décentralisation et
dans celui des programmes de développement conduits par le secteur non
gouvernemental renforce le potentiel dépolitisant de ces programmes. James
Manor dénonce les effets néfastes de cette confusion des genres en parlant, à
propos de la généralisation des « comités d’usagers », d’une « deuxième vague
de décentralisation » qui risque de saper les effets démocratisants de la première
en « fragmentant » la participation (Manor, 2004).
LA SYNTHÈSE DES ANNÉES 1990-2000
Les deux dernières décennies sont marquées par trois grands tournants au
regard des trajectoires décrites plus haut. Premièrement, on l’a dit, le parti du
Congrès récupère l’idée de régénérer la démocratie en la consolidant au niveau
local. La politique de décentralisation de 1992 est souvent qualifiée d’historique,
parce qu’elle accorde un statut constitutionnel au gouvernement local, qui
devient ainsi partie intégrante de la structure gouvernementale indienne. La
décentralisation a pour objectif une plus grande efficacité de l’administration,
mais aussi un approfondissement de la démocratie indienne : elle rend la
représentation plus inclusive et « élargit l’entonnoir de la représentation », selon
les termes de Rajiv Gandhi (Sivaramakrishnan, 2000, p. 17), d’abord parce
qu’elle se traduit par plus de trois millions de nouvelles positions électives du
seul fait de la mise en œuvre obligatoire des élections locales (qui concernent
les conseils au niveau des villages, des cantons et des districts), mais aussi
parce qu’elle impose des quotas pour les catégories sociales jusqu’alors les plus
politiquement marginalisées : ainsi un tiers des circonscriptions locales sont
réservées aux femmes, tandis que les ex-intouchables et les tribaux bénéficient
de quotas en proportion de leur importance démographique locale. Dans la
plupart des États, les réunions de la gram sabha sont obligatoires, assorties d’un
quorum, et ses prérogatives sont élargies (discuter du budget et des programmes
de développement mis en œuvre par le conseil du village et sélectionner les
bénéficiaires des programmes d’assistance publique) [13], ce qui constitue une
autre innovation institutionnelle de taille.
La mise en œuvre de la politique de décentralisation révèle toutefois que de
nombreuses résistances s’opposent à une véritable délégation des fonctions, des
personnels et des fonds aux institutions locales. Ces résistances émanent des
élus régionaux et nationaux, de l’administration à tous les niveaux, mais aussi
des groupes localement dominants en termes de caste et de classe. Les États
régionaux interprètent de façon restrictive toutes les clauses qui sont laissées à
leur discrétion – notamment concernant les modalités de fonctionnement de
la gram sabha, dont la mise en oeuvre est particulièrement décevante : elle est
insuffisamment convoquée, à des moments qui empêchent un grand nombre
d’électeurs de s’y rendre – quand ils en sont informés à temps, ce qui n’est
pas toujours le cas. Dans des sociétés villageoises fortement hiérarchisées, la
notion d’une discussion entre égaux est difficile à mettre en œuvre. Enfin, si
les prérogatives de la gram sabha sont importantes sur le papier, dans la réalité
elles sont très limitées, et c’est l’administration du canton qui fixe généralement
l’agenda des réunions. Dans bien des cas, seules les femmes les plus pauvres y
participent, puisque l’une de ses missions les mieux comprises est d’identifier
les personnes éligibles pour bénéficier de programmes d’assistance publique,
programmes qui ciblent le plus souvent les plus pauvres. En pratique, la gram
sabha ne rassemble le plus souvent que ceux qui n’ont aucune ressource et ne
débouche donc pas sur une véritable mobilisation politique [14].
Les choses sont différentes là où s’applique le Panchayati Raj (Extension to
Scheduled Areas) Act (PESA) adopté en 1996. Cette législation dote la gram
sabha de pouvoirs accrus dans les régions comprenant une population tribale
majoritaire (huit États fédérés sont concernés). La gram sabha y est dotée d’un
droit de veto sur les décisions concernant les ressources naturelles locales (terres,
forêt, étangs etc.). L’objectif est de préserver le mode de vie traditionnel des
communautés tribales, étroitement lié à l’usage collectif de ces ressources, et de
limiter, dans ces régions dont le sous-sol est généralement riche en ressources
minérales, un comportement prédateur de l’État. Ce renforcement du pouvoir
de la gram sabha repose sur l’idée que, dans ces communautés relativement
égalitaires, l’assemblée villageoise peut être le site d’une discussion ouverte.
Hors des zones tribales, ce sont deux politiques publiques récentes qui ont,
indirectement, conféré une importance nouvelle à la gram sabha. La première
est le droit à l’information (Right to Information Act) adopté au niveau de
l’Union indienne en 2005. Cette loi oblige l’administration publique à tous les
niveaux à fournir, à qui la demande, une information complète sur telle ou telle
décision. Cette loi, qui vise à promouvoir la transparence et l’imputabilité de
l’administration, constitue potentiellement (car sa mise en œuvre rencontre
bien des obstacles) une arme puissante de lutte contre la corruption [15]. Dans
les villages, elle permet à la gram sabha de discuter en connaissance de cause de
l’usage qui a été fait des fonds publics par ceux par qui ils transitent – élus et
bureaucrates locaux.
La deuxième politique publique est un programme d’emplois publics, le
National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), également adopté en 2005.
Cette loi garantit, à tout ménage rural qui le demande, cent jours d’emploi par an
sur des chantiers publics (construction de routes, de canaux d’irrigation etc.) [16]
Pour éviter que ce programme connaisse le même sort que ses prédécesseurs, la
loi comporte une disposition selon laquelle la gram sabha est chargée de l’« audit
social » de la mise en œuvre du programme : autrement dit, les électeurs sont
invités à vérifier que les registres de l’administration correspondent à la réalité,
qu’il s’agisse du nombre de bénéficiaires du programme, de leur identité, du
salaire qui leur a été versé ou de la mesure du travail accompli.
Ainsi, tandis que le PESA augmente considérablement les enjeux et les moyens
d’action de la gram sabha dans les zones tribales, dans le reste du pays le droit à
l’information et le programme d’emplois publics produisent ensemble le même
effet [17].
Or, ces deux dernières politiques publiques doivent beaucoup à un deuxième
tournant : le rôle ouvertement politique joué par le secteur non gouvernemental.
Alors que dans les années 1980, le discours dominant sur la société civile indienne
oppose les ONG, réputées apolitiques, aux mouvements sociaux, qui auraient
le changement politique comme objectif principal, le caractère rhétorique de
cette opposition devient évident dans les années 1990 (Jenkins, à paraître).
Le droit à l’information est en effet l’aboutissement du travail d’analyse et de
mobilisation mené depuis 1996 par une ONG basée au Rajasthan, le Mazdoor
Kisan Shakti Sangathan (Union pour le pouvoir des travailleurs et des paysans,
MKSS), qui mobilise les pauvres autour de la question des salaires minimaux et
de la redistribution des terres. Derrière cette organisation pionnière, beaucoup
d’autres contribuent à la mise en œuvre de cette législation. Le Rajasthan est
aujourd’hui l’un des États où la mise en œuvre du programme d’emplois ruraux
est considérée comme la plus satisfaisante, et la mobilisation autour du droit à
l’information par les militants du MKSS y est pour beaucoup. Plus généralement,
la présence locale des ONG apparaît comme un facteur important de « succès »
de la décentralisation : les ONG contribuent à mobiliser les électeurs par leur
travail de diffusion de l’information, par exemple au sujet de la tenue et des objets
des réunions de la gram sabha [18]. Signe de la légitimité nouvelle de l’engagement
du secteur non gouvernemental dans des activités touchant à la politique, les
ONG se présentent volontiers, désormais, comme des « groupes de citoyens ».
Ce deuxième tournant est enfin lié à un troisième : la participation se
développe également dans les villes. La politique de décentralisation de 1992
comporte en effet un volet urbain : trois types de municipalité sont définis (en
fonction notamment de la taille de la population), des quotas pour l’élection
des conseillers municipaux y sont également mis en œuvre pour les femmes, les
ex-intouchables et les tribaux, et l’équivalent urbain de la gram sabha est le ward
committee, supposé rassembler élus, administration municipale et représentants
de la société civile, pour gérer les affaires locales à l’échelle de la circonscription
municipale (le ward). Mais contrairement à la gram sabha, la composition
du ward committee est laissée à la discrétion des États, et tous, sauf le Kérala,
interprèteront cette clause de façon très restrictive : le ward committee n’inclut
le plus souvent aucun représentant de la société civile [19] et ne constitue qu’un
échelon décentralisé d’interaction entre élus et administration municipale. Dans
les grandes villes indiennes, la notion d’une participation directe des résidents
à la gestion des affaires locales s’incarne en fait dans des dispositifs lancés par
le gouvernement, comme le programme Bhagidari à Delhi, qui affiche pour
objectif la mobilisation des « groupes de citoyens ».
La description de ce programme-étendard par l’un de ses inventeurs, le chef
de l’administration de la ville-État de Delhi, résume la synthèse opérée ces
dernières années entre les visions politique et managériale de la participation.
S. Reghunatan, évoquant Gandhi, reprend à son compte la vieille méfiance
vis-à-vis des partis : « Une partie des problèmes de gouvernance en Inde sont
dus aux élus et à l’administration... le seul moyen d’y remédier est de revenir
au peuple... Les ward committees ont été circonscrits, c’est l’une des raisons
pour laquelle j’ai voulu le programme Bhagidari... nous voulions éviter les
interférences politiques », explique-t-il [20].
Mais il souligne aussi les objectifs managériaux du programme qui avait
pour but « d’associer les gens à des politiques telles que la privatisation de
la distribution de l’électricité, pour assurer une transition paisible (smooth)...
Nous avons cherché une organisation qui pourrait mettre en œuvre cette idée et
trouvé ACORD [Asian Centre for Organisation Research and Development –
une entreprise indienne de consultance en formation et gestion des ressources
humaines] spécialisée dans les « large group interactive exercises [21] » [22].
Le programme Bhagidari a
effectivement été lancé au moment où le gouvernement engageait une
série de réformes concernant les services urbains. Le
programme procède à travers l’organisation, à intervalles réguliers,
d’« ateliers »
qui voient représentants des associations de quartier et des diverses
administrations en charge des services urbains débattre ensemble,
pendant trois jours, des
problèmes communs pour trouver des solutions consensuelles [23].
Mais les associations de quartier, qui se sont multipliées puis fédérées en
réponse aux incitations du programme Bhagidari, se sont mobilisées depuis
2004 contre le gouvernement de Delhi. Qu’il s’agisse de la privatisation de la
distribution de l’électricité, de la privatisation de la distribution d’eau ou de la
mise en œuvre du nouveau schéma directeur d’urbanisme, ce programme, loin
« d’apaiser » les résidents, a au contraire été le catalyseur d’une véritable action
collective de leur part (Tawa Lama-Rewal, 2007).
CONCLUSION
De l’indépendance aux années 1990, l’idée d’une forme
directe de participation des citoyens aux décisions publiques est un
serpent de mer, qui s’éclipse
largement de la scène politique avec la mort du Mahatma Gandhi, puis
resurgit
lors de la crise politique des années 1970 pour être ensuite discutée,
mais jamais
appliquée jusqu’à la politique de décentralisation de 1992. Le
développement,
en extension et en profondeur, des dispositifs participatifs à partir des années
1990, est tributaire, on l’a dit, d’une série de politiques publiques, mais aussi
de la force du nouveau discours sur la bonne gouvernance, et de dynamiques
socio-économiques nouvelles.
La fin des années 1990 voit en effet plusieurs chefs de gouvernements
régionaux s’approprier la thématique de la bonne gouvernance promue par
la Banque mondiale et les Nations unies. La participation est alors présentée
comme une valeur en soi, tout en étant un moyen d’améliorer la transparence
de l’action gouvernementale et l’imputabilité des gouvernants. Les effets de ce
discours sont particulièrement visibles dans les grandes villes, à la fois parce
que les capitales des États fédérés sont utilisées comme des vitrines de l’action
gouvernementale, chargées d’attirer de potentiels investisseurs internationaux
(Kennedy, 2004), et parce que ce discours est favorablement accueilli par une
classe moyenne en expansion qui tend à avoir une vision très négative de la
politique et des politiciens. Le succès du programme Bhagidari à Delhi, du
« Local Area Citizen Group Partnership » à Mumbai, mais aussi la multiplication
et l’activité grandissante des associations de quartier à Hyderabad ou Bangalore
peuvent être vus comme l’appropriation de nouveaux canaux de participation
politique par ces groupes enrichis par les réformes économiques mises en œuvre
depuis le début des années 1990.
Enfin, l’examen des objets qui activent la participation et donnent leur sens
et donc leur force aux dispositifs participatifs tend à montrer qu’il est fallacieux
d’opposer politique et développement en la matière. Les villageois participent
en nombre à la gram sabha à partir du moment où elle joue un rôle dans la
mise en œuvre du programme d’emplois publics ; ils y mettent en cause l’action
des gouvernants (ne serait-ce que celle des élus locaux, en collaboration avec
l’administration locale) parce que des ressources collectives concrètes sont en
jeu. Dans les villes, la mobilisation des associations de quartier contre le schéma
directeur d’urbanisme (à Delhi en 2006), comme leur engagement dans les
élections municipales en 2007, est partie de réunions de riverains autour de
problèmes micro-locaux. Autrement dit, la participation prend son sens et sa
force au croisement de la démocratie et du développement : elle engage les
citoyens en tant qu’usagers ou bénéficiaires et vice-versa.
Alors que les dispositifs participatifs se développent dans de nombreux pays
à partir des années 1990, le cas indien – en tous cas son versant urbain – semble
aller à contre-courant de certaines observations suscitées par les expériences
européennes (Blondiaux, 2008 ; Sintomer, 2007) ou américaines (Bacqué, 2005).
D’une part, les dispositifs participatifs mis en œuvre dans les grandes villes
indiennes visent non une population dominée, mais une population dominante
– et c’est bien la raison de leur visibilité, et donc de leur efficacité. D’autre
part ces dispositifs, loin de neutraliser l’action collective des groupes concernés,
semblent au contraire la promouvoir et permettre l’expression d’un désir de
montée en généralité. Enfin, l’instrumentalisation politique de ces dispositifs
par les gouvernements en place est loin d’être évidente : si, à Delhi, le résultat
des élections régionales de 2003 semblait indiquer que le programme Bhagidari
a su mobiliser les classes moyennes en faveur du gouvernement sortant, les
agitations organisées par les associations de quartier (notamment autour du
conflit sur l’usage du sol en 2006) ont constitué un obstacle important pour le
gouvernement. Il semble donc important, pour mieux comprendre les enjeux
et les effets du développement de dispositifs participatifs dans de nombreuses
démocraties, de développer des comparaisons internationales, y compris avec
les pays du Sud [24].
BIBLIOGRAPHIE
- Altekar A. S., 1958, State and Government in Ancient India, Delhi, Motilal Banarsidass.
- Bacqué M.-H., 2005, « Dispositifs participatifs dans les quartiers populaires, Héritage des mouvements sociaux ou néo-libéralisme ? Empowerment zones aux États-Unis et politique de la ville en France » in Bacqué M.-H., Rey H., Sintomer Y. (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective comparative, Paris, La Découverte.
- Baden-Powell B. H., 1899, The Village Communities of India, London, Swan Sonnerschein & Co.
- Bardhan P., Mookherjee D., 2004, « Poverty Alleviation Efforts of Panchayats in West Bengal », Economic and Political Weekly, 39 (9).
- Besley T., Pande R., Rao V., 2004, « Participatory Democracy in Action : Survey Evidence from South India », Working Paper, World Bank.
- Blondiaux L., 2008, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Paris, Le Seuil (coll. « La république des idées »).
- Chattopadhyay R., Duflo E., 2003, Women as Policy Makers : Evidence from a Randomized Policy Experiment in India, Working Paper, Department of Economics, MIT, Boston.
- Ferguson J., 1990, The Anti-Politics Machine : « Development », Depoliticisation and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge University Press.
- Franda M., 1983, Voluntary Associations and Local Development in India, Delhi, Young Asia Publications.
- Heller P., 2008, « Local Democracy and Development in Comparative Perspective » in van Donk M., Swilling M., Pieterse E., Parnell S. (dir.), Consolidating developmental local Government : Lessons from the South African Experience, University of Cape Town Press.
- Jenkins R., 2010, « NGOs and Indian Politics », in Jayal N. G., Mehta P. B. (dir.), The Oxford Companion to Indian Politics, Delhi, Oxford University Press, à paraître.
- Kennedy L., 2004, « The Political Determinants of Reform Packaging : Contrasting Responses to Economic Liberalization in Andhra Pradesh and Tamil Nadu » in Jenkins R. (dir.), Regional Reflections : Comparing Politics across India’s States, Delhi, Oxford University Press, pp. 29- 65.
- Kumar G., 2006, Local Democracy in India : Interpreting Decentralisation, Delhi, Sage.
- Lieten G. K., 1996, « Panchayat in Western Uttar Pradesh, “ Namesake ” Members », Economic and Political Weekly, 28 septembre.
- Maine H. S., 1890, Village Communities in the East and West, London, John Murray.
- Muhlberger S., 1998, « Democracy in Ancient India » : http://www.nipissingu.ca/department/ history/muhlberger/histdem/indiadem.htm
- Narayan J. P., 1959, A Plea for the Reconstruction of the Indian Polity (reproduit dans Seminar, 2001, n? 506).
- Sharma J. P., 1968, Republics in Ancient India, c. 1500 B. C.-500 B. C., Leiden, E. J. Brill.
- Sintomer Y., 2007, Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, Paris, La Découverte.
- Sivaramakrishnan K. C., 2000, Power to the People ? The Politics and Progress of Decentralisation, Delhi, Konark Publishers.
- Tawa Lama-Rewal S., 2007, « Neighborhood Associations and Local Democracy : Delhi Municipal Elections 2007 », Economic and Political Weekly, vol. XLII, n? 47, 24-30 novembre, pp. 51-60.
- Tawa Lama-Rewal S., 2007, « La démocratie locale dans les métropoles indiennes. Les associations de résidents à New Delhi », Transcontinentales. Sociétés, idéologies, système mondial, n? 4, premier semestre, pp. 131- 144.
Notes
[*]
Chargée de recherche au Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CNRS-EHESS).
[1]
Le panchayat est une institution ancienne : c’est un conseil d’anciens doté du pouvoir d’arbitrer les disputes dans une
communauté donnée – la caste, ou le village.
[2]
Le « Local Area Citizen Group Partnership », établissant un partenariat entre la municipalité de Mumbai et des « groupes
locaux de citoyens » à partir de 2006, est proche du programme Bhagidari dans sa forme et dans ses objectifs.
[3]
Sheila Dixit a été élue en 1998, puis réélue à deux reprises (fait rarissime dans l’Inde contemporaine) en 2003 et en 2008.
[4]
L’Inde est caractérisée par une urbanisation relativement lente (selon le dernier recensement, en 2001, 72 % des Indiens
vivaient à la campagne).
[5]
Charles Metcalfe, un haut fonctionnaire de la Compagnie des Indes orientales (qui préfigure le gouvernement de l’Inde
britannique), avait qualifié, en 1810, les villages indiens de « petites républiques » – une expression qui fera date. Après les
Orientalistes, l’historiographie nationaliste indienne, à partir des années 1910, découvre et célèbre les républiques, au sens
large de « gouvernement par la discussion » (Muhlberger, 1998), qui ont coexisté avec les monarchies à l’époque bouddhiste
(du Ve siècle avant notre ère au IIe
siècle) dans le Nord et l’Est de l’Inde. Des recherches plus récentes
(Altekar, 1958 ; Sharma,
1968) ont montré que ces républiques existaient soit à l’échelle de
villes-états, soit à une échelle supérieure, et qu’il faut donc les
distinguer des conseils de villages qui perdurent jusqu’à l’époque
coloniale, mais dont les attributions sont limitées à l’arbitrage
des disputes.
[6]
Les citations issues de sources dont l’original est en anglais sont traduites par l’auteur.
[7]
Dans le contexte indien, le « communalisme » désigne l’idée selon laquelle les membres d’une communauté religieuse sont
solidaires et s’opposent en bloc aux membres de la communauté rivale ; ce terme s’applique surtout aux relations entre les deux
communautés principales, hindoue et musulmane.
[8]
Constituent Assembly Debates, Volume VII, 1949, p. 39, Delhi, Lok Sabha Secretariat.
[9]
Nehru soutient personnellement la décentralisation, qu’il considère comme un facteur de démocratisation du système politique,
mais son entourage ne le suit pas (Kumar, 2006, pp. 19-20).
[10]
« La multiplication des ONG indiennes était considérée [dans les années 1970] comme une réponse à l’incapacité des autres
institutions de la démocratie indienne – particulièrement ses partis – à offrir des voies d’engagement politique » (Jenkins, à
paraître).
[11]
Planning Commission, Government of India, Draft Five Year Plan, 1978-1983, 1978, p. 15 (cité in Franda 1983, p. 7).
[12]
Quant à J. P., il appelait de ses vœux une « démocratie sans partis ».
[13]
Le Kérala est le seul État indien où un effort réel a été fait pour mettre en place une planification par la base : le « People’s
Plan » lancé en 1996 implique que 35 % du budget de la Commission au Plan de l’État soit transféré aux collectivités locales.
Une vaste campagne a été lancée pour encourager une large participation populaire dans les débats, notamment à travers la
gram sabha.
[14]
La question de l’impact concret de la décentralisation en termes de
démocratisation de l’accès aux ressources a mobilisé les
économistes, qui ont notamment mesuré l’impact des quotas électoraux sur
les conseils de villages, définis alors comme des
administrateurs de biens publics. Ces différents travaux (notamment
Besley, Pande, Rao, 2004 ; Chattopadhyay, Duflo, 2003 ;
Bardhan, Mookherjee, 2004) esquissent ensemble un tableau nuancé, d’où
il ressort que les contrastes sont forts entre les
différents États et que les facteurs favorables à une redistribution qui
reflète davantage les préférences des groupes marginalisés
(qui sont aussi les bénéficiaires des quotas) sont le niveau d’éducation
des élus, leur expérience politique, l’ancienneté de la mise
en œuvre des quotas, et la présence de castes dominantes (c’est-à-dire
de castes qui possèdent à la fois la plus grande partie
des terres et qui occupent la plus grande partie des fonctions
politiques). Ces observations expliquent que le Kérala, le Rajasthan,
le Karnataka et le Bengale occidental apparaissent aujourd’hui comme les
États où la décentralisation est la plus aboutie.
[15]
Le droit à l’information connaît toutefois plusieurs exceptions : il ne s’applique pas dans l’État du Jammu et Cachemire, ni à
une série de documents considérés comme trop sensibles. Voir à ce sujet le site officiel du gouvernement indien, où l’on peut
notamment consulter le texte de la loi : http://righttoinformation.gov.in/ (consulté le 02/11/2009).
[16]
Ce programme est actuellement mis en oeuvre dans 330 districts (sur un
total de 593 dans tout le pays) considérés comme
les moins développés ; il garantit une rémunération sur la base du
salaire minimum, avec des taux égaux pour les hommes et
pour les femmes (alors que les femmes sont toujours sous-payées en
milieu rural). Voir à ce sujet le site officiel du gouvernement
indien qui donne également accès au texte intégral de la loi :
http://nrega.nic.in/ (consulté le 02/11/2009).
[17]
Ces deux politiques-phares de l’agenda social du gouvernement de
coalition au pouvoir depuis 2004 mobilisent l’attention des
militants mais aussi des chercheurs – qui sont souvent les mêmes
personnes. Ainsi, l’économiste Jean Dreze, qui est l’un des auteurs
du programme d’emplois publics, commente régulièrement la mise en œuvre
de ce dernier et répond à ses critiques, notamment
dans le quotidien The Hindu ou le bimensuel Frontline, qui font partie du même groupe de presse (voir par exemple un entretien
récent avec Drèze sur les violations du programme : http://www.hinduonnet.com/fline/fl2616/stories/20090814261604000.htm).
Les deux politiques sont toutefois trop récentes pour se prêter aujourd’hui à une évaluation globale.
[18]
Entretien avec Bidyut Mohanty, Institute of Social Sciences, Delhi, octobre 2008.
[19]
Parmi les six plus grandes municipalités urbaines en Inde, Mumbai est la seule dont les ward committees incluent trois ONG
(sélectionnées par les élus locaux).
[20]
Entretien, Delhi, octobre 2008.
[21]
Cette méthode est utilisée aux États-Unis, tant dans le monde de l’entreprise que dans celui du travail social.
[22]
Entretien, Delhi, octobre 2008.
[23]
Pour une description détaillée du programme Bhagidari, voir le site du gouvernement de Delhi : http://delhigovt.nic.in/bhagi.asp
(consulté le 02/11/2009).
[24]
Voir par exemple Heller, 2008.
Résumé
Français
Cet article dessine l’itinéraire, en Inde, de l’idée d’une démocratie
locale permettant la participation directe des citoyens à la prise de
décision. Cette idée est portée par différents leaders et partis
politiques, du Mahatma Gandhi (dans les années 1930) à Rajiv Gandhi
(dans les années 1990). L’article analyse les fluctuations du contenu de
cette idée, et notamment son va-et-vient entre une interprétation
« politique » et une interprétation « apolitique ». Il décrit la
synthèse opérée entre ces deux interprétations dans les années 1990,
alors qu’une forme directe de démocratie locale est enfin mise en œuvre
dans les villages, mais aussi dans les villes.Source : https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2010-1-page-177.htm










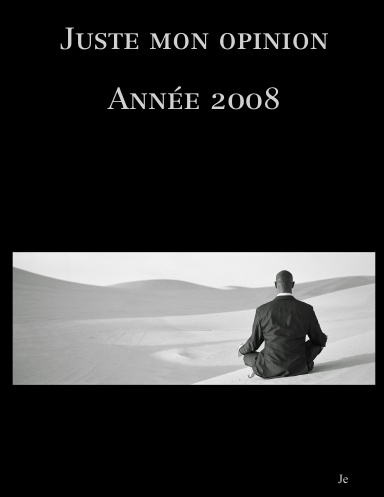
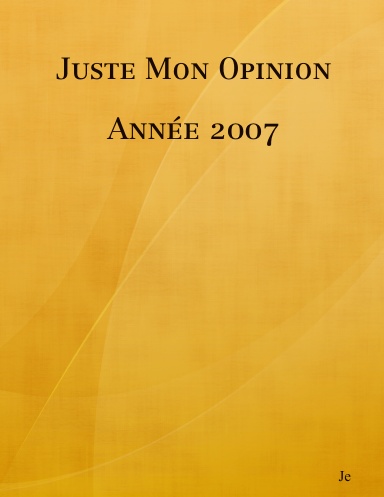

1 commentaire:
En s'appuyant sur les traditions indiennes, c'est-à-dire le gram sabha (assemblées villageoises) le "Mahatma" Gandhi rejoint le projet politique de Jean Meslier décrit par Michel Onfray dans sa Contre-histoire de la philosophie.
Jean Meslier préconisait le communalisme planétaire (Remarque : Il s'agit du communalisme au sens francophone, c'est-à-dire s'appuyant sur les communes; alors que pour les anglophones, "communalisme" prend le sens français de communautarisme).
C'est exactement la solution que propose aussi Murray Bookchin avec son confédéralisme municipal. Pour lutter contre la mondialisation, c'est-à-dire la concentration de tous les pouvoirs (politiques et économiques) à l'échelle planétaire dans les mains de quelques banquiers principalement états-uniens et britanniques, il faut reprendre le contrôle au niveau local, au niveau de la commune.
Pour cela, il faut sortir de ce statut infantile auxquels sont réduits les soit-disant citoyens. Il faut non seulement être autonome (écrire ses lois) comme le revendiquent les adolescents mais en plus, il faut être autosuffisant (en termes alimentaires, énergétiques, monétaires) pour atteindre le statut d'adulte.
Enregistrer un commentaire