
Candidat
hors parti à la présidentielle, l’élu des Pyrénées-Atlantiques, qui se
veut le porte-parole des "sans-voix", publie jeudi 27 octobre "Un berger
à l'Elysée" (éditions La Différence). "L’Obs" vous offre quelques pages
en avant-première.
Il
y a du Mélenchon chez Jean Lassalle. A première vue, rien de commun
entre ces deux-là. Quel lien entre le champion de l'autre gauche,
éternel flingueur du PS, et le député des Pyrénées-Atlantiques, ancien
centriste du MoDem, longtemps dans l'ombre de son ami François Bayrou, qui avait entrepris, en 2013, un tour de France à pied pour "écouter le peuple" ?
Et
pourtant. De nombreuses convergences apparaissent lorsqu'il s'agit
d'identifier l'origine des maux français. Dans "Un berger à l'Elysée", à
paraître jeudi 27 octobre (aux éditions La Différence), Lassalle,
candidat "hors parti" à la présidentielle,
pose le constat d'un pouvoir politique inopérant, tenu en joue par une
"spéculation financière devenue folle" et en passe de "détruire notre
civilisation déjà chancelante". Celui d'un système démocratique qui, par
conséquent, a cessé d'agir dans l'intérêt du peuple, qui, lui, ne se
sent plus représenté. Encore moins au sein d'une Europe "sous l'emprise
des marchés", devenue machine à fabriquer des normes.
Fils de berger et élu rural, Jean Lassalle signe aussi un plaidoyer pour les territoires "abandonnés" et les agriculteurs français, profession décimée
par les effets conjugués du productivisme et de la libre concurrence.
Député atypique, connu pour sa grève de la faim en 2006, mais aussi pour
avoir entonné un chant béarnais en plein hémicycle, il entend
aujourd'hui proposer un "nouveau contrat social" et "remettre l'Etat à
l'écoute des Français". Extraits.
Le "Bisounours" et le grand capitaine de multinationale
"Beaucoup ne croient pas que ma candidature puisse aller au bout. Mais au printemps dernier, alors que je venais de
l’annoncer, un grand capitaine de multinationale m’a invité à déjeuner.
Après les échanges d’usage, il m’a expliqué combien était grande son
influence sur quelques-uns des médias les plus en vue de notre pays ; il m’a proposé tout de go de m’en ouvrir largement les portes ainsi que son aide financière. Il m’a semblé que son concours était largement supérieur à ce que prévoit la loi électorale.
"Mon père
n’était qu’un berger, lui ai-je répondu, mais je me rappelle son conseil
: 'Méfie-toi si quelqu’un te donne de l’argent sans que tu saches
pourquoi il te le donne. Quand tu l’oublieras, lui te retrouvera, et pas
forcément au moment où ça t’arrangera le plus.'
-
C’est bien ce que je pensais, vous êtes avant tout un Bisounours,
comment croyez-vous que MM. Hollande et Sarkozy obtiennent des budgets
de campagne électorale de 30 millions d’euros ?
- Est-il nécessaire de mettre autant d’argent dans une campagne électorale pour s’adresser aux Français, surtout pendant une période de crise comme celle que nous vivons ?
- Vous mélangez tout ! Aujourd’hui, pour peser et à plus forte raison pour gagner, il faut montrer les moyens financiers qu’on est capable de mobiliser."
Je sentais qu’il était agacé.
"Ces concours providentiels ne lient-ils pas de manière inexorable le futur président et même son outsider en leur faisant perdre leur indépendance au nom du peuple ? Pensez-vous que nous puissions encore réitérer, dans un pays aussi méfiant et en voie de paupérisation que le nôtre, des histoires du genre frégates de Taïwan, Clearstream ou autres ?
- Sornettes ! Pour qui vous prenez-vous ? Nous vivons dans un monde globalisé. La politique a toujours été, et restera toujours, une affaire de gros sous et aujourd’hui d’exposition médiatique. Vous ne disposez ni de l’un, ni de l’autre !
- Où me conduit votre proposition ? Si je l’accepte, ne faites-vous pas de moi immédiatement votre obligé, enfin votre chose ?
- Monsieur a la nuque raide. Ça ne fait rien. Vous verrez, on va vous mettre l’édredon. Il va couvrir vos coups de gueule, et on n’entendra même pas votre dernier soupir."
Je pressentais que mon épopée ne serait pas un long fleuve tranquille, mais je n’avais pas vu que le rapide était si proche."
François Bayrou et le "renoncement" du centre
"J’ai entretenu une longue complicité avec François Bayrou. Nous avons fait connaissance un peu avant mes vingt ans. Nous avons été élus ensemble, en 1982, à l’assemblée départementale. J’étais un maire et un conseiller général indépendant.
Je n’appartenais à aucun parti.
Quand je me suis présenté de nouveau en 1988, je l’ai rejoint au Centre des démocrates sociaux, le CDS. La moitié de ma famille était communiste, l’autre
gaulliste : moi, j’étais réfugié politique au centre ! J’y retrouvais
mon aspiration profonde à la démocratie sociale, qui donnait son nom au
parti ; et j’y rejoignais des hommes et des femmes d’une grande bienveillance, qui saisissaient la profondeur de mon engagement.
Nous avons cheminé en compagnons de route dans la vie politique, de jour comme de nuit.
J’ai accompagné avec cœur et conviction ses trois campagnes présidentielles. Il y a dix ans, dans un élan spectaculaire, il s’en est manqué de peu qu’il soit élu. Il avait pris la mesure de la mutation qui déjà secouait notre vieux monde.
[...]
Nous
avons réussi à faire entrer, dans l’esprit de nos contemporains, l’idée
que "centre" ne signifiait pas "ventre mou", "entre deux", "incapable
de choisir". Nous en avons fait au contraire, de manière déterminée, une
troisième voie. Il ne craignait ni l’écrasement physique entre les deux
blocs qui mettaient tout en œuvre pour nous réduire à une force
d’appoint, ni les quolibets. Rien ne nous fut épargné, notamment par
l’UMP, que Jacques Chirac et Alain Juppé avaient précisément créée pour intégrer de force le centre, et l’espoir qu’il représentait.
Nous avions voulu, pour notre famille politique, l’indépendance. J’ai toujours su qu’elle allait nous coûter cher et je n’ai pas été déçu.
L’indépendance n’a pas de prix. Comment détrôner la toute-puissance financière si l’on reste lié aux partis qu’elle enchaîne ?
Hélas,
le centre est rentré dans le rang. Il s’est refermé sur lui-même. Il a
renoncé à entraîner dans son sillage, et à libérer la France du système
qui l’asservit."
Des paysans précipités dans la crise
"Nos
agriculteurs étaient des hommes indépendants et fiers de leur métier,
ils le sont toujours, mais la PAC les a réduits à l’état de sous-traitants de grandes entreprises qui leur fournissent les semences, les intrants, et leur achètent leur production à des prix de plus en plus dérisoires.
Mon
grand-père, à soixante ans à l’époque, faisait cent vingt kilomètres à
pied aller-retour, pour œuvrer avec passion à l’essor du mutualisme
agricole et du Crédit du même nom. Il pensait que ces institutions
échapperaient au système bancaire traditionnel, pour ne dépendre
que de leurs adhérents. Hélas ! Depuis que le capitalisme financier a
tout envahi, la plupart des coopératives ont grossi et fusionné au point
d’échapper complètement aux paysans. Elles se sont spécialisées sur la
spéculation financière et le trading, elles sont devenues des banques aussi prédatrices que celles qui portent ce nom. Elles prennent la marge et laissent la misère aux paysans. Elles se sont trahies elles-mêmes.
[…]
Une
exploitation sur quatre a disparu entre 2000 et 2010. Il en reste moins
de 500.000, dont à peine 200.000 réellement productives. Parmi les
exploitants, de moins en moins de jeunes. Qui prendra la suite ? Combien d’emplois agricoles dans dix ans, à ce rythme ? Que deviendra notre pays sans agriculture ?
Les
décisions prises loin de leurs champs, de leurs bourgs ou de leurs
biotopes, ont précipité les paysans dans la crise. Quelques décennies
plus tard, nous ne pouvons que constater les dégâts. Combien aujourd’hui
s’en sortent dignement ? Combien sont endettés jusqu’à ne plus pouvoir
le dire ? Combien croulent sous une paperasserie qui n’est pas leur affaire ? Combien mettent la clé sous la porte, ayant perdu tout espoir ? Combien, hélas, mettent fin à leurs jours, dans le silence devenu glacial de nos campagnes, seulement déchiré l’espace d’un instant par le glas ?"
Bien accueilli dans un quartier ? "Personne ne le croira"
"Je dois être le seul homme politique à avoir traversé les trente quartiers les plus fracturés de notre pays. C’est là que se retrouve le sentiment d’abandon le plus cruel, le sentiment de ne plus faire partie de la même France.
À Montbéliard, en juillet 2013, je suis accompagné par un journaliste. Sur le coup de minuit, nous décidons d’aller faire une petite visite nocturne dans le quartier dit de la Petite-Hollande.
Le premier groupe que nous croisons, une trentaine de personnes, est en train de dîner sur un parking.
C’est l’époque du ramadan. Sans autre civilité, ils nous invitent. Ils
m’observent un peu, mais toute méfiance tombe lorsque l’un deux s’écrie :
"Mais c’est le député qui marche !"
Chacun raconte sa vie. Tous habitent ce quartier. Ils évoquent leurs familles séparées, dont certains membres
se sont vus refouler, tandis que d’autres ont été empêchés de les
rejoindre. Ils seraient tous prêts à travailler, "mais où ? Ça ferme
partout".
Quelques
mètres plus loin dans un angle plus sombre, une quinzaine d’hommes sont
assis sur le sol détrempé. Des bouteilles de whisky et de pastis à même
le sol. L’alcool délie les langues, la prise de contact s’avère plus
rapide mais plus tendue : est-ce que nous sommes de la police ?
L’embarras se dissipe. Ils ont entre quinze et trente ans, sont de
diverses origines, et ont pris l’habitude de venir tous les soirs. Deux
ou trois d’entre eux, qui n’habitent pas le quartier, travaillent. Les autres, avec des sourires entendus, affirment qu’ils se débrouillent. Ils souhaiteraient nous garder plus longtemps avec eux :
"Vous
pourrez dire demain que vous étiez cette nuit à la Petite-Hollande et
que vous y avez été très bien accueilli ! me lance l’un d’eux.
– Il peut toujours le dire, répond un autre, personne ne le croira."
Ils éclatent de rire.
Le lendemain matin, au petit déjeuner, nous apprenons qu’il y a eu des incidents dans la nuit à la Petite-Hollande. Vers 4 heures du matin, une maison et une voiture ont été incendiées. La police et les pompiers ont dû intervenir."
Un système "voué à engendrer le malheur et la mort"
"Le monde bascule sous nos yeux, emporté par une
spéculation financière devenue folle, sans contre-pouvoirs. Nous l’y
avons bien aidé. Notre pays vit sous le joug terrifiant de la dictature
financière.
Quand le mur de Berlin est tombé, quand les peuples
de l’Est ont été libérés de l’empire soviétique, et ceux de l’Ouest, de
sa menace, le débat politique s’est éteint. Tous les partis au pouvoir
ont fait le même choix : celui de laisser l’argent mener le monde. La
langue politique s’y est perdue. Celle de l’argent a pris sa place.
La
chute du Mur a fait croire à beaucoup que le risque de guerre était
écarté, que la paix et la prospérité étaient assurées. Voilà que la
terreur revient, et ils sont surpris. Mais un système qui ignore les hommes, qui refuse de considérer l’intérêt commun, qui esquive le débat, est voué à engendrer la violence, le malheur et la mort.
Ce système, financiarisé comme il ne l’a jamais été dans l’Histoire, est en train de détruire notre civilisation déjà chancelante. Il nous enfonce dans une nouvelle guerre mondiale, déjà largement engagée."
Le maire, dernier rempart du "désespoir"
"Qui pourra un jour réinventer ce rôle primordial de proximité entre l’État et le citoyen, que le maire incarne au quotidien ? À qui nos compatriotes s’adresseront-ils lorsque ces derniers auront disparu ?
Combien
d’heures passent le maire et son équipe à veiller à ce que Pierre
n’attaque pas Jacques, éviter qu’Adeline et Serge ne harcèlent Myriam ? À
écouter, à parler sans cesse, pour que ces cinq-là ne se retrouvent pas devant les tribunaux. Écouter. Oui, écouter celui que le désespoir a gagné sans que rien en apparence ne le
laisse présager. Écouter, écouter encore, pour extirper de la tête de
Paul son idée fixe de se suicider. Il ne se voit pas d’avenir, sans
travail, sans amour. Seul. Il aurait pu se confier à un prêtre. Trop
tard, trop loin. Il se serait plus facilement encore confié à son
médecin, si ce dernier n’était trop loin, depuis longtemps déjà. Il
aurait même fini par se confier au gendarme, ou à une assistante sociale. Trop tard. Eux aussi sont partis ou sur le point de le faire.
Combien
de situations le maire n’a-t-il pas arrangé avec le brigadier de
gendarmerie, l’assistante sociale, le prêtre ou le médecin ? Il ne reste
plus que lui, avant les psys de la ville. Trop loin. Trop tard. À qui se confier désormais ?
Au nouveau président de la communauté de communes, pour qui on n’a jamais demandé à Paul de voter, et qui réside 50 kilomètres trop loin ?"
(Copyright Editions La Différence)










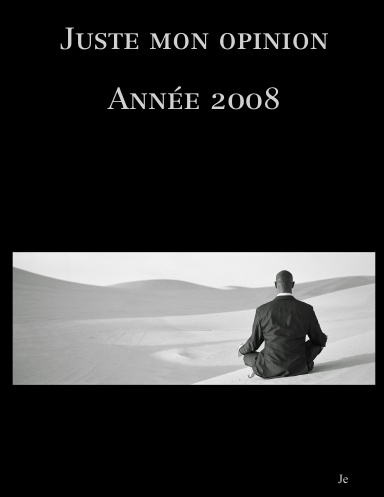
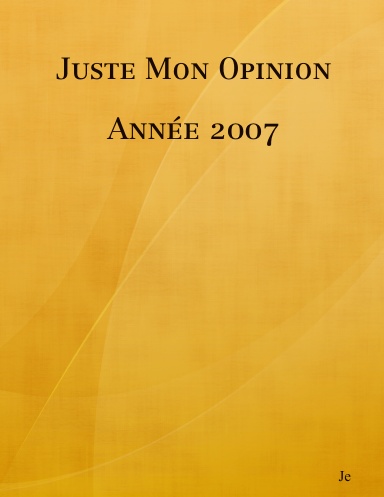
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire