)
Echange et pouvoir: philosophie de la chefferie indienne
Pierre Clastres
1962
D’où vient que pendant si longtemps, les ethnologues n’aient porté qu’un intérêt assez faible aux problèmes de l’organisation politique des sociétés primitives ? Mais les passer sous silence signifiait peut-être que l’on ne voyait précisément là rien de problématique. Et, de fait, il semble bien que jusqu’à une date récente, les conceptions ethnologiques aient oscillé entre deux idées, opposées et cependant complémentaires, du pouvoir politique : pour l’une, les sociétés primitives sont, à la limite, dépourvues pour la plupart de toute forme réelle d’organisation politique ; l’absence d’un organe apparent et effectif du pouvoir a conduit à refuser la fonction même de ce pouvoir à ces sociétés, dès lors jugées comme stagnant en un stade historique pré-politique ou anarchique. Pour la seconde, au contraire, une minorité parmi les sociétés primitives a dépassé l’anarchie primordiale pour accéder à ce mode d’être, seul authentiquement humain, du groupe : l’institution politique ; mais l’on voit alors le « défaut », qui caractérisait la masse des sociétés, se convertir ici en « excès », et l’institution se pervertir en despotisme ou tyrannie. Tout se passe donc comme si les sociétés primitives se trouvaient placées devant une alternative : ou bien le défaut de l’institution et son horizon anarchique, ou bien l’excès de cette même institution et son destin despotique. Mais cette alternative est en fait un dilemme, car, en deçà ou au delà de la véritable condition politique, c’est toujours cette dernière qui échappe à l’homme primitif. Et c’est bien en la certitude de l’échec quasi fatal à quoi naïvement l’ethnologie commençante condamnait les non-occidentaux, que se décèle cette complémentarité des deux extrêmes, s’accordant chacun pour soi, l’un par excès, l’autre par défaut, à nier la « juste mesure » du pouvoir politique. De sorte qu’en fonction des traits les plus apparemment perceptibles du pouvoir, les sociétés sont réparties, schématiquement, en deux grandes classes dont le dénominateur commun est d’exister comme caricature du « bon » pouvoir, à quoi elles sont mesurées. Car ce qui se repère ici, sous une forme plus subtile de se conformer à l’apparence, c’est l’« attitude naturelle » de l’ethnocentrisme, pour qui, en fin de compte, le pouvoir rationnel est une institution exclusivement occidentale. A méconnaître ainsi la différence entre l’objet et sa mesure, comme si tout type d’institution politique devait être analysé et évalué en fonction du modèle occidental, on procède non seulement à des valorisations évidemment arbitraires, mais on laisse se créer un véritable « obstacle épistémologique » à la constitution d’une anthropologie politique.
L’Amérique du Sud offre à cet égard une illustration très remarquable de cette tendance à inscrire les sociétés primitives dans le cadre de cette macrotypologie dualiste : et l’on oppose au séparatisme anarchique de la majorité des sociétés indiennes, la massivité de l’organisation incaïque, « empire totalitaire du passé ». Et de fait, à les considérer selon leur organisation politique, c’est essentiellement par le sens de la démocratie et le goût de l’égalité que se distinguent la plupart des sociétés indiennes d’Amérique. Les premiers voyageurs du Brésil et les ethnographes qui les suivirent l’ont maintes fois souligné : la propriété la plus remarquable du chef indien consiste dans son manque à peu près complet d’autorité ; la fonction politique paraît n’être, chez ces populations, que très faiblement différenciée. Malgré sa dispersion et son insuffisance, la documentation que nous possédons vient confirmer cette vive impression de démocratie, à laquelle furent sensibles tous les américanistes. Parmi l’énorme masse des tribus recensées en Amérique du Sud, l’autorité de la chefferie n’est explicitement attestée que pour quelques groupes, tels que les Taïno des îles, les Caquetio, les Jirajira, ou les Otomac. Mais il convient de remarquer que ces groupes, presque tous Arawak, sont localisés dans le nord-ouest de l’Amérique du Sud, et que leur organisation sociale présente une nette stratification en castes : on ne retrouve ce dernier trait que chez les tribus Guaycuru et Arawak (Guana) du Chaco. On peut en outre supposer que les sociétés du nord-ouest se rattachent à une tradition culturelle plus proche de la civilisation Chibcha et de l’aire andine que des cultures dites de la « Forêt Tropicale ». C’est donc bien le défaut de stratification sociale et d’autorité du pouvoir que l’on doit retenir comme trait pertinent de l’organisation politique du plus grand nombre des sociétés indiennes : certaines d’entre elles, comme les Ona et les Yahgan de la Terre de Feu, ne possèdent même pas l’institution de la chefferie ; et l’on dit des Jivaro que leur langue ne possédait pas de terme pour désigner le chef.
A un esprit formé par des cultures où le pouvoir politique est doué de puissance effective, le statut particulier de la chefferie américaine s’impose donc comme de nature paradoxale ; qu’est-ce donc que ce pouvoir privé des moyens de s’exercer ? Par quoi se définit le chef, puisque l’autorité lui fait défaut ? Et l’on serait vite tenté, cédant aux tentations d’un évolutionnisme plus ou moins conscient, de conclure au caractère épiphénoménal du pouvoir politique dans ces sociétés, que leur archaïsme empêcherait d’inventer une authentique forme politique. Résoudre ainsi le problème n’amènerait cependant qu’à le reposer d’une manière différente : d’où une telle institution sans « substance » tire-t-elle la force de subsister ? Car, ce qu’il s’agit de comprendre, c’est la bizarre persistance d’un « pouvoir » à peu près impuissant, d’une chefferie sans autorité, d’une fonction qui fonctionne à vide.
Mais une telle façon d’articuler les éléments de la question implique une théorie sous-jacente du pouvoir : la fonction politique est une fonction de coercition. La chefferie indienne, ne présentant pas ce caractère, ne ressortit donc que nominalement au champ des phénomènes politiques : elle y est marginale. Cette incapacité à concevoir un modèle autre qu’occidental du pouvoir, amène très naturellement à dénier le fait politique même à des sociétés assez arriérées pour ignorer que le pouvoir doit être coercitif : les premiers Portugais arrivés au Brésil ne manquèrent pas de s’y tromper et crurent que les Tupinamba étaient « sans foi, sans loi, sans roi ». C’est par conséquent l’ethnocentrisme immanent à une telle visée de la question, qu’il faut écarter : briser la relation « nécessaire » entre pouvoir et coercition ; et par suite, supposer que, du moins pour les sociétés américaines, la fonction politique trouve à se déployer un lieu différent, déterminé par le rapport singulier qu’entretiennent ces sociétés et leur pouvoir ; rapport, donc, sur lequel il faut maintenent s’interroger.
En un texte de 1948, R. Lowie, analysant les traits distinctifs du type de chef ci-dessus évoqué, par lui nommé « titular chief », isole trois propriétés essentielles du leader indien, que leur récurrence au long des deux Amériques permet de saisir comme condition nécessaire du pouvoir dans ces régions :
i° Le chef est un « faiseur de paix » ; il est l’instance modératrice du groupe, ainsi que l’atteste la division fréquente du pouvoir en civil et militaire.
2° II doit être généreux de ses biens, et ne peut se permettre, sans se déjuger, de repousser les incessantes demandes de ses « administrés ».
3 Seul un bon orateur peut accéder à la chefferie.
Ce schéma de la triple qualification nécessaire au détenteur de la fonction politique est certainement aussi pertinent pour les sociétés sud- que nord- américaines. Tout d’abord, en effet, il est remarquable que les traits de la chefferie soient fort opposés en temps de guerre et en temps de paix, et que, très souvent, la direction du groupe soit assumée par deux individus différents, chez les Cubeo par exemple, ou chez les tribus de l’Orénoque : il existe un pouvoir civil et un pouvoir militaire. Pendant l’expédition guerrière, le chef dispose d’un pouvoir considérable, parfois même absolu, sur l’ensemble des guerriers. Mais, la paix revenue, le chef de guerre perd toute sa puissance. Le modèle du pouvoir coercitif n’est donc accepté qu’en des occasions exceptionnelles, lorsque le groupe est confronté à une menace extérieure. Mais la conjonction du pouvoir et de la coercition cesse dès que le groupe n’a rapport qu’à soi-même. Ainsi, l’autorité des chefs Tupinamba, incontestée pendant les expéditions guerrières, se trouvait étroitement soumise au contrôle du conseil des anciens en temps de paix. De même, les Jivaro n’auraient de chef qu’en temps de guerre. Le pouvoir normal, civil, fondé sur le « consensus omnium » et non sur la contrainte, est ainsi de nature profondément pacifique ; sa fonction est également « pacifiante » : le chef a la charge du maintien de la paix et de l’harmonie dans le groupe. Aussi doit-il apaiser les querelles, régler les différends, non en usant d’une force qu’il ne possède pas et qui ne serait pas reconnue, mais en se fiant aux seules vertus de son prestige, de son équité et de sa parole. Plus qu’un juge qui sanctionne, il est un arbitre qui cherche à réconcilier. Il n’est donc pas surprenant de constater que les fonctions judiciaires de la chefferie soient si rares : si le chef échoue à réconcilier les parties adverses, il ne peut empêcher le différend de se muer en « feud ». Et ceci révèle bien la disjonction entre le pouvoir et la coercition.
Le second trait caractéristique de la chefferie indienne, la générosité, paraît être plus qu’un devoir : une servitude. Les ethnologues ont en effet noté chez les populations les plus diverses d’Amérique du Sud, que cette obligation de donner, à quoi est tenu le chef, est en fait vécue par les Indiens comme une sorte de droit de le soumettre à un pillage permanent. Et si le malheureux leader cherche à freiner cette fuite de cadeaux, tout prestige, tout pouvoir lui sont. immédiatement déniés. Francis Huxley écrit à propos des Urubu : « C’est le rôle du chef d’être généreux et de donner tout ce qu’on lui demande : dans certaines tribus indiennes, on peut toujours reconnaître le chef à ce qu’il possède moins que les autres et porte les ornements les plus minables. Le reste est parti en cadeaux ). Avarice et pouvoir ne sont pas compatibles ; pour être chef il faut être généreux.
Outre ce goût si vif pour les possessions du chef, les Indiens apprécient fortement ses paroles : le talent oratoire est une condition et aussi un moyen du pouvoir politique. Nombreuses sont les tribus où le chef doit tous les jours, soit à l’aube, soit au crépuscule, gratifier d’un discours édifiant les gens de son groupe : les chefs Pilaga, Sherenté, Tupinamba, exhortent chaque jour leur peuple à vivre selon la tradition. Car la thématique de leur discours est étroitement reliée à leur fonction de « faiseur de paix ». « … Le thème habituel de ces harangues est la paix, l’harmonie et l’honnêteté, vertus recommandées à tous les gens de la tribu »4. Sans doute le chef prêche-t-il parfois dans le désert : les Toba du Chaco ou les Trumai du Haut-Xingu ne prêtent souvent pas la moindre attention au discours de leur leader, qui parle ainsi dans l’indifférence générale. Ceci ne doit cependant pas nous masquer l’amour des Indiens pour la parole : un Chiriguano n’expliquait-il pas l’accession d’une femme à la chefferie en disant : « Son père lui avait appris à parler » ?
La littérature ethnographique atteste donc bien la présence de ces trois traits essentiels de la chefferie. Cependant, l’aire sud-américaine (à l’exclusion des cultures andines, dont il ne sera pas question ici) présente un trait supplémentaire à ajouter aux trois dégagés par Lowie : presque toutes ces sociétés, quels que soient leur type d’unité socio-politique et leur taille démographique, reconnaissent la polygamie ; mais presque toutes également la reconnaissent comme privilège le plus souvent exclusif du chef. La dimension des groupes varie fortement en Amérique du Sud, selon le milieu géographique, le mode d’acquisition de la nourriture, le niveau technologique : une bande de nomades Guayaki ou Siriono, peuples sans agriculture, compte rarement plus de trente personnes. Par contre, les villages Tupinamba ou Guarani, agriculteurs sédentaires, rassemblaient parfois plus de mille personnes. La grande maison collective des Jivaro abrite de quatre-vingts à trois cents résidents et la communauté Witoto comprend environ cent personnes. Par conséquent, selon les aires culturelles, la taille moyenne des unités socio-politiques peut subir des variations considérables. Il n’en est que plus frappant de constater que la plupart de ces cultures, de la misérable bande Guayaki à l’énorme village Tupi, reconnaissent et admettent le modèle du mariage plural, fréquemment d’ailleurs sous la forme de la polygynie sororale. Il faut admettre, par conséquent, que le mariage polygyne n’est pas fonction d’une densité démographique minimum du groupe, puisque nous voyons cette institution possédée aussi bien par la bande Guayaki et par le village Tupi trente ou quarante fois plus nombreux. On peut estimer que la polygynie, lorsqu’elle est mise en pratique au sein d’une masse importante de population, n’entraîne pas de trop graves perturbations pour le groupe. Mais qu’en est-il lorsqu’elle concerne des unités aussi faibles que la bande Nambikwara, Guayaki ou Siriono ? Elle ne peut qu’affecter fortement la vie du groupe et celui-ci met sans doute en avant de solides « raisons » pour l’accepter néanmoins, raisons qu’il faudra tenter d’élucider.
Il est à ce propos intéressant d’interroger le matériel ethnographique, malgré ses nombreuses lacunes : certes, nous ne possédons, sur de nombreuses tribus, que de très maigres renseignements ; parfois même ne connaît-on d’une tribu que le nom sous lequel elle était désignée. Il semble cependant que l’on puisse accorder à certaines récurrences une vraisemblance statistique. Si Ton retient le chiffre approximatif, mais probable, d’un total d’environ deux cents ethnies pour toute l’Amérique du Sud, on s’aperçoit que, sur ce total, l’information dont nous pouvons disposer n’établit formellement une stricte monogamie que pour une dizaine de groupes à peine : ce sont par exemple les Palikur de Guyane, les Apinayé et les Timbira du groupe Gé, ou les Yagua du nord de l’Amazone. Sans assigner à ces calculs une exactitude qu’ils ne possèdent certainement pas, ils sont cependant indicatifs d’un ordre de grandeur : un vingtième à peine des sociétés indiennes pratique la monogamie rigoureuse. C’est dire que la plupart des groupes reconnaissent la polygynie et que celle-ci est quasi continentale en son extension.
Mais l’on doit noter également que la polygynie indienne est strictement limitée à une petite minorité d’individus, presque toujours les chefs. Et l’on comprend d’ailleurs qu’il n’en puisse être autrement. Si l’on considère en effet que la sex-ratio naturelle, ou rapport numérique des sexes, ne saurait jamais être assez bas pour permettre à chaque homme d’épouser plus d’une femme, on voit qu’une polygynie généralisée est biologiquement impossible : elle est donc cultu- rellement limitée à certains individus. Cette détermination naturelle est confirmée par l’examen des données ethnographiques : sur 180 ou 190 tribus pratiquant la polygynie, une dizaine seulement ne lui assigne pas de limite ; c’est-à-dire que tout homme adulte de ces tribus peut épouser plus d’une femme. Ce sont par exemple les Achagua, Arawak du nord-ouest, les Chibcha, les Jivaro, ou les Roucouyennes, Carib de Guyane. Or les Achagua et les Chibcha, qui appartiennent à l’aire culturelle dite circum-Carib, commune au Venezuela et à la Colombie, étaient très différents du reste des populations sud-américaines ; engagés dans un processus de profonde stratification sociale, ils réduisaient en esclavage leurs voisins moins puissants et bénéficiaient ainsi d’un apport constant et important de prisonnières, prises aussitôt comme épouses complémentaires. En ce qui concerne les Jivaro, c’est sans doute leur passion pour la guerre et la chasse aux têtes, qui, entraînant une forte mortalité de jeunes guerriers, permettaient à la plupart des hommes de pratiquer la polygynie. Les Roucouyennes, et avec eux plusieurs autres groupes Carib du Venezuela, étaient également des populations très belliqueuses : leurs expéditions militaires visaient le plus souvent à se procurer des esclaves et des femmes secondaires.
Tout ceci nous montre d’abord la rareté, naturellement déterminée, de la polygynie générale. Nous voyons d’autre part que, lorsqu’elle n’est pas restreinte au chef, cette possibilité se fonde sur des déterminations culturelles : constitution de classes sociales, pratique de l’esclavage, activité guerrière. Apparemment, ces dernières sociétés semblent plus démocratiques que les autres, puisque la polygynie cesse d’y être le privilège d’un seul. Et de fait, l’opposition semble plus tranchée, entre ce chef Iquito, possesseur de douze femmes et ces hommes astreints à la monogamie, qu’entre le chef Achagua et les hommes de son groupe., auxquels la polygynie est également permise. Rappelons cependant que les sociétés du nord- ouest étaient déjà fortement stratifiées et qu’une aristocratie de riches nobles détenait, de par sa richesse même, le moyen d’être plus polygynes, si l’on peut dire, que les « plébéiens » moins favorisés : le modèle du mariage par achat permettait aux hommes riches d’acquérir un nombre de femmes plus grand. De sorte qu’entre la polygynie comme privilège du chef et la polygynie généralisée, la différence n’est pas de nature, mais de degré : un plébéien Chibcha ou Achagua ne pouvait guère épouser plus de deux ou trois femmes, alors qu’un célèbre chef du nord- ouest, Guaramental, en possédait deux cents.
De l’analyse précédente, il est ainsi légitime de retenir que pour la plupart des sociétés sud-américaines l’institution matrimoniale de la polygynie est étroitement articulée à l’institution politique du pouvoir. La spécificité de ce lien ne s’abolirait qu’avec un rétablissement des conditions de la monogamie : une polygynie d’égale extension pour tous les hommes du groupe. Or, le bref examen des quelques sociétés possédant le modèle généralisé du mariage plural révèle que l’opposition entre le chef et le reste des hommes se maintient et même se renforce.
Il existe enfin un dernier groupe de tribus qui, sans permettre une polygynie générale, ne la restreint cependant pas au seul chef, puisque les chasseurs adroits ou les guerriers fameux peuvent épouser plusieurs femmes. Ce sont par exemple les Guarani, les Tupinamba ou les Caïngang. Notons immédiatement qu’en ce qui concerne les deux premiers groupes, pouvoir politique et pouvoir surnaturel étaient presque toujours assumés par le même individu : le chef était en même temps le chaman du groupe. Ce cumul des pouvoirs profanes et sacrés, se renforçant l’un l’autre d’être unifiés, permet de comprendre que les chefs-chamans Guarani aient pu mettre en mouvement des masses de plusieurs milliers d’Indiens, qu’ils conduisaient, sillonnant l’Amérique, vers la Terre sans Mal. Les chamans sud- américains disposent d’ailleurs souvent d’une influence politique en général issue de la crainte et du respect qu’ils inspirent. C’est pourquoi, même lorsque pouvoir civil et pouvoir religieux se répartissent entre individus différents, comme chez les Witoto, le chaman partage le privilège polygynique du leader, car tous deux sont hommes « de pouvoir ».
C’est également parce qu’investis d’un pouvoir politique diffus que certains guerriers Tupinamba, les plus heureux au combat, pouvaient posséder des épouses secondaires, souvent prisonnières arrachées au groupe vaincu. Car le « Conseil », auquel le chef devait soumettre toutes ses décisions, était précisément composé en partie des guerriers les plus brillants ; et c’est parmi ces derniers qu’en général l’assemblée des hommes choisissait le nouveau chef lorsque le fils du leader mort était estimé inapte à l’exercice de cette fonction. Si d’autre part certains groupes reconnaissent la polygynie comme privilège du chef, et aussi des meilleurs chasseurs, c’est que la chasse, comme activité économique, y revêt une importance particulière sanctionnée par l’influence que confère à l’homme habile son adresse à rapporter beaucoup de gibier : chez les populations comme les Puri-Coroado, les Caïngang, ou les Ipurina du Jurua-Purus, la chasse constitue une source décisive de nourriture ; par suite, les meilleurs chasseurs acquièrent un statut social et un « poids » politique conforme à leur qualification professionnelle. La principale tâche du leader étant de veiller au bien-être de son groupe, le chef Ipurina ou Caïngang sera l’un des meilleurs chasseurs, dont le groupe fournit généralement les hommes éligibles à la chefferie. Par conséquent, outre le fait que seul un bon chasseur est en mesure de subvenir aux besoins d’une famille polygyne, la chasse, activité économique essentielle pour la survie du groupe, confère aux hommes qui y réussissent le mieux, une importance politique certaine. En permettant la polygynie aux plus efficaces de ses fournisseurs de nourriture, le groupe, prenant en quelque sorte une hypothèque sur l’avenir, leur reconnaît implicitement la qualité de leaders possibles. Il faut cependant signaler que cette polygynie, loin d’être égalitaire, favorise toujours le chef effectif du groupe.
Le modèle polygynique du mariage, envisagé selon ces diverses extensions : générale ou restreinte, soit au chef seul, soit au chef et à une faible minorité d’hommes, nous a donc constamment renvoyé à la vie politique du groupe ; c’est sur cet horizon que la polygynie dessine sa figure, et c’est peut-être là le lieu où pourra se lire le sens de sa fonction.
C’est donc bien par quatre traits qu’en Amérique du Sud se distingue le chef. Comme tel, il est un « apaiseur professionnel » ; de plus il doit être généreux et bon orateur ; enfin la polygynie est son privilège.
Une distinction s’impose néanmoins entre le premier de ces critères et les trois suivants. Ceux-ci définissent l’ensemble des prestations et contre-prestations, par quoi se maintient l’équilibre entre la structure sociale et l’institution politique : le leader exerce un droit sur un nombre anormal de femmes du groupe ; ce dernier en revanche est en droit d’exiger de son chef générosité de biens et talent oratoire. Cette relation d’apparence échangiste se détermine ainsi à un niveau essentiel de la société, un niveau proprement sociologique qui concerne la structure même du groupe comme tel. La fonction modératrice du chef se déploie au contraire dans l’élément différent, et moins fondamental, de la pratique strictement politique. On ne peut en effet, comme paraît le faire Lowie, situer au même plan de réalité sociologique, d’une part ce qui se définit, au terme de l’analyse précédente, comme l’ensemble des conditions de possibilité de la sphère politique, et d’autre part ce qui constitue la mise en œuvre effective, vécue comme telle, des fonctions quotidiennes de l’institution. Traiter comme éléments homogènes le mode de constitution du pouvoir et le mode d’opérer du pouvoir constitué, conduirait en quelque sorte à confondre l’être et le faire de la chefferie, le transcendental et l’empirique de l’institution. Humbles en leur portée, les fonctions du chef n’en sont cependant pas moins contrôlées par l’opinion publique. Planificateur des activités économiques et cérémonielles du groupe, le leader ne possède aucun pouvoir décisoire ; il n’est jamais assuré que ses « ordres » seront exécutés : cette fragilité permanente d’un pouvoir sans cesse contesté donne sa tonalité à l’exercice de la fonction : le pouvoir du chef dépend du bon vouloir du groupe. On comprend dés lors l’intérêt direct du chef à maintenir la paix : l’irruption d’une crise destructrice de l’harmonie interne appelle l’intervention du pouvoir, mais suscite en même temps cette intention de contestation que le chef n’a pas les moyens de surmonter.
La fonction, en s’exerçant, indique ainsi ce dont on cherche ici le sens : l’impuissance de l’institution. Mais c’est au plan de la structure, c’est-à-dire à un autre niveau, que réside, masqué, ce sens. Comme activité concrète de la fonction, la pratique du chef ne renvoie donc pas au même ordre de phénomènes que les trois autres critères ; elle les laisse subsister comme une unité structuralement articulée à l’essence même de la société.
Il est, en effet, remarquable de constater que cette trinité de prédicats : don oratoire, générosité, polygynie, attachés à la personne du leader, concerne les mêmes éléments dont l’échange et la circulation constituent la société comme telle, et sanctionnent le passage de la nature à la culture. C’est d’abord par les trois niveaux fondamentaux de l’échange des biens, des femmes et des mots que se définit la société ; c’est également par référence immédiate à ces trois types de « signes » que se constitue la sphère politique des sociétés indiennes. Le pouvoir a donc ici rapport (pour autant que l’on reconnaisse à cette concurrence une valeur autre que celle d’une coïncidence sans signification) aux trois niveaux structuraux essentiels de la société, c’est-à-dire au cœur même de l’univers de la communication. C’est donc à élucider la nature de ce rapport que l’on doit s’attacher c-ésormais, pour tenter d’en dégager les implications structurales.
Apparemment, le pouvoir est fidèle à la loi d’échange qui fonde et régit la société ; tout se passe, semble-t-il, comme si le chef recevait une partie des femmes eu groupe, en échange de biens économiques et de signes linguistiques, la seule différence résultant de ce qu’ici les unités échangistes sont d’une part un individu, de l’autre le groupe pris globalement. Une telle interprétation, cependant, fondée sur l’impression que le principe de réciprocité détermine le rapport entre pouvoir et société, se révèle vite insuffisante : on sait que les sociétés indiennes d’Amérique du Sud ne possèdent en général qu’une technologie relativement rudimentaire, et que, par conséquent, aucun individu, fût-il chef, ne peut concentrer entre ses mains beaucoup de richesses matérielles. Le prestige d’un chef, on l’a vu, tient en grande partie à sa générosité. Mais d’autre part les exigences des Indiens dépassent très souvent les possibilités immédiates du chef. Celui-ci est donc contraint, sous peine de se voir rapidement abandonné par la plupart de ses gens, de tenter de satisfaire leurs demandes. Sans doute ses épouses peuvent-elles, dans une grande mesure, le soutenir dans sa tâche : l’exemple des Nambikwara illustre bien le rôle décisif des femmes du chef. Mais si certains objets — arcs, flèches, ornements masculins — , dont sont friands chasseurs et guerriers, ne peuvent être fabriqués que par leur chef ; or, ses capacités de production sont fort réduites, et ceci limite aussitôt la portée des prestations en biens du chef au groupe. On sait aussi, d’autre part, que pour les sociétés « primitives », les femmes sont les valeurs par excellence. Comment prétendre, en ce cas, que cet échange apparent mette en jeu deux « masses » équivalentes de valeurs, équivalence à laquelle on devrait cependant s’attendre, si le principe de réciprocité est bien à l’œuvre pour articuler la société à son pouvoir ? Il est bien évident que pour le groupe, qui s’est dessaisi au profit du chef, d’une quantité importante de ses valeurs les plus essentielles — les femmes — , les harangues quotidiennes et les maigres bien économiques dont peut disposer le leader, ne constituent par une compensation équivalente. Et ce, d’autant moins qu’en dépit de son manque d’autorité, le chef jouit cependant d’un statut social enviable. L’inégalité de l’ « échange » est frappante : elle ne s’expliquerait qu’au sein de sociétés où le pouvoir, muni d’une autorité effective, serait par là même nettement différencié du reste du groupe. Or, c’est précisément cette autorité qui fait défaut au chef indien : comment dès lors comprendre qu’une fonction, gratifiée de privilèges exorbitants, soit par ailleurs impuissante à s’exercer ?
A vouloir analyser en termes d’échange la relation du pouvoir au groupe, on ne parvient qu’à mieux en faire éclater le paradoxe. Considérons donc le statut de chacun des trois niveaux de communication, pris en lui-même, au sein de la sphère politique. Il est clair qu’en ce qui concerne les femmes, leur circulation se fait à « sens unique » : du groupe vers le chef ; car ce dernier serait bien incapable de remettre en circuit, vers le groupe, un nombre de femmes équivalent à celui qu’il en a reçu. Certes les épouses du chef lui donneront des filles qui seront plus tard autant d’épouses potentielles pour les jeunes gens du groupe. Mais on doit considérer que la réinsertion des filles dans le cycle des échanges matrimoniaux ne vient pas compenser la polygynie du père. En effet, dans la plupart des sociétés sud-américaines, la chefferie s’hérite patrilinéairement. Ainsi, et compte tenu des aptitudes individuelles, le fils du chef, ou à défaut, le fils du frère du chef, sera le nouveau leader de la communauté. Et, en même temps que la charge, il recueillera le privilège de la fonction, à savoir la polygynie. L’exercice de ce privilège annule donc, à chaque génération, l’effet de ce qui pourrait neutraliser, par le biais des filles, la polygynie de la génération précédente. Ce n’est pas sur le plan diachronique des générations successives que se joue le drame du pouvoir, mais sur le plan synchronique de la structure du groupe. L’avènement d’un chef reproduit chaque fois la même situation ; cette structure de répétition ne s’abolirait que dans la perspective cyclique d’un pouvoir qui parcourrait successivement toutes les familles du groupe, le chef étant choisi, à chaque génération, dans une famille différente, jusqu’à retrouver la première famille, inaugurant ainsi un nouveau cycle. Mais la charge est héréditaire : il ne s’agit donc pas ici d’échange, mais de don pur et simple du groupe à son leader, don sans contrepartie, en apparence destiné à sanctionner le statut social du détenteur d’une charge instituée pour ne pas s’exercer.
Si l’on se tourne vers le niveau économique de l’échange, on s’aperçoit que les biens subissent le même traitement : c’est uniquement du chef vers leur groupe que s’effectue leur mouvement. Les sociétés indiennes d’Amérique du Sud sont en effet rarement tenues à des prestations économiques envers leur leader et ce dernier, comme tout un chacun, doit cultiver son manioc et tuer son gibier. Exception faite de certaines sociétés du nord-ouest de l’Amérique du Sud, les privilèges de la chefferie ne se situent généralement pas sur le plan matériel, et seules quelques tribus font de l’oisiveté la marque d’un statut social supérieur : les Manasi de Bolivie ou les Guarani cultivent les jardins du chef et rassemblent ses récoltes. Encore faut-il ajouter que, chez les Guarani, l’usage de ce droit honore peut-être moins le chef que le chaman. Quoi qu’il en soit, la majorité des leaders indiens est loin d’offrir l’image d’un roi fainéant : bien au contraire, le chef, obligé de répondre à la générosité qu’on attend de lui, doit sans cesse songer à se procurer des cadeaux à offrir à ses gens. Le commerce avec d’autres groupes peut être une source de biens ; mais plus souvent, c’est à son ingéniosité et son travail personnels que le chef se fie. De sorte que, curieusement, c’est le leader qui, en Amérique du Sud, travaille le plus durement. En outre la rareté des biens, interdisant l’accumulation de surplus, contribue à renforcer l’absence de réciprocité de leur circulation.
Le statut enfin des signes linguistiques est encore plus évident : en des sociétés qui ont su protéger le langage de la dégradation que lui infligent les nôtres, la parole est plus qu’un privilège, un devoir du chef : c’est à lui que revient la maîtrise des mots, au point que l’on a pu écrire, au sujet d’une tribu nord-américaine : « On peut dire, non que le chef est un homme qui parle, mais que celui qui parle est un chef », formule aisément applicable à tout le continent sud-américain. Car l’exercice de ce quasi-monopole du chef sur le langage se renforce encore de ce que les Indiens ne l’appréhendent nullement comme une frustration. Le partage est si nettement établi, que les deux assistants du leader Trumaï, par exemple, bien que jouissant d’un certain prestige, ne peuvent parler comme le chef : non en vertu d’une interdiction extérieure, mais en raison du sentiment que l’activité parlante serait un affront à la fois au chef et au langage ; car, dit un informateur, tout autre que le chef « aurait honte » de parler comme lui.
Dans la mesure où, refusant l’idée d’un échange des femmes du groupe contre les biens et les messages du chef, on examine par conséquent le mouvement de chaque « signe » selon son circuit propre, on découvre que ce triple mouvement présente une dimension négative commune qui assigne à ces trois types de « signes » un destin identique : ils n’apparaissent plus comme des valeurs d’échange, la réciprocité cesse de régler leur circulation, et chacun d’eux tombe dès lors à l’extérieur de l’univers de la communication. Une relation originale entre la région du pouvoir et l’essence du groupe se dévoile donc ici : le pouvoir entretient un rapport privilégié aux éléments dont le mouvement réciproque fonde la structure même de la société ; mais cette relation, en leur déniant une valeur qui est d’échange au niveau du groupe, instaure la sphère politique non seulement comme extérieure à la structure du groupe, mais bien plus comme négatrice de celle-ci : le pouvoir est contre le groupe, et le refus de la réciprocité, comme dimension ontologique de la société, est le refus de la société elle-même.
Une telle conclusion, articulée à la prémisse de l’impuissance du chef dans les sociétés indiennes, peut sembler paradoxale ; c’est en elle cependant que se dénoue le problème initial : l’absence d’autorité de la chefferie. En effet, pour qu’un aspect de la structure sociale soit en mesure d’exercer une influence quelconque sur cette structure, il faut, à tout le moins, que le rapport entre ce système particulier et le système global ne soit pas entièrement négatif. C’est à la condition d’être en quelque sorte immanente au groupe, que pourra se déployer effectivement la fonction politique. Or celle-ci, dans les sociétés indiennes, se trouve exclue du groupe, et même exclusive de lui : c’est donc dans la relation négative entretenue avec le groupe que s’enracine l’impuissance de la fonction politique ; le rejet de celle-ci à l’extérieur de la société est le moyen même de la réduire à l’impuissance.
Concevoir ainsi le rapport du pouvoir et de la société chez les populations indiennes d’Amérique du Sud peut sembler impliquer une métaphysique finaliste, selon laquelle une volonté mystérieuse userait de moyens détournés afin de dénier au pouvoir politique précisément sa qualité de pouvoir. Il ne s’agit point cependant de causes finales ; les phénomènes ici analysés ressortissent au champ de l’activité inconsciente par laquelle le groupe élabore ses modèles : et c’est le modèle structural de la relation du groupe social au pouvoir politique que l’on tente de découvrir. Ce modèle permet d’intégrer en soi des données perçues comme contradictoires au premier abord. A cette étape de l’analyse, nous comprenons que l’impuissance du pouvoir s’articule directement à sa situation « en marge » par rapport au système total ; et cette situation résulte elle-même de la rupture qu’introduit le pouvoir dans le cycle décisif des échanges de femmes, de biens et de mots. Mais déceler en cette rupture la cause du non-pouvoir de la fonction politique, n’en éclaire pas pour autant sa raison d’être profonde. Doit-on interpréter la séquence : rupture de réchange-extériorité-impuissance, comme un détour accidentel du processus constitutif du pouvoir ? Cela laisserait supposer que le résultat effectif de l’opération (le défaut d’autorité du pouvoir) est seulement contingent par rapport à l’intention initiale (la promotion de la sphère politique) . Mais il faudrait accepter alors l’idée que cette « erreur » est coextensive au modèle lui-même et qu’elle se répète indéfiniment à travers une aire presque continentale : aucune des cultures qui l’occupent ne s’avérerait ainsi capable de se donner une authentique autorité politique.- C’est, ici sous-jacent, le postulat tout à fait arbitraire, que ces cultures ne possèdent pas de créativité : c’est en même temps, le retour au préjugé de leur archaïsme. On ne saurait donc concevoir la séparation entre fonction politique et autorité, comme l’échec accidentel d’un processus qui visait à leur synthèse, comme le « dérapage » d’un système malgré lui démenti par un résultat que le groupe serait incapable de corriger.
Récuser la perspective de l’accident conduit à supposer une certaine nécessité inhérente au processus lui-même ; à chercher au niveau de l’intentionnalité sociologique – — lieu d’élaboration du modèle — la raison ultime du résultat. Admettre la conformité de celui-ci à l’intention qui préside à sa production, ne peut signifier autre chose que l’implication de ce résultat dans l’intention originelle : le pouvoir est exactement ce que ces sociétés ont voulu qu’il soit. Et comme ce pouvoir n’y est, pour le dire schématiquement, rien, le groupe révèle, ce faisant, son refus radical de l’autorité, une négation absolue du pouvoir. Est-il possible de rendre compte de cette « décision» des cultures indiennes ? Doit-on la juger comme le fruit irrationnel de la fantaisie, ou peut-on, au contraire, postuler une rationalité immanente à ce « choix » ? La radicalité même du refus, sa permanence et son extension, suggèrent peut-être la perspective en laquelle le situer. La relation du pouvoir à l’échange, pour être négative, ne nous en a pas moins montré que c’est au niveau le plus profond de la structure sociale, lieu de la constitution inconsciente de ses dimensions, qu’advient et se noue la problématique de ce pouvoir. Pour le dire en d’autres termes, c’est la culture elle-même, comme différence majeure de la nature, qui s’investit totalement dans le refus de ce pouvoir. Et n’est-ce point précisément dans son rapport à la nature, que la culture manifeste un désaveu d’une égale profondeur ? Cette identité dans le refus nous mène à découvrir, dans ces sociétés, une identification du pouvoir et de la nature : la culture est négation de l’un et de l’autre, non au sens où pouvoir et nature seraient deux dangers différents, dont l’identité ne serait que celle — négative — d’un rapport identique au troisième terme, mais bien au sens où la culture appréhende le pouvoir comme le ressurgissement même de la nature.
Tout se passe, en effet, comme si ces sociétés constituaient leur sphère politique en fonction d’une intuition qui leur tiendrait lieu de règle : à savoir que le pouvoir est en son essence coercition ; que l’activité unificatrice de la fonction politique s’exercerait non à partir de la structure de la société et conformément à elle, mais à partir d’un au-delà incontrôlable et contre elle ; que le pouvoir en sa nature n’est qu’alibi furtif de la nature en son pouvoir. Loin donc de nous offrir l’image terne d’une incapacité à résoudre la question du pouvoir politique, ces sociétés nous étonnent par la subtilité avec laquelle elles l’ont posée et réglée. Elles ont très tôt pressenti que la transcendance du pouvoir recèle pour le groupe un risque mortel, que le principe d’une autorité extérieure et créatrice de sa propre légalité est une contestation de la culture elle-même ; c’est l’intuition de cette menace qui a déterminé la profondeur de leur philosophie politique. Car, découvrant la grande parenté du pouvoir et de la nature, comme double limitation de l’univers de la culture, les sociétés indiennes ont su inventer un moyen de neutraliser la virulence de l’autorité politique. Elles ont choisi d’en être elles-mêmes les fondatrices, mais de manière à ne laisser apparaître le pouvoir que comme négativité aussitôt maîtrisée : elles l’instituent selon son essence (la négation de la culture), mais justement pour lui dénier toute puissance effective. De sorte que la présentation du pouvoir tel qu’il est, s’offre à ces sociétés comme le moyen même de l’annuler. La même opération qui instaure la sphère politique lui interdit son déploiement : c’est ainsi que la culture utilise contre le pouvoir la ruse même de la nature ; c’est pour cela que l’on nomme chef l’homme en qui vient se briser l’échange des femmes, des mots et des biens.
En tant que débiteur de richesse et de messages, le chef ne traduit pas autre chose que sa dépendance par rapport au groupe, et l’obligation où il se trouve de manifester à chaque instant l’innocence de sa fonction. On pourrait en effet penser, à mesurer la confiance dont le groupe crédite son chef, qu’au travers de. cette liberté vécue par le groupe dans son rapport au pouvoir, se fait jour, comme subrepticement, un contrôle, plus profond d’être moins apparent, du chef sur la communauté. Car, en certaines circonstances, singulièrement en période de disette, le groupe s’en remet totalement au chef ; lorsque menace la famine, les communautés de l’Orénoque s’installent, avec sans doute la plus parfaite bonne conscience, dans la maison du chef, aux dépens de qui, désormais, elles décident de vivre, jusqu’à des jours meilleurs. De même, la bande Nambikwara à court de nourriture après une dure étape attend du chef et non de soi que la situation s’améliore. Il semble en ce cas que le groupe, ne pouvant se passer du chef, dépende intégralement de lui. Mais cette subordination n’est qu’apparente : elle masque en fait une sorte de chantage que le groupe exerce sur le chef. Car si ce dernier ne fait pas ce qu’on attend de lui, son village ou sa bande tout simplement l’abandonne pour rejoindre un leader plus fidèle à ses devoirs. C’est seulement moyennant cette dépendance réelle, que le chef peut maintenir son statut. Ceci apparaît très nettement dans la relation du pouvoir et de la parole : car si le langage est l’opposé même de la violence, la parole doit s’interpréter, plus que comme privilège du chef, comme le moyen que se donne le groupe de maintenir le pouvoir à l’extérieur de la violence coercitive, comme la garantie chaque jour répétée que cette menace est écartée. La parole du leader recèle en elle l’ambiguïté d’être détournée de la fonction de communication immanente au langage. Il est si peu nécessaire au discours du chef d’être écouté, que les Indiens ne lui prêtent souvent aucune attention. Le langage de l’autorité, disent les Urubu, est un ne eng hantan : un langage dur, qui n’attend pas de réponse. Mais cette dureté ne compense nullement l’impuissance de l’institution politique. A l’extériorité du pouvoir répond l’isolement de sa parole qui porte, d’être dite durement pour ne point se faire entendre, témoignage de sa douceur.
La polygynie peut s’interpréter de la même manière : au-delà de son aspect formel de don pur et simple destiné à poser le pouvoir comme rupture de l’échange, se dessine une fonction positive analogue à. celle des biens et du langage. Le chef, propriétaire de valeurs essentielles du groupe, est par là même responsable devant lui, et par l’intermédiaire des femmes il est en quelque sorte le prisonnier du groupe.
Ce mode de constitution de la sphère politique peut donc se comprendre comme un véritable mécanisme de défense des sociétés indiennes. La culture affirme la pré valence de ce qui la fonde — l’échange — , précisément en visant dans le pouvoir la négation de ce fondement. Mais il faut en outre remarquer que ces cultures, en privant les « signes » de leur valeur d’échange dans la région du pouvoir, enlèvent aux femmes, aux biens et aux mots justement leur fonction de signes à échanger ; et c’est alors comme pures valeurs que sont appréhendés ces éléments, car la communication cesse d’être leur horizon. Le statut du langage suggère avec une force singulière cette conversion de l’état de signe à l’état de valeur : le discours du chef, en sa solitude, rappelle la parole du poète pour qui les mots sont valeurs encore plus que signes. Que peut donc signifier ce double processus de dé-signification et de valorisation des éléments de l’échange ? Peut-être exprime-t-il, au-delà même de l’attachement de la culture à ses valeurs, l’espoir ou la nostalgie d’un temps mythique où chacun accéderait à la plénitude d’une jouissance non limitée par l’exigence de l’échange.
Cultures indiennes, cultures inquiètes de refuser un pouvoir qui les fascine : l’opulence du chef est le songe éveillé du groupe. Et c’est bien d’exprimer à la fois le souci qu’a de soi la culture et le rêve de se dépasser, que le pouvoir, paradoxal en sa nature, est vénéré en son impuissance : métaphore de la tribu, imago de son mythe, voilà le chef indien.
= = =
Lectures complémentaires:
40ans_Hommage_Pierre_Clastres
Entraide_Facteur_de_L’evolution_Kropotkine
David Graber Fragments Anthropologiques pour Changer l’histoire de l’humanité
Manifeste pour la Société des Sociétés
James_C_Scott_Lart_de_ne_pas_etre_gouverne
James-C-Scott-Contre-le-Grain-une-histoire-profonde-des-premiers-etats
Marshall-Sahlins-La-nature-humaine-une-illusion-occidentale-2008
Paulo_Freire_La_pedagogie_des_opprimes










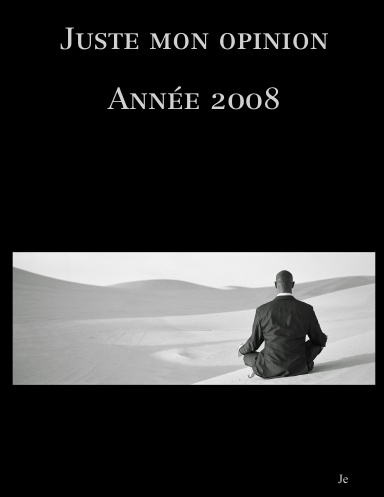
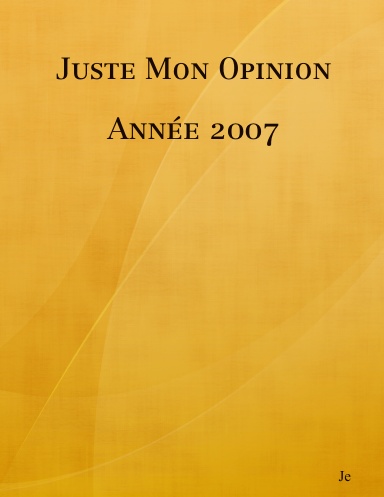
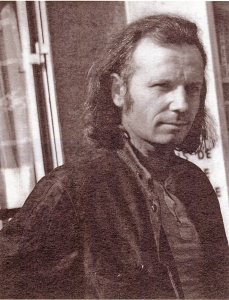


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire