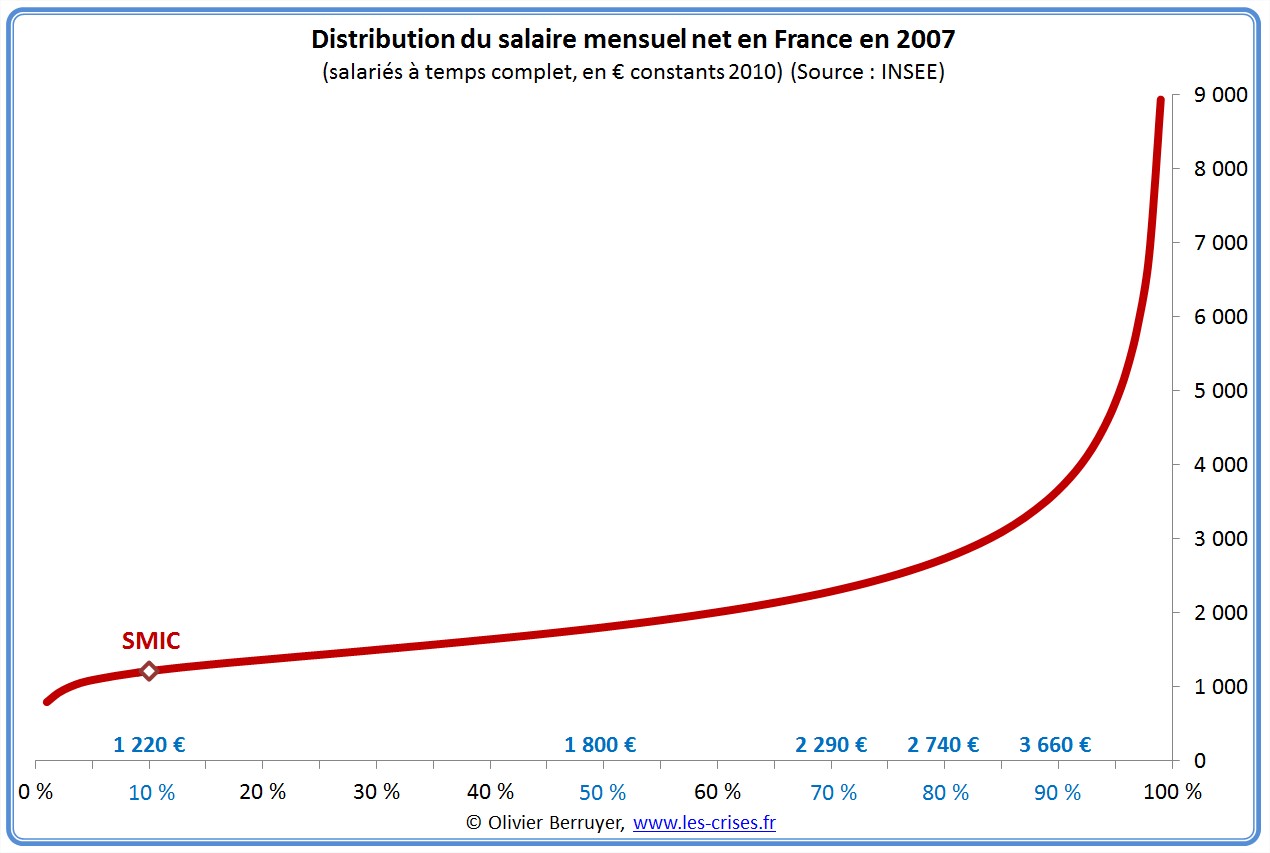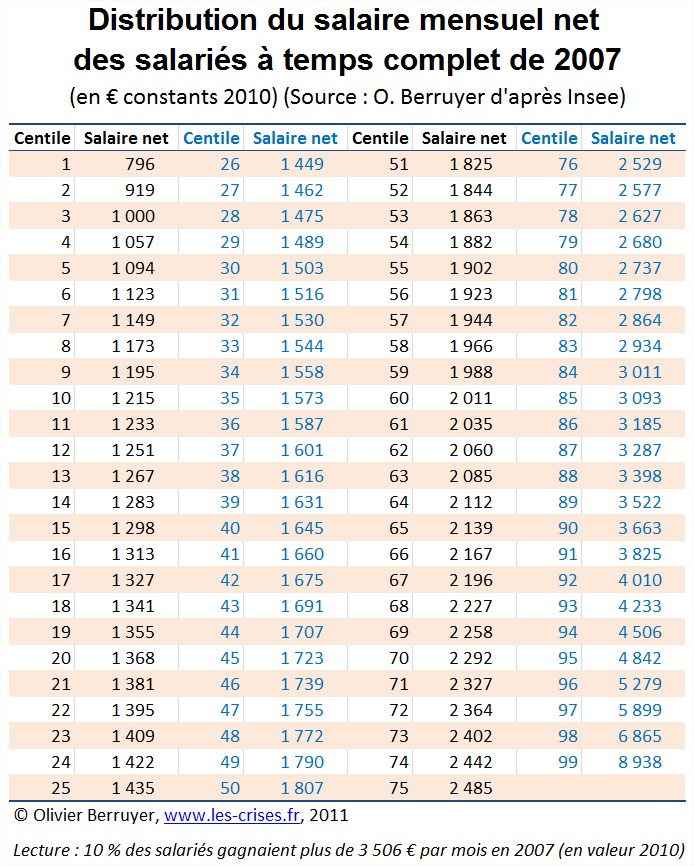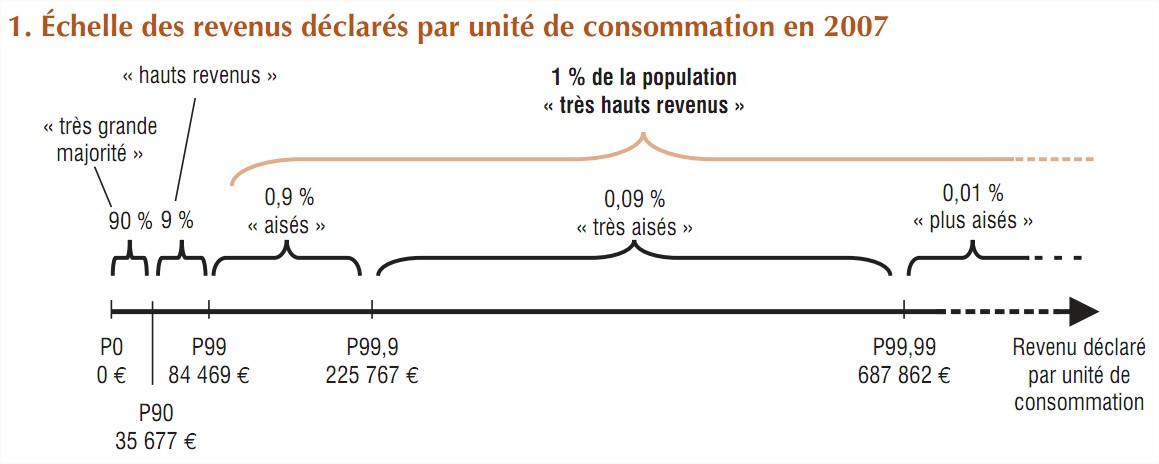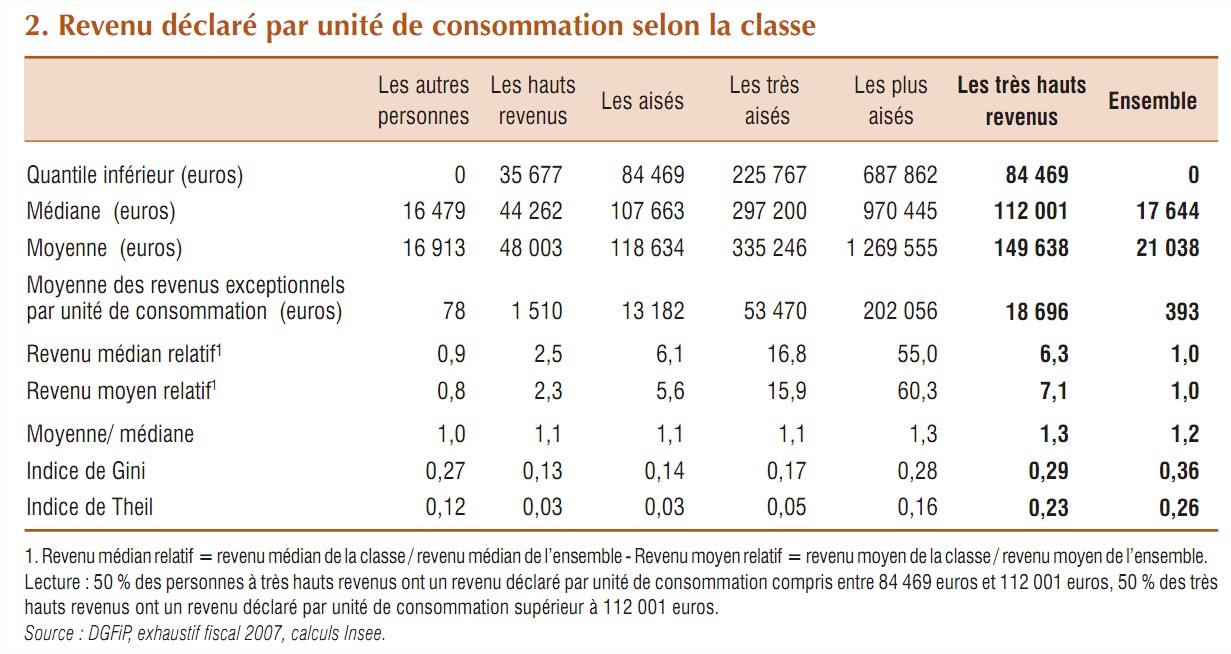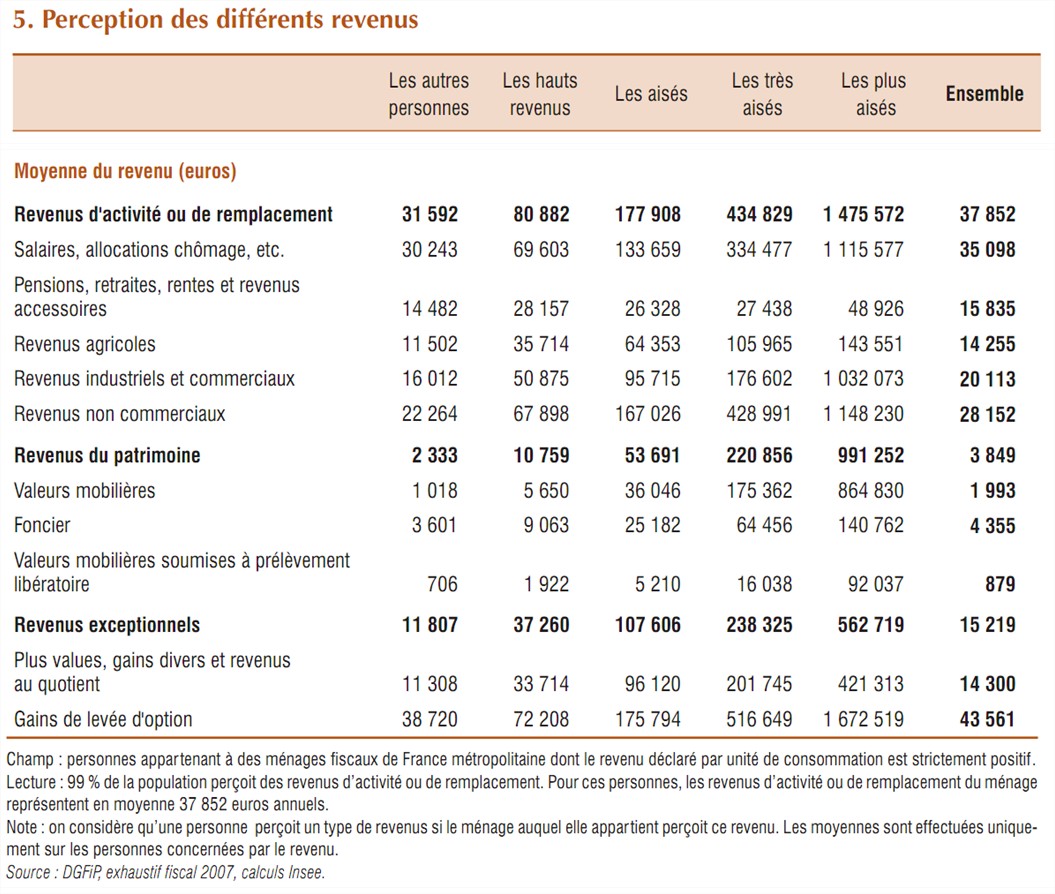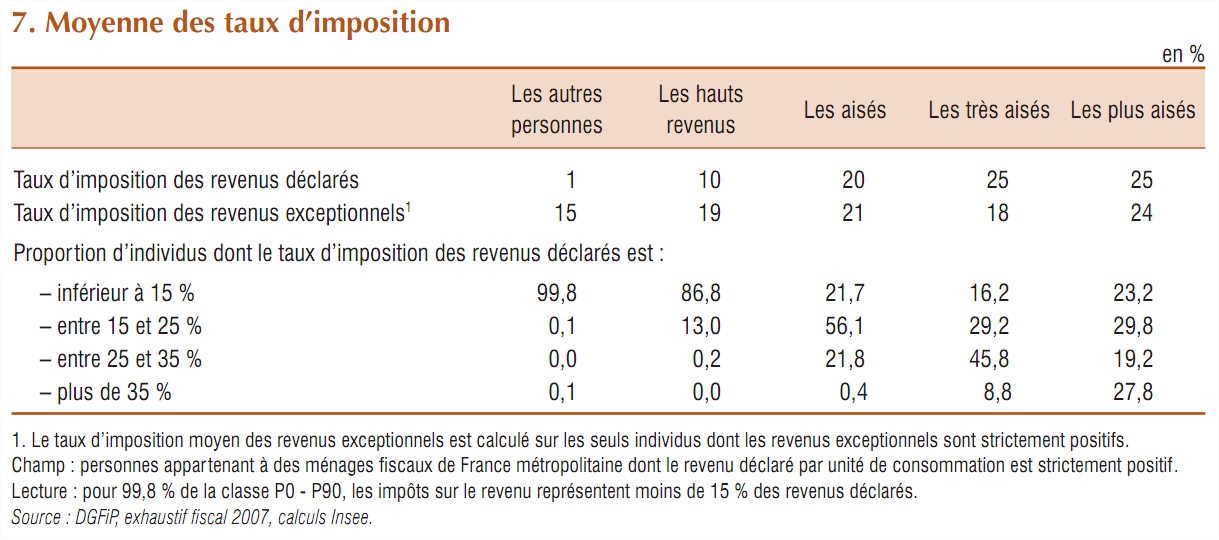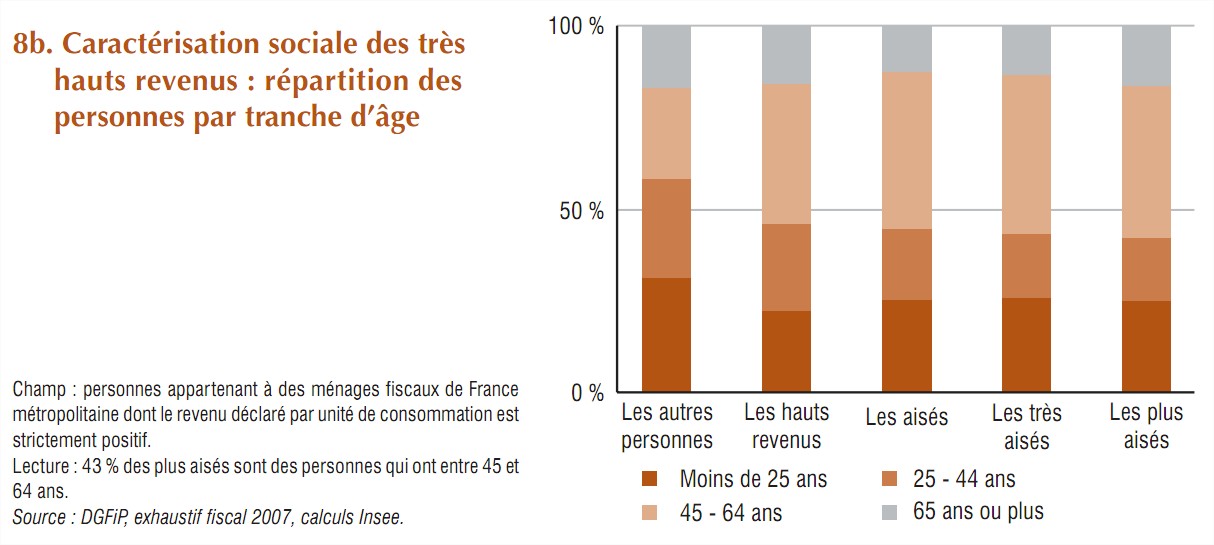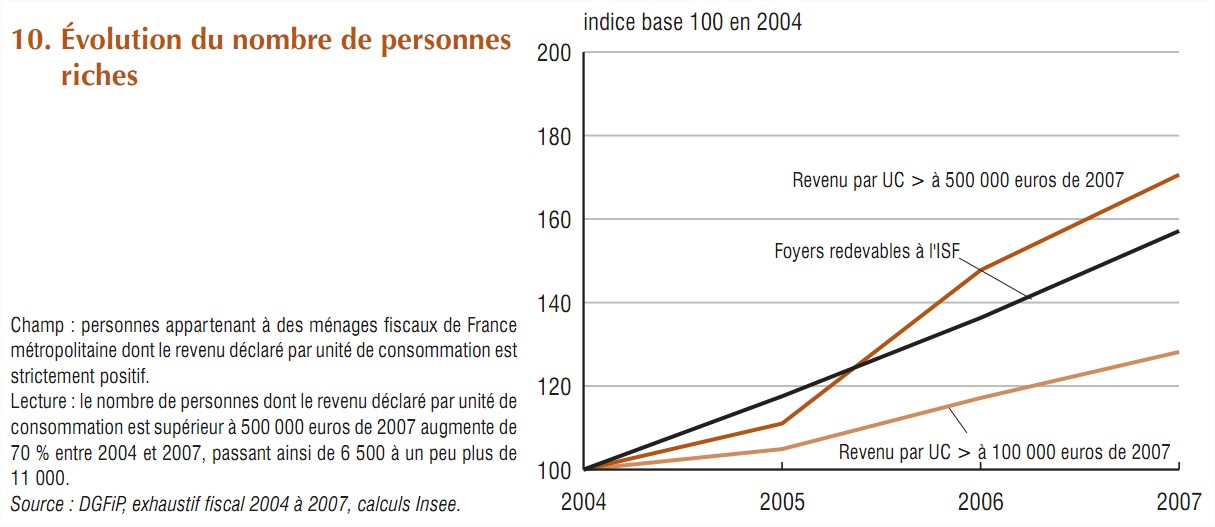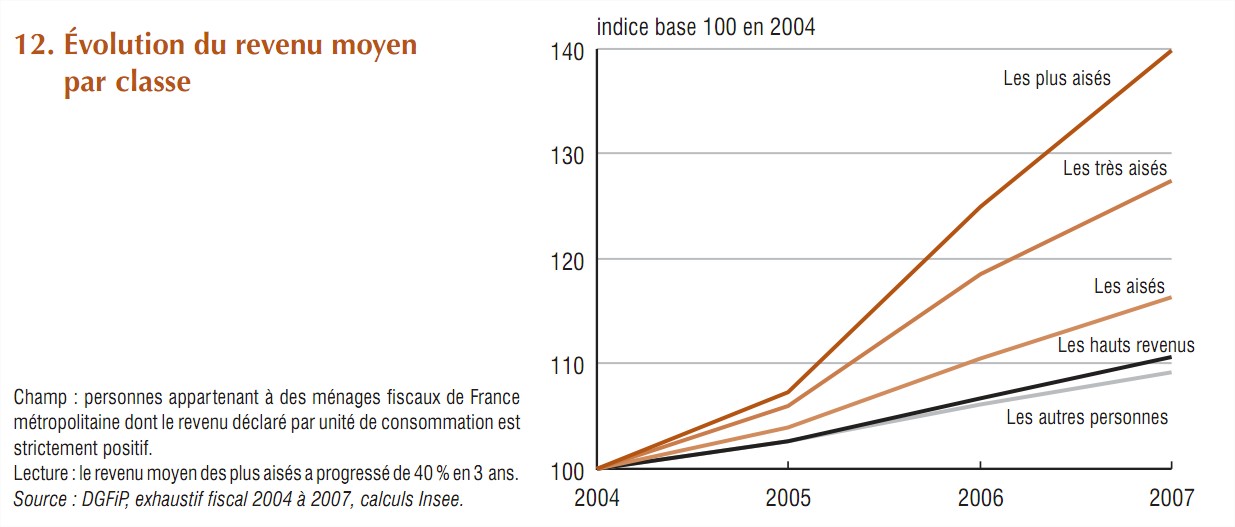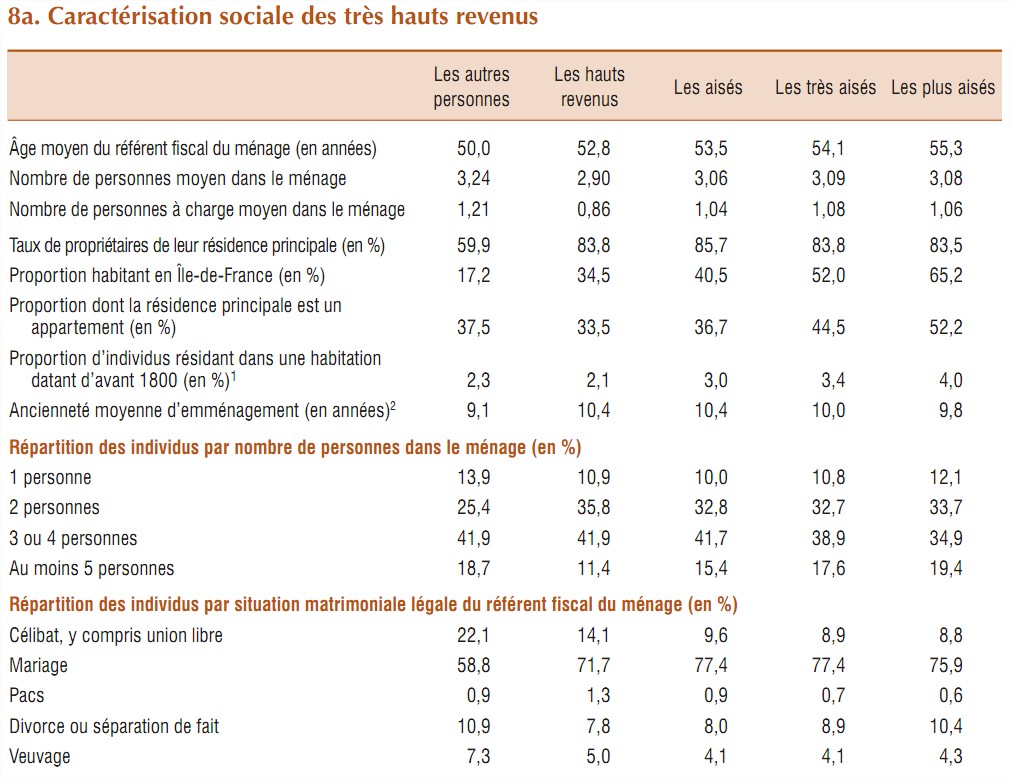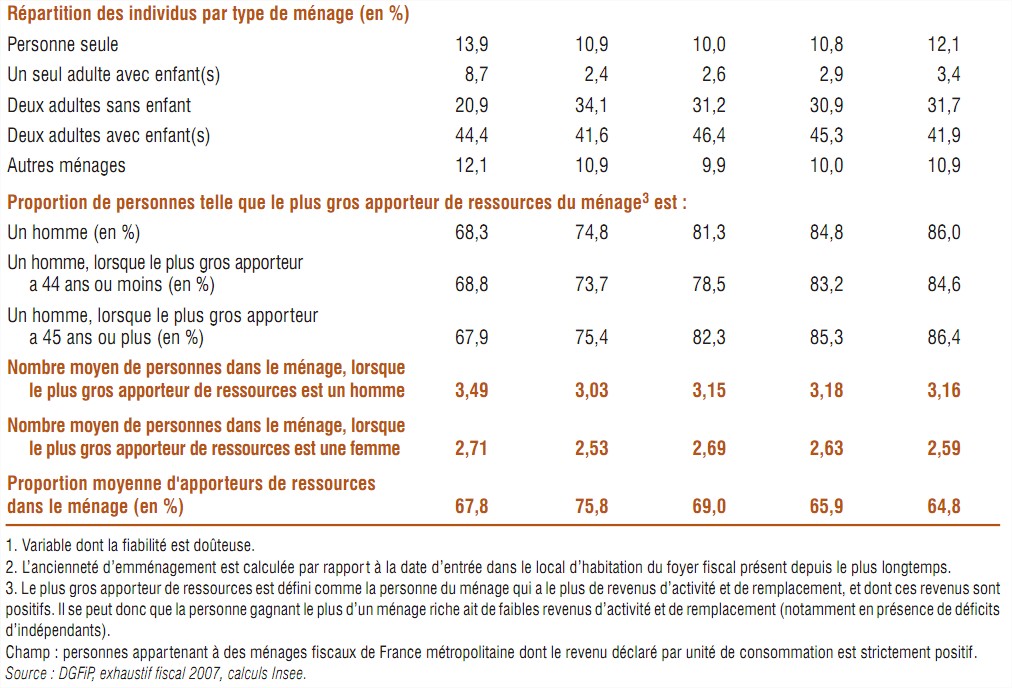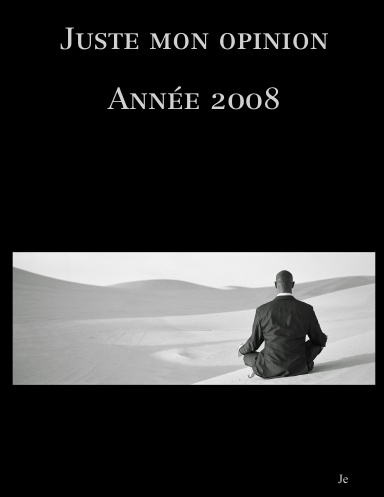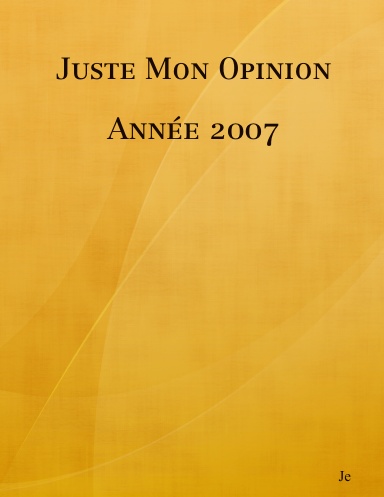Préface de Jean-Claude Michéa (extrait) : Lasch mode d'emploi
« IL FUT un temps où ce qui était supposé menacer l'ordre
social et les traditions civilisatrices de la culture occidentale,
c'était la "révolte des masses". De nos jours, cependant, il semble bien
que la principale menace provienne non des masses, mais de ceux qui
sont au sommet de la hiérarchie. » [Cf. chap. 2].
Profondément enracinées dans l'économie planétaire et ses
technologies sophistiquées, culturellement libérales, c'est-à-dire
"modernes", "ouvertes", voire "de gauche", les nouvelles élites du
capitalisme avancé — « celles qui contrôlent le flux international de l'argent et de l'information »
[Cf. chap. 2] — manifestent en effet, à mesure que leur pouvoir
s'accroît et se mondialise, un mépris grandissant pour les valeurs et
les vertus qui fondaient autrefois l'idéal démocratique. Enclavées dans
leurs multiples "réseaux" au sein desquels elles "nomadisent"
perpétuellement, elles vivent leur enfermement dans le monde humainement
rétréci de l'Économie comme une noble aventure "cosmopolite", alors que
chaque jour devient plus manifeste leur incapacité dramatique à
comprendre ceux qui ne leur ressemblent pas : en premier lieu, les gens
ordinaires de leur propre pays.
Dans ce livre-testament, Christopher Lasch a tenu à placer sa
critique des nouvelles élites du capitalisme avancé sous le signe du
"populisme", c'est-à-dire conformément au sens historique du mot, d'un
combat radical pour la liberté et l'égalité mené au nom des vertus
populaires. On sait à quel point, depuis quelques années, les médias
officiels travaillent méthodiquement à effacer le sens originel du mot, à
seule fin de pouvoir dénoncer comme "fascistes" ou "moralisateurs" (à
notre époque, le crime de pensée suprême) tous les efforts des simples
gens pour maintenir une civilité démocratique minimale et s'opposer à
l'emprise croissante des "experts" sur l'organisation de leur vie.
Autant dire que beaucoup, parmi ceux que le système a préposés à la
défense médiatique de ses nuisances, s'empresseront de faire courir le
bruit — pour affecter de s'en réjouir ou pour s'en lamenter — que ce
livre est "réactionnaire".
Il n'est cependant pas interdit d'espérer que le lecteur intelligent puisse encore se faire une opinion par lui-même.
Fiche de lecture très intéressante du livre testament de Christopher Lasch, écrite par Michel Drac
La révolte des élites (Christopher Lasch)
Écrit par Michel Drac, dimanche, 20 septembre 2009.
Pour Christopher Lasch, la situation contemporaine doit être
pensée à la lumière d’un phénomène structurant, et qui constitue, par
rapport aux siècles précédents, une rupture majeure : désormais, ce qui
menace l’équilibre de la structure globale, et en particulier les
progrès effectués vers une humanité plus libre et plus digne, ce n’est
plus la révolte des masses. C’est
la révolte des élites.
Les élites contemporaines, explique Lasch, ont ceci de particulier qu’à la différence de leurs devancières,
elles ne se pensent plus comme le sommet d’une structure complexe, mais comme un élément extérieur à la structure formée par les peuples. Les élites ne sont plus ce qui est au-dessus, mais ce qui est
séparément. La cause de cette évolution ? La déterritorialisation d’abord subie, ensuite acceptée, finalement recherchée par ces élites –
une déterritorialisation
qui s’achève, fort logiquement, dans la rupture de tous les réseaux de
proximité à l’intérieur desquels les masses sont encore insérées, mais
auxquels échappent désormais les élites. Élites qui constituent de
nouveaux réseaux, étrangers à ceux constitués par le reste de
l’humanité.
Lasch analyse le phénomène plus particulièrement dans le cadre
américain, et au regard de l’histoire spécifique des États-Unis. Il fait
observer que le projet américain, à l’origine, était appuyé sur
un socle anthropologique bien précis : la communauté locale, au maximum la métropole à taille humaine. Le « logiciel » de la démocratie américaine a été conçu, au départ, pour faire vivre une démocratie adaptée à ce
cadre
anthropologique à faible rayon d’action. Un cadre restreint, où les
riches, même s’ils exploitaient les pauvres, étaient cependant obligés
de les connaître, puisqu’ils les fréquentaient. Un cadre restreint,
donc, où les différences de classe n’empêchaient pas l’unité de la Cité,
et donc la perception par les élites d’un fait politique unifié, dont
elles étaient partie prenante.
Avec la dislocation de ce cadre
anthropologique, dislocation qu’on peut faire remonter schématiquement à
l’industrialisation, puis à l’émergence, à la fin du XIX° siècle, des très grandes métropoles à taille inhumaine, les différences de classe sont devenues insurmontables.
La continuité de l’espace urbain a été rompue, tandis que l’espace
rural devenait étranger aux classes supérieures. Dès lors, la nature
même du débat démocratique muta, et le projet américain commença à se
retourner contre sa pure expression.
Le débat public a progressivement changé de nature de manière perverse. La distinction entre science et opinion
a servi de paravent à l’opposition entre le discours d’une nouvelle
classe sacerdotale – les élites – et le réel perçu par les masses.
L’Amérique de Lippmann et de Bernays naquit fondamentalement de cette
schizophrénie, et elle construisit progressivement le cadre conceptuel
d’une vision du monde à deux vitesses, les masses étant supposées
inaptes à participer de la définition de l’intérêt général. Pour Lasch,
comme il a été dit ci-avant, c’est là le phénomène structurant de
l’époque, celui qui se dissimule derrière les diverses formes que
peuvent prendre les nouveaux discours oppressifs.
Derrière le règne
de la technocratie : la transformation de l’élite bureaucratique et
financière en une classe sacerdotale du pouvoir économique. Derrière le
discours arrogant et déconnecté du réel de la deuxième gauche sociétale :
la transformation de l’élite intellectuelle en une classe sacerdotale
du pouvoir culturel.
Pour Christopher Lasch, l’opposition de façade entre pouvoir financier et contre-pouvoir culturel n’est qu’un jeu de dupe, et la « rebellitude » des intellectuels « de gauche » n’est que le masque du versant culturel du Capital.
L’auteur de « La révolte des élites » nous propose d’arracher ce
masque, et de nous libérer des fausses oppositions pour discerner,
derrière l’affrontement factice des formes, l’unicité du phénomène
structurant :
le narcissisme croissant d’élites qui se pensent extérieures à l’expérience humaine générale.
---------------
Ce qui caractérise le système construit par cette dynamique
structurante, poursuit Christopher Lasch, c’est l’apparition d’un monde
réel
retourné contre son expression théorique. La « diversité »
justifie la ghettoïsation, donc la négation de toute diversité. La «
liberté » du marché devient le droit pour le capitalisme débridé de
dénier certaines libertés fondamentales aux salariés. La « politique de
la famille » est un instrument pour détruire la famille, la « politique
du travail » organise un marché où il n’y a plus de travail, etc.
En réalité, le discours véhiculé par les élites coupé des masses doit toujours s’entendre à
deux niveaux.
Il dit la réalité de l’expérience vécue par ces élites, mais comme
cette expérience est fondée sur la destruction de l’expérience vécue par
la masse, il dit aussi
le contraire de la réalité vécue par la masse.
Il en résulte que pour la première fois peut-être dans l’Histoire, le
discours du pouvoir n’a plus vocation à structurer la vie des peuples,
mais plutôt à la déstructurer, pour structurer en reflet la vie autonome
des élites. Par exemple, le « féminisme » sera du point de
vue des femmes des couches populaires la « double journée de travail »,
et du point de vue des femmes des couches supérieures, la possibilité de
cumuler deux gros salaires pour un pouvoir d’achat accru, permettant de
se libérer de toute tâche ménagère ou domestique.
Derrière cet éclatement des systèmes de représentation, il y a
l’implosion progressive des couches moyennes, jadis enfants chéris de la
dynamique économique, aujourd’hui gêne pour les élites. Ces élites, que
Lasch rattache à la catégorie des « analystes symboliques », sont
caractérisées par
un rapport à la production totalement
dématérialisé. Elles prospèrent sur leur capacité à fournir un service,
souvent non productif au sens matériel du terme, obéissant à un
principe d’équivalence dématérialisé, susceptible de traverser les
frontières et de capter les flux à forte valeur ajoutée, au sein du
système d’échange global.
Le cosmopolitisme affiché par ces élites prédatrices est d’abord le signe de leur désintérêt pour ceux qu’elles exploitent. Fondamentalement, en réalité, ces élites sont largement parasitaires (puisqu’elles ne produisent pas vraiment des biens et des services). Ce qu’elles produisent, c’est de la valeur sans richesse effective (exemples paroxystiques : les traders, les publicitaires…).
Une grande partie du discours des élites actuelles est construit en vue de cacher le caractère parasitaire de leur activité.
Lasch souligne par exemple que ces élites sont en grande partie issue
de la reproduction sociale, mais qu’elles affectent de se présenter
comme résultant d’un processus de « sélection des plus aptes ».
Si elles s’efforcent de nier les donnes structurantes qui permettent aux
masses d’exister dans la durée de prendre conscience de la durée, ce
n’est pas seulement parce que cette perte de conscience facilite le
parasitisme des élites, c’est aussi parce
lesdites élites, arrogantes et sûres d’elles-mêmes, n’ont aucun sens de l’honneur – et ne veulent donc pas d’un monde où l’on mesure les actes et les attitudes à l’aune d’une éthique de responsabilité.
---------------
Poursuivant sa réflexion, Christopher Lasch arrive à la conclusion que
la
démocratie américaine, coupée de son cadre anthropologique initial,
aura donc fabriqué des élites radicalement anti-démocratiques.
Cependant, comme grille d’analyse permettant d’expliquer ce phénomène,
il propose, en bon Américain, non la vision marxiste de la lutte des
classes, mais
la vision « populiste »
(au sens américain du terme) d’une dynamique sociale entretenue
fondamentalement par l’émergence d’une division du travail culturel,
qu’il situe
en amont de la lutte des classes proprement dite.
Pour Lasch, c’est l’échec de l’expérience américaine qui est à
l’origine de la « révolte des élites », et cet échec est d’abord le
retournement, par la dynamique du capitalisme, du
rêve
populiste d’Abraham Lincoln. Ce rêve était, en grande partie, celui de
l’abolition du salariat. Il s’agissait de faire une nation d’hommes
libres, vivant de leur travail et s’émancipant par l’épargne.
Mais la « mobilité sociale » voulue par les Américains n’aura été
effective qu’aussi longtemps qu’une « frontière » offrait de nouveaux
territoires à conquérir. Une fois cette échappatoire devenue impossible,
le système a touché ses limites de développement par le bas, et le
développement n’a pu être poursuivi que par le haut – à travers l’action
du grand capital.
Une fois le populisme évacué, il
n’est resté qu’un face à face entre le syndicalisme révolutionnaire et
le grand capital, c'est-à-dire entre une tentation bureaucratique
émanant de la masse et une tentation bureaucratique émanant de l’élite.
Et ainsi, conclut Christopher Lasch, l’Amérique réelle (celle de
Jefferson et de Lincoln) est en réalité morte depuis longtemps.
Fondamentalement, l’histoire du dernier siècle est l’affrontement de
deux groupes de vers pullulant sur un cadavre…
Ce sont les « vers » d’en haut,
les « élites », qui ont gagné. Mais cette victoire ne mène nulle part,
elle ne fait qu’accélérer un processus de décomposition mortifère. Le
communautarisme ronge l’Amérique par le bas, moment dans le
processus de déclin du libéralisme. Il ne traduit que le repli paniqué
des individus « d’en bas » sur des cadres anthropologiques régressifs,
les seuls qui leur restent ouverts. Pendant ce temps, l’Amérique est
également gangrénée par le haut, à travers la prédation de plus en plus
irrationnelle opérée par des élites complètement déconnectée du réel –
et pour finir, la première puissance mondiale court à la catastrophe…
Alors que faire ?
Lasch répond : il faut refonder les cadres anthropologiques
fondamentaux, sous une forme nouvelle, pour rendre à nouveau possible ce
qui faisait jadis la substance du rêve américain. Et pour cela, il
faut, avant toute chose, refonder le débat, et donc faire exploser les cadres conceptuels imposés par les élites en révolte.
C’est la dernière partie du travail de Lasch, et sans doute la plus contestable. Nous pourrions la définir comme un
manifeste populiste.
---------------
La démolition des cadres conceptuels imposés par les élites en révolte commencera par la
destruction des structures qui les encadrent, à savoir
l’émergence de réseaux spécialisés qui empêchent la « conversation » de la société avec elle-même, dans sa globalité.
Par exemple, il faut tout simplement refonder des cafés (Lasch cite l’exemple français), des lieux où l’on prend le temps de se parler (au lieu de centres commerciaux et de fast food), et qui sont l’inverse des clubs, ces espaces privés, réservés à une certaine catégorie de la population.
Au-delà de cet exemple emblématique, mais somme toute anecdotique,
il faut refonder des structures publiques,
partagées par l’ensemble de la Cité – et s’opposer à toutes les formes
de privatisation desdites structures, lorsqu’elles sont encore
publiques. D’une manière générale, il faut promouvoir les structures
ouvertes qui englobent l’ensemble de la Cité, et lutter contre la
généralisation des structures privées qui n’englobent qu’une partie de
la Cité – et cela va des structures
matérielles, comme les bâtiments et les quartiers, jusqu’aux structures
mentales,
comme la perception de soi par les individus, comme citoyens ou comme
membres d’une communauté en rivalité mimétique avec d’autres
communautés.
Cependant, ce projet général de retour à la Cité n’aura de sens que si les citoyens sont capables de comprendre ce que la Cité
est.
La nation américaine s’est construite par l’école. La particularité de l’homme américain, au XVIII° siècle, et au XIX° siècle encore, était d’être, en moyenne, beaucoup plus lettré que l’homme européen de la même époque (rappelons que l’école pour tous a été développée en Amérique beaucoup plus tôt qu’en Europe). Cependant, ce principe a été progressivement vicié, et cela tient à certaines de ses racines en Amérique même :
l’école pour tous est en effet, si l’on n’y prend pas garde, un instrument de contrôle social.
L’école peut en effet être aussi un instrument de ségrégation, même et
surtout si elle est ouverte à tous. Ainsi, le même système éducatif,
selon qu’on va l’utiliser pour promouvoir telle ou telle vision de la
Cité, peut aboutir à des résultats soit extrêmement néfastes, soit
extrêmement positifs. Il faut donc se demander ce que l’on enseigne dans
les écoles, au lieu de chercher à tout prix à y entasser les enfants le
plus longtemps possible.
Ce que Lasch veut dire par là,
c’est qu’il faut apprendre aux jeunes gens non à lire, mais à comprendre
ce qu’ils lisent – et surtout à comprendre quand ils ne comprennent
pas. Si l’on veut sortir d’une vision duale de la société, il faut que
l’homme ordinaire accède non à la totalité de la science (ce qui est
impossible), mais à l’esprit critique. Il faut préparer le futur
citoyen, qui pensera la circulation sociale de l’information non comme
un divertissement, non comme un circuit dans lequel il n’est que passif,
mais bien comme un processus de conversation globale dont il est partie
prenante. Il faut que l’homme du peuple, lorsqu’il lit un journal ou
lorsqu’il regarde une émission de télévision, se demande non ce qu’on
lui dit, mais pourquoi on le lui dit. Et il faut qu’il se demande non ce
qu’il en pense, mais pourquoi il pense ce qu’il pense. C'est-à-dire
qu’il faut élever l’homme du peuple non jusqu’au point où il serait
spécialiste de tout, mais jusqu’au point où il considèrera à bon droit
que le travail des spécialistes s’arrête avant la synthèse – parce que
cette synthèse, c’est à lui, à l’homme du peuple, de l’effectuer. Et cet
homme du peuple, bien sûr, doit être éduqué de manière à éprouver de la
honte lorsqu’il ne comprend pas. Au lieu d’un imbécile programmable
habitué à se complaire dans la passivité, l’auteur de « La révolte des
élites » veut un esprit libre, qui assume une responsabilité devant la
Cité : celle d’être un bon citoyen. Pour dire les choses
simplement, Lasch veut le retour du concept d’opinion éclairée, contre
la dictature des spécialistes. Et il veut la base anthropologique qui
rendra ce retour possible.
On pourra sourire de cette conclusion, dont on sent bien qu’elle
correspond, chez Christopher Lasch, au besoin instinctif de faire surgir
une lueur d’espoir après un ouvrage-testament tout entier consacré à
expliquer que l’expérience américaine est un échec. Il est évident que
ce que Christopher Lasch défend, au-delà du populisme (dont il se
réclame en toute franchise), est d’abord le projet humain issu de la
réforme protestante sous sa forme américaine : une humanité de prêtres,
capables de penser leur relation à la totalité sous la forme d’une
interrogation sans dogme, dans le libre examen et la recherche sincère
de la vérité. L’auteur de « La révolte des élites » fait ici un peu
penser à une mouche qui se cogne obstinément sur une vitre. Cet
Américain confronté à l’effondrement de l’espérance dont sa nation était
porteuse semble nous dire, en substance : « bon, ça n’a pas marché,
alors on prend les mêmes, on refait tout depuis le début, et on regarde
si ça va marcher au deuxième coup ». Vraiment, il n’est pas interdit
d’en sourire.
On remarquera tout de même que la toute fin de l’ouvrage est consacrée à une opposition entre
le
freudisme, dans lequel Lasch dénonce à mots couverts une forme
particulière des stratégies déployées par les élites en révolte
(mais en révolte contre quoi, au juste ?), et la psychanalyse de Jung,
qui l’intéresse non pas tant pour elle-même, mais parce qu’elle souligne
que l’homme moderne, pour construire valablement son refus de
l’hétéronomie, a besoin d’une source
spirituelle.
On en déduira ce qu’on voudra sur l’arrière plan idéologico-spirituel
des élites en révolte, et sur la nature de la poussée secrète qui a
provoqué cette révolte. Et pour mieux comprendre de quoi nous parlons,
on lira « La révolte des élites »…
(Source : http://www.scriptoblog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:la-revolte-des-elites-c-Lasch&catid=50:histoire&Itemid=55)
Michel Drac n'a pas parlé, dans cette très intéressante synthèse, d'un
chapitre du livre de Lasch que j'ai [Etienne Chouard] trouvé, pour ma part, littéralement
passionnant, le chap. 9 "L'art perdu de la controverse', où un
épisode essentiel de l'écroulement du journalisme moderne — et du débat
public propre à toute démocratie digne de ce nom — est rappelé aux
citoyens.
Le voici (pages 167 et suiv.) :
La révolte des élites et la trahison de la démocratie
Christopher Lasch, 1994.
 Chapitre 9
Chapitre 9
L'ART PERDU DE LA CONTROVERSE
Cela fait maintenant de nombreuses années que l'on nous abreuve de
la promesse de l'âge de l'information.
On nous dit que les effets sociaux de la révolution des communications
comporteront une demande sans fin pour une main-d'œuvre, qualifiée, la
réévaluation à la hausse des compétences nécessaires pour un emploi et
un public éclairé, capable de suivre les problèmes du jour et d'avoir
des jugements informés sur les affaires civiques. Au lieu de quoi, nous
trouvons des diplômés de l'université qui travaillent à des postes pour
lesquels ils sont largement sur-qualifiés. La demande de main-d'œuvre
domestique dépasse la demande en spécialistes qualifiés. L'économie
post-industrielle semble encourager l'interchangeabilité des effectifs,
le mouvement rapide d'un type de travail à un autre et une concentration
croissante de la main-d'œuvre dans des secteurs techniquement arriérés
de l'économie, où le travail est intensif et les syndicats inexistants.
Notre expérience récente ne vient pas confirmer l'espérance qui
voudrait que les innovations technologiques, en particulier les progrès
dans les communications, créent une abondance d'emplois qualifiés,
suppriment les emplois pénibles et rendent la vie facile pour tout le
monde. Au contraire, leur effet le plus important est d'élargir le fossé
entre la classe de la connaissance et le reste de la population, entre
ceux qui se trouvent à l'aise dans la nouvelle économie mondiale et qui «
savourent l'idée que les flux d'information qui se dirigent vers eux
peuvent grossir » sans cesse (pour citer les propos d'Arno Penzias, d'AT
& T Bell Laboratories) et ceux qui, n'ayant pas grand chose à faire
de téléphones cellulaires, de fax ou de services d'information
en-ligne, vivent encore dans ce que Penzias appelle avec mépris l'Age de
la paperasse.
Quant à la thèse selon laquelle la révolution de l'information
élèverait le niveau de l'intelligence du public, ce n'est un secret pour
personne que
le public sait moins de choses sur les affaires publiques qu'il n'en savait autrefois.
Des millions d'Américains sont bien incapables de vous dire le premier
mot de ce qu'il y a dans la Déclaration des Droits, de ce que fait le
Congrès, de ce que dit la Constitution sur les pouvoirs du Président, de
l'apparition du système des partis ou de son fonctionnement. Selon un
récent sondage d'opinion, une majorité confortable croit qu'Israël est
un pays arabe.
Au lieu de rendre, comme d'habitude,
l'école responsable de cette ignorance déprimante des affaires
publiques, nous devrions chercher ailleurs une explication plus
complète, en gardant à l'esprit que les gens acquièrent facilement
les connaissances dont ils peuvent faire usage. Puisque le public ne
participe plus aux débats sur les questions nationales, il n'a aucune
raison de s'informer des affaires civiques. C'est le déclin du débat
public, et non pas le système scolaire (quelle que soit, par ailleurs,
sa dégradation) qui fait que le public est mal informé, malgré toutes
les merveilles de l'âge de l'information. Quand le débat devient un
art dont on a perdu le secret, l'information aura beau être aussi
facilement accessible que l'on voudra, elle ne laissera aucune marque.
Ce que demande la démocratie, c'est un débat public vigoureux, et non de l'information.
Bien sûr, elle a également besoin d'information, mais le type
d'information dont elle a besoin ne peut être produit que par le débat.
Nous ne savons pas quelles choses nous avons besoin de savoir tant que
nous n'avons pas posé les bonnes questions, et nous ne pouvons poser les bonnes questions qu'en soumettant nos idées sur le monde à l'épreuve de la controverse publique.
L'information qui est d'ordinaire conçue comme une condition préalable au débat se comprend mieux comme son produit dérivé.
Quand
nous nous engageons dans des discussions qui captivent entièrement
notre attention en la focalisant, nous nous transformons en chercheurs
avides d'information pertinente. Sinon, nous absorbons passivement
l'information — si tant est que nous l'absorbions.
Le débat politique a commencé de décliner vers le début du siècle, ce
qui correspond, assez bizarrement, à une époque où la presse devenait
plus « responsable », plus professionnelle, plus consciente de ses
obligations civiques.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la presse était farouchement partisane.
Jusque dans les années 1850, les journaux étaient souvent financés par
les partis politiques. Même quand ils sont devenus plus indépendants par
rapport aux partis, ils n'ont pas adhéré à un idéal d'objectivité ou de
neutralité. En 1841, Horace Greeley lançait son journal, The New York
Tribune, en annonçant que ce serait « un périodique également éloigné
d'un côté d'un esprit de parti servile et de l'autre d'une neutralité
bâillonnée et timorée ». Des rédacteurs en chef à l'esprit énergique,
tels que Greeley, James Gordon Bennett, E. L. Godkin et Samuel Bowles
n'étaient pas d'accord avec la façon dont les exigences de loyauté à
l'égard du parti empiétaient sur l'indépendance éditoriale, transformant
le rédacteur en simple organe d'un parti ou d'une faction,
mais
ils n'essayaient pas de dissimuler leurs propres opinions ou d'imposer
une stricte séparation entre informations et contenu éditorial. Leurs
journaux étaient des périodiques d'opinion où le lecteur s'attendait à
trouver un point de vue bien défini, en même temps que des critiques
sans relâche des points de vue opposés.
Ce n'est pas un hasard si le journalisme de ce type a été
florissant pendant la période qui va de 1830 à 1900, où la participation
populaire à la politique était à son zénith. Sur le total des
hommes en âge de voter, le chiffre typique de la participation à
l'élection présidentielle était de 80 %. Après 1900, le pourcentage a
décliné nettement (pour passer à 65 % en 1904 et à 59 % en 1912) et il a
continué à baisser plus ou moins régulièrement pendant tout le siècle.
Les
retraites aux flambeaux, les rassemblements de masse et les joutes
oratoires habituelles faisaient de la vie politique au XIXe siècle un
objet qui intéressait passionnément le public, et le journalisme servait
dans ce contexte de prolongement à la séance de l'assemblée communale.
La presse du XIXe siècle a créé un forum ouvert à tous où l'on disputait
avec chaleur des problèmes. Non seulement les journaux rendaient compte
des controverses politiques mais ils y prenaient part, en y entraînant
aussi leurs lecteurs.
La culture de l'imprimé reposait sur les restes d'une tradition
orale. L'imprimé n'était pas encore le moyen exclusif de communication,
et il n'avait pas non plus rompu ses attaches avec la langue parlée. Le
langage de l'imprimé était encore façonné par les rythmes et les
exigences du mot parlé, en particulier par les conventions de
l'argumentation orale. L'imprimé servait à créer un forum plus vaste
pour le mot parlé et pas encore à le remplacer ou à le refaçonner.
Les débats Lincoln-Douglas
ont été l'exemple du meilleur de la tradition orale. Selon les normes
modernes, Lincoln et Douglas ont enfreint toutes les règles du discours
politique. Ils ont soumis leurs auditoires (qui rassemblaient jusqu'à
quinze mille personnes en une fois) à une analyse minutieuse de questions complexes. Ils ont parlé dans un style piquant, familier, parfois audacieux,
et avec une candeur considérablement supérieure à celle que les
politiciens jugent sage d'utiliser aujourd'hui. Ils ont pris des positions bien tranchées,
qu'il devait leur être difficile d'abandonner. Ils se sont conduits
comme si les responsabilités politiques étaient porteuses de
l'obligation de clarifier les problèmes au lieu simplement de celle de
se faire élire.
Le contraste entre ces débats justement célèbres et les débats pour les élections présidentielles
de nos jours, où ce sont les médias qui définissent les thèmes et déterminent les règles du jeu,
est sans équivoque et très clairement à notre désavantage. Faire
interroger des candidats à une charge politique par des journalistes —
ce qui est devenu la formule obligée du débat — tend à
grossir l'importance des journalistes et à réduire celle des candidats.
Les journalistes posent des questions — prosaïques et prévisibles pour
l'essentiel — et aiguillonnent les candidats pour qu'ils leur donnent
des réponses rapides et spécifiques, se réservant
le droit d'interrompre les candidats et de leur enlever la parole à chaque fois qu'ils paraissent s'écarter du thème imposé.
Pour se préparer à cette épreuve, les candidats se fient à leurs
conseillers qui leur farcissent le crâne de faits et de chiffres, de
slogans faciles à retenir et de toute autre chose faisant passer
l'impression d'une compétence très large et imperturbable. Confrontés
non seulement à une armée de journalistes prêts à leur sauter sur le
poil au moindre faux pas, mais aussi au regard froid et implacable de la
caméra, les hommes politiques savent que tout repose sur leur capacité à
gérer les impressions visuelles. Il faut qu'il se dégage d'eux une
sensation de confiance, d'esprit de décision, et qu'ils ne donnent
jamais l'apparence d'être à court de paroles. La nature de l'occasion
demande d'eux qu'ils exagèrent la portée et l'efficacité de la prise de
décision politique, qu'ils donnent le sentiment qu'avec les bonnes
mesures et la bonne direction, le pays pourra affronter tous les défis.
Le format du débat télévisé demande que tous les candidats se
ressemblent : confiants, sereins et donc irréels. Mais il leur impose
aussi l'obligation d'expliquer ce qui les rend différents des autres.
Une fois que la question est posée, la réponse est toute donnée.
Cette
question est de fait avilissante et dégradante et constitue un bon
exemple de l'effet qu'a la télévision de rabaisser l'objet qu'il s'agit
d'évaluer, de percer à jour tous les déguisements, de dégonfler toutes
les prétentions. Formulée de but en blanc avec l'indispensable
dimension sous-jacente de scepticisme généralisé qui fait forcément
partie du langage de la télévision, la question se révèle un modèle de
question rhétorique : — Qu'est-ce qui vous rend si unique ? — Rien.
C'est par excellence la question que pose la télévision, parce
qu'il est dans la nature de ce média de nous enseigner, avec une
insistance implacable, que personne n'est unique, quelles que soient les
prétentions contraires. Au point où nous en sommes arrivés dans notre
histoire, il est bien possible que la meilleure qualification pour
exercer une charge élevée soit de refuser de coopérer avec le plan
d'auto-promotion des médias. Un candidat qui aurait le courage de
s'abstenir de paraître dans les « débats » organisés par les médias se
distinguerait automatiquement des autres et pourrait se prévaloir d'une
bonne dose de respect de la part du public.
Les candidats devraient réclamer de pouvoir débattre directement
l'un avec l'autre au lieu de réagir à des questions qui leur sont
adressées par des commentateurs et des spécialistes. Leur passivité et
leur veulerie les rabaissent aux yeux des électeurs. Ils ont besoin
de recouvrer leur respect pour eux-mêmes en contestant le statut
d'arbitres du débat public qu'ont pris les médias.
Refuser de jouer le jeu selon les règles fixées par les médias ferait
prendre conscience aux gens de l'immense influence illégitime que les
médias en sont arrivés à exercer sur la politique américaine. Ce serait
aussi l'indice crucial de la présence chez le candidat d'un caractère
identifiable par les électeurs et auquel ils pourraient se rallier.
Qu'est-il arrivé à la tradition dont les débats
Lincoln-Douglas nous ont donné un exemple ? Les scandales de l'Âge du
toc donnèrent mauvaise réputation à la politique des partis. Ils vinrent
conforter
les doutes et les inquiétudes que les « gens de bien » nourrissaient déjà à l'avènement de la démocratie jacksonienne.
Au cours des années 1870 et 1880, il était devenu courant parmi les
classes instruites d'avoir une mauvaise opinion de la politique.
Les réformateurs issus de la bonne société — ceux que leurs ennemis qualifiaient de mugwumps
(1) — réclamaient que la politique soit professionnalisée, ce qui
aurait permis de libérer la fonction publique du « système des
dépouilles » et du contrôle des partis et de substituer aux nominations
politiques un corps d'experts qualifiés.
Même ceux qui rejetèrent l'appel à déclarer leur indépendance par
rapport au système des partis, comme Théodore Roosevelt (qui, par son
refus à abandonner le parti républicain, provoqua la fureur des «
indépendants ») partageaient l'enthousiasme des mugwumps pour la réforme
de la fonction publique. Selon Roosevelt, les « gens de bien » devaient
aller défier les hommes mis en place par le système des dépouilles sur
leur propre territoire au lieu de se retirer sur la touche de la vie
politique.
Le mouvement pour un grand nettoyage de la politique gagna de la force pendant l'époque progressiste. Sous
la direction de Roosevelt, de Woodrow Wilson, de Robert La Follette et
de William Jennings Bryan, les progressistes prêchaient « l'efficacité
», « le bon gouvernement », « l'entente au-delà des clivages de partis »
et « la gestion scientifique » des affaires publiques,
déclarant la guerre au systèmes des « bosses ». Ils s'en prirent au
système de l'ancienneté au Congrès, limitèrent les pouvoirs du Speaker
(président) de la Chambre des Représentants, remplacèrent les maires des
grandes villes par des managers (syndics) et déléguèrent d'importantes
fonctions de gouvernement à des commissions nommées disposant d'un
état-major d'administrateurs qualifiés.
Se rendant compte que les « machines » politiques dans les grandes
villes étaient des bureaux d'assistance sociale d'un type rudimentaire,
distribuant du travail et d'autres avantages à leur clientèle et
s'assurant ainsi leur loyauté, les progressistes entreprirent de créer
un assistanat d'État comme moyen de concurrencer les « machines ». Ils
lancèrent des enquêtes exhaustives sur la criminalité, le vice, la
misère et autres « problèmes sociaux ».
Leur
position était que gouverner est une science, pas un art. Ils forgèrent
des liens entre l'État et l'université de manière à garantir l'apport
constant d'experts et de savoir spécialisé. Mais le débat public avait
pour eux peu d'intérêt. De leur point de vue, la plupart des questions
politiques étaient trop complexes, pour être soumises au jugement du
peuple. Ils aimaient opposer l'expert scientifique à l'orateur, voyant
dans ce dernier un moulin à paroles inutile dont les diatribes ne
faisaient qu'embrouiller l'esprit du public.
Le professionnalisme dans la politique signifiait professionnalisme
dans le journalisme. La liaison entre les deux fut énoncée par
Walter Lippmann dans une remarquable série d'ouvrages :
Liberty and the News (1920), Public Opinion (1922) et The Phantom Public (1925).
Ils ont fourni au journalisme moderne sa charte fondatrice,
l'argumentation la plus élaborée en faveur d'un journalisme qui serait
guidé par le nouvel idéal de l'objectivité professionnelle. Lippmann a
avancé des critères qui sont toujours ceux sur lesquels on juge la
presse — avec pour résultat habituel qu'on ne la trouve pas à leur
hauteur.
Toutefois ce qui nous occupe ici n'est pas de savoir si la presse a
su être à la hauteur des critères de Lippmann, mais comment tout d'abord
il en est arrivé à définir ces critères. En 1920, Lippmann et Charles
Merz publiaient dans
The New Republic un long article examinant
la manière dont la presse avait rendu compte de la révolution russe.
Aujourd'hui oubliée, cette étude montrait que les journaux américains
avaient donné à leurs lecteurs une description de la Révolution déformée
par leurs préjugés anti-bolcheviques, une tendance à prendre leurs
désirs pour des réalités et de l'ignorance pure et simple. La rédaction
de
Liberty and the News était aussi motivée par l'écroulement de
l'objectivité journalistique pendant la guerre, quand les journaux
s'étaient auto-désignés « défenseurs de la foi ». Selon Lippmann, le
résultat avait été une « rupture des moyens de connaissance du public ».
La difficulté dépassait la guerre ou la révolution, « destructeurs
suprêmes de la pensée réaliste ». L'étalage de sexualité, de violence et
de « faits divers » — produits de base du journalisme de masse moderne —
soulevait de graves questions sur l'avenir de la démocratie. « Tout ce
qu'ont prétendu les critiques les plus mordants de la démocratie est
vrai s'il n'y a pas apport constant d'informations fiables et
pertinentes. »
Dans Public Opinion et The Phantom Public, Lippmann répondait de fait aux critiques en redéfinissant la démocratie. La
démocratie ne demandait pas que le peuple se gouverne littéralement
lui-même. Le public n'avait dans le gouvernement qu'une part strictement
procédurière. L'intérêt du public n'allait pas jusqu'à la substance de
la prise de décisions. « Le public s'intéresse à la Loi, pas aux
lois ; à la méthode du droit, pas à sa substance. » Les questions de
substance devaient être décidées par des administrateurs compétents qui,
par leur accès à une information fiable, étaient immunisés contre les «
symboles » émotionnels et les « stéréotypes » qui dominaient le débat
public. Le public était incompétent pour se gouverner et ne se souciait même pas de se gouverner, du point de vue de Lippmann.
Mais tant que l'on appliquait des règles assurant l'équité, le public
se satisferait de laisser le gouvernement à des experts - pourvu, bien
sûr, que ces experts obtiennent des résultats, cette abondance toujours
croissante de commodités et de bien-être qui s'identifiait si
étroitement au mode de vie américain.
Lippmann reconnaissait le conflit qui existait entre ses
recommandations et la théorie reçue de la démocratie, selon laquelle les
citoyens devaient participer aux débats sur les prises de décision
publiques et y avoir une action, ne serait-ce qu'indirecte. Il soutenait
que la théorie démocratique avait ses racines dans des conditions
sociales qui n'existaient plus. Elle présupposait un « citoyen
omni-compétent », un « bonhomme encyclopédique » qui ne pouvait se
trouver que dans une « communauté simple et refermée sur elle-même ».
Dans « le milieu vaste et imprévisible » du monde moderne, ce vieil
idéal de citoyenneté était obsolète. La complexité d'une société
industrielle demandait un gouvernement confié à des responsables qui
seraient nécessairement guidés — puisque toute forme de démocratie
directe était à présent impossible — soit par l'opinion publique, soit
par le savoir d'experts. L'opinion publique n'était pas fiable parce
qu'elle ne pouvait être unie qu'en faisant appel à des slogans et à des
« images symboliques ».
La méfiance de Lippmann à l'égard de l'opinion publique reposait sur la distinction épistémologique entre vérité et simple opinion.
Dans sa conception, la vérité surgissait d'une enquête scientifique
désintéressée ; tout le reste était idéologie. Donc la portée du débat
public devait être sévèrement restreinte. Dans le meilleur des cas, le
débat public était une nécessité pénible — non pas l'essence même de la
démocratie mais son « défaut premier » qui ne naissait que du fait qu'on disposait malheureusement d'une quantité limitée de « connaissance exacte ».
Dans
l'idéal, le débat public n'aurait aucunement lieu ; les décisions se
baseraient seulement sur des « normes de mesure » scientifiques. La
science tranchait net dans « les slogans et les stéréotypes paralysants
», dans « les fils de la mémoire et de l'émotion » qui immobilisaient
dans leurs nœuds « l'administrateur responsable ».
Dans la vision de Lippmann, le rôle de la presse était de faire
circuler de l'information et non d'encourager la discussion. La relation
entre information et discussion était antagoniste, et non
complémentaire. Sa position n'était pas qu'une information fiable était
une condition préalable nécessaire à la discussion ; au contraire, ce
qu'il voulait dire, c'est que l'information excluait la discussion,
rendait toute discussion inutile. Les débats étaient ce qui se
produisait en l'absence d'information fiable.
Lippmann avait oublié ce qu'il avait appris (ou ce qu'il aurait dû apprendre) de
William James et
John Dewey
: que notre quête d'une information fiable est elle-même guidée par les
questions qui sont soulevées au cours des discussions portant sur une
série d'actions donnée.
C'est seulement en soumettant nos préférences
et nos projets à l'épreuve du débat que nous en arrivons à comprendre
ce que nous savons et ce qu'il nous reste à apprendre. Tant que nous
n'avons pas à défendre nos opinions en public, elles demeurent des
opinions au sens péjoratif que Lippmann donne à ce mot — des convictions
à moitié formées fondées sur des impressions aléatoires et des
présupposés admis sans examen.
C'est l'acte de formuler nos
conceptions et de les défendre qui les tire de la catégorie des «
opinions », qui leur donne forme et définition et permet également à
d'autres de les identifier comme la description de leur propre
expérience. Bref, nous n'en arrivons à connaître ce que nous avons en
tête qu'en nous expliquant devant les autres.
Bien sûr, la tentative de convertir autrui à notre propre point de
vue comporte le risque qu'il puisse nous arriver d'adopter plutôt le
leur.
Il nous faut entrer par l'imagination dans les arguments de nos
adversaires, ne serait-ce que dans l'intention de les réfuter, et
peut-être qu'au bout du compte nous nous retrouverons persuadés par ceux
que nous cherchions à persuader. La discussion est risquée et
imprévisible, et pour cette raison elle, est éducative.
Pour la plupart d'entre nous, nous tendons à y voir (comme Lippmann)
le choc de dogmes rivaux, une foire d'empoigne où aucun des deux camps
ne cède de terrain.
Mais on ne remporte pas une discussion en faisant
taire ses adversaires à force de hurlements. On la remporte en faisant
changer d'avis son adversaire — chose qui ne peut arriver que si l'on
accorde une écoute respectueuse aux arguments adverses et que l'on
persuade quand même ceux qui les avancent qu'il y a quelque chose qui ne
va pas dans ces arguments. Pendant que nous sommes engagés dans
cette activité, il se peut bien que ce soit nous qui décidions qu'il y a
quelque chose qui ne va pas dans les nôtres.
Si nous maintenons fermement que le débat est l'essence de
l'éducation, nous défendrons la démocratie comme la forme de
gouvernement non pas la plus efficace mais la plus éducative, telle
qu'elle étend aussi largement que possible le cercle de la discussion et
oblige ainsi tous les citoyens à articuler leurs conceptions, à les
mettre en danger et à cultiver les vertus de l'éloquence, de la clarté
de pensée et d'expression, et du jugement solide. Comme le relevait
Lippmann,
les petites communautés constituent le lieu classique de la
démocratie — non pas toutefois parce qu'elles sont « refermées sur
elles-mêmes », mais simplement parce qu'elles permettent à tout le monde
de prendre part aux débats publics. Au lieu de rejeter sommairement la
démocratie directe comme n'ayant aucune pertinence dans les conditions
modernes, il nous faut la recréer sur une grande échelle. De ce point de
vue, la presse sert d'équivalent à l'assemblée communale.
C'est de fait ce qu'a soutenu
Dewey — peu clairement toutefois, hélas — dans
The Public and Its Problems (1927),
ouvrage écrit en réponse aux réflexions désobligeantes de Lippmann sur
l'opinion publique. La distinction établie par Lippmann entre vérité et
information reposait sur une « théorie passive de la connaissance comme
spectacle » ainsi que l'explique
James W. Carey dans son
Communication as Culture (1989).
Dans la conception des choses que se faisait
Lippmann, la connaissance est ce que nous recevons quand un observateur, de préférence formé scientifiquement, nous présente
une copie de la réalité que nous pouvons tous reconnaître.
De son côté, Dewey savait que même les scientifiques débattent entre eux. Il soutenait qu'une
« enquête systématique »
n'était que le commencement de la connaissance et non pas sa forme
finale. La connaissance dont avait besoin toute communauté — qu'il
s'agisse d'une communauté de chercheurs scientifiques ou d'une
communauté politique — ne se dégageait que du « dialogue » et d'un «
échange direct ».
Comme l'indique Carey, il est significatif que l'analyse de la communication selon Dewey mette plutôt
l'accent sur l'oreille que sur l'œil.
Dewey écrit en effet : « La conversation a une importance vitale qui
manque dans les paroles fixées et gelées de l'écrit… Les liaisons de
l'oreille avec la pensée et l'émotion vitales qui s'expriment sont
immensément plus étroites et plus diverses que celles de l'œil. La
vision est spectatrice ; l'ouïe est participante. »
La presse étend la portée du débat en apportant au mot parlé le
supplément du mot écrit. Si la presse doit s'excuser de quelque chose,
ce n'est pas du fait que le mot écrit soit un piètre substitut pour la
langue pure des mathématiques. Dans ce rapport, ce qui compte, c'est que
le mot écrit soit un piètre substitut pour le mot parlé. Mais c'est
toutefois un substitut acceptable aussi longtemps que l'écrit prend pour
modèle l'oral et non pas les mathématiques. Si la presse n'était pas
fiable selon Lippmann, c'était parce qu'elle ne pouvait jamais nous
donner des représentations exactes de la réalité, mais seulement des «
images symboliques » et des stéréotypes. L'analyse de Dewey
sous-entendait une voie critique plus pénétrante. Pour citer Carey :
«
La presse en percevant son rôle comme celui d'informer le public
abandonne le rôle d'organisme chargé de faire vivre la conversation de
notre culture. » Ayant adhéré à l'idéal d'objectivité de Lippmann, la
presse ne sert plus à cultiver « certaines habitudes vitales » dans la
communauté : « la capacité de suivre un argument, de saisir le point de
vue d'autrui, d'élargir les frontières de l'entendement, de débattre les
différentes finalités que l'on pourrait choisir de viser. »
La montée parallèle et simultanée de la
publicité et des
relations publiques contribue à expliquer pourquoi
la presse a renoncé à sa fonction la plus importante — celle d'agrandir le forum public — en même temps qu'elle devenait plus « responsable ».
Une
presse responsable, par opposition à une presse partisane ou ancrée
dans ses opinions attirait le type de lecteurs que les publicitaires
étaient avides de toucher : des lecteurs nantis, qui pour la plupart se
considéraient probablement des électeurs indépendants. Ces lecteurs
voulaient avoir l'assurance de lire toutes les nouvelles qu'il est
convenable de publier et non pas la vision des choses d'un rédacteur en
chef, marquée par l'idiosyncrasie et sans doute biaisée.
On en est arrivé à ce que responsabilité soit synonyme de recul devant toute controverse,
parce que.les annonceurs étaient disposés à payer pour cela. Certains
annonceurs étaient également disposés à payer pour du sensationnalisme,
quoiqu'au total ils aient préféré un lectorat respectable plutôt que
simplement une forte circulation. En tout cas, ce qu'ils ne préféraient
pas, c'était de « l'opinion » — non que les arguments philosophiques de
Lippmann les aient marqués, mais parce qu'
un journalisme aux opinions tranchées ne leur garantissait pas le bon public.
Sans doute espéraient-ils aussi qu'une aura d'objectivité, marque
caractéristique du journalisme responsable, viendrait déteindre aussi
sur les réclames qui entouraient des colonnes de texte de plus en plus
minces.
Par un curieux retournement de
l'histoire, la publicité, la promotion et les autres formes de
persuasion commerciale en sont venues elles-mêmes à se déguiser en
information. Publicité et promotion se sont substituées au débat ouvert.
« Les persuadeurs cachés » (selon la formule de Vance Packard) ont
remplacé les rédacteurs d'antan, les essayistes et les orateurs qui ne
faisaient pas mystère de leur engagement partisan. L'information et
la promotion sont devenues de plus en plus impossibles à distinguer.
L'essentiel des « nouvelles » dans nos journaux — 40 % selon
l'estimation optimiste de M. Scott Cutlip, professeur à l'université de
Géorgie — est constitué d'éléments qui sont débités par des agences de
presse et des offices de relations publiques et régurgités ensuite sans
modification par les organes journalistiques « objectifs ». Nous nous
sommes habitués à l'idée que l'essentiel de l'espace dans nos
quotidiens d'information, si l'on peut dire, soit consacré à la
publicité — au moins les deux tiers dans la plupart des quotidiens.
Mais si nous considérons les relations publiques comme une autre
forme de publicité, ce qui n'est pas vraiment tiré par les cheveux
puisque les deux sont alimentées par des entreprises privées
d'inspiration commerciale, il nous faut à présent nous faire à l'idée
qu'une grande partie des « nouvelles » est constituée aussi de
publicités.
Le déclin de la presse partisane
et l'avènement d'un nouveau type de journalisme qui professe des normes
rigoureuses d'objectivité ne nous assurent pas un apport constant
d'informations utilisables. Si l'information n'est pas produite par
un débat public soutenu, elle sera pour l'essentiel au mieux dépourvue
de pertinence, et au pire trompeuse et manipulatrice. De plus en
plus, l'information est produite par des gens qui désirent promouvoir
quelque chose ou quelqu'un — un produit, une cause, un candidat ou un
élu — sans s'en remettre pour cela à ses qualités intrinsèques ni en
faire explicitement la réclame en avouant qu'ils y ont un intérêt
personnel. Dans son zèle à informer le public, une bonne partie de la
presse est devenue le canal tout trouvé de ce qui est l'équivalent de
cet insupportable courrier promotionnel qui encombre nos boîtes aux
lettres. Comme la poste — encore une institution qui servait autrefois à
élargir la sphère de la discussion interpersonnelle et à créer des «
comités de correspondance » — elle distribue aujourd'hui une
profusion d'information inutile, indigeste, dont personne ne veut, et
qui pour la plus grande part va finir au panier sans qu'on l'ait lue.
L'effet le plus important de cette obsession de l'information, à part
la destruction d'arbres pour fabriquer du papier et le fardeau
croissant que représente « la gestion des déchets », est d'
affaiblir l'autorité du mot. Quand on se sert des mots comme de simples instruments de propagande ou de promotion, ils perdent leur pouvoir de persuasion.
Ils
cessent bientôt d'avoir la moindre signification. Les gens perdent leur
capacité à se servir du langage avec précision et de façon expressive,
ou même à distinguer un mot d'avec un autre. Le mot parlé se modèle
sur le mot écrit au lieu que ce soit l'inverse, et la parole ordinaire
commence à ressembler au jargon ampoulé que nous trouvons dans les
journaux. La parole ordinaire commence à ressembler à de « l'information
» — catastrophe dont peut-être la langue anglaise ne se relèvera
jamais.
____________
(1) Provenant d'un dialecte indien et signifiant « grand chef », le
terme de « mugwump » est utilisé pour désigner ironiquement le
patricien, l'intellectuel, voire l'artiste, dégoûté par l'évolution
démocratique et matérialiste de la vie américaine, et révolté par la
place grandissante des immigrants non anglo-saxons et leurs systèmes
clientélistes (machines) dans les grandes villes, dominé par un boss,
intermédiaire tout-puissant. Leur organe naturel est The Nation de
Godkin. (N d T)
Source
: Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la
démocratie (1994), Climats, chapitre 9 "L'art perdu de la controverse",
pages 167 à 180.