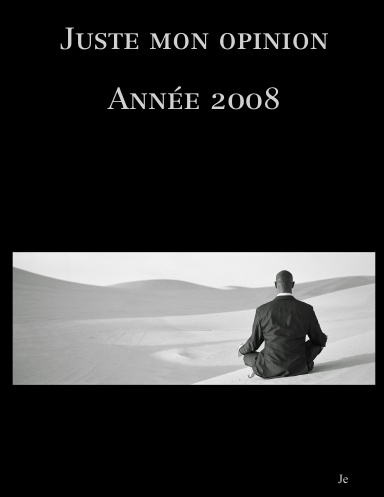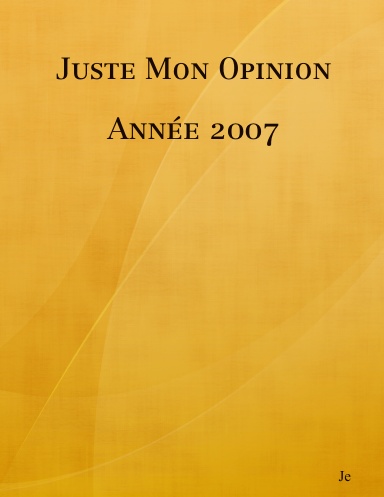« La marche du capitalisme néolibéral porte dans ses pas la
marque du sang de nos peuples contre lesquels la guerre empire parce que
nous n’abandonnons pas notre terre, notre culture, notre paix et notre
organisation collective ; parce que nous ne cédons pas dans notre
résistance ni ne nous résignons à mourir… »
Ce peuple est un des peuples qui est prêt à survivre lors de
l’effondrement de la civilisation capitaliste et environnementale qui
arrive parce qu’il n’aura rien à changer… il a déjà adapté les modes de
résilience pour vivre une démocratie en symbiose avec la nature !
Attac Réunion
25 ans d’insurrection zapatiste
Le 1 er janvier 1994 les Indiens tzotzils (branche maya) des hauteurs
de l’État du Chiapas (Mexique), se soulèvent contre le gouvernement
central de Mexico. Ce jour coïncide avec l’entrée en vigueur de l’Accord
de libre échange (ALENA) entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.
A la surprise générale, les insurgés de l’Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN), créée clandestinement en 1983, remportèrent
d’incontestables succès, dont notamment la prise de la mairie de la
ville de San Cristobal De Las Casas.
Cette prise fut purement symbolique, les diverses occupations furent
rapidement rendues au gouvernement officiel de l’État. La raison était
de présenter au monde la lutte zapatiste contre le néolibéralisme, pour le respect et la
considération des populations indiennes et de leurs cultures. Mais
également pour dénoncer la pression du gouvernement sur la question
foncière, et de ses implantations industrieuses sans avis de la
population. Et aussi pour se défendre de la violence exercée
institutionnellement et physiquement par les divers services de police
et de l’armée.
Commençait alors le soulèvement zapatiste : communes autonomes, conseils
de bon gouvernement, assemblées régionales, propriété collective des
terres…
25 ans de guerre de basse intensité
Les projets de développement capitalistiques n’ont pas pour intérêt,
au Chiapas (comme ailleurs), d’améliorer le bien-être des populations,
mais de servir des dividendes aux « investisseurs », et logiquement
aussi pour la présidence du pays. Lorsque les trois États d’Amérique du
Nord ont concrétisé le marché de « libre échange », ce n’est donc pas au
bénéfice des travailleur-euses du continent.
Le 1 er janvier 1994 est une date fortement symbolique pour ces deux
raisons intrinsèques ; de plus, elle marque une recrudescence de la
violence étatiste. Depuis un quart de siècle, Mexico aura déployé contre
les chiapanèques toute une panoplie de politiques
contre-insurrectionnelles : interventions de l’armée, paramilitarisation
massive et déplacement de populations, division des communautés et
création artificielle de conflits internes, programmes d’assistances
économiques clientélistes, incitation des non zapatistes à les attaquer,
à voler leurs terres, à les massacrer…
Les Zapatistes doivent donc résister davantage toutes ces années sur
plusieurs fronts : ils ont prévenu qu’ils contesteront vigoureusement
les grands projets de développement mis en place par le nouveau
gouvernement, supposément « progressiste », mais déniant totalement les
droits des Indiens.
Aéroport, train à grande vitesse – mal dénommé train maya – grands
hôtels… Des projets inutiles qui ne servent que le capital, un tourisme
consumériste et stupide, finalement complice d’une guerre de basse
intensité, pour accaparer des terres et rendre les populations indiennes
tributaires de la « modernité », imposée de par le monde, selon les
spécificités régionales.
La société zapatiste, son fédéralisme…
L’expérience de cette société s’étend dans toute la partie orientale
de l’État du Chiapas ; dans cette région - qui a une superficie proche
de la Bourgogne, mais bien plus montagneuse - la population indienne est
très largement majoritaire, mais hétérogène : Zapatistes cohabitant
avec les non-Zapatistes. Ainsi, deux régimes politiques coexistent sur
le même territoire. Les Conseils de bon gouvernement (régionaux) et les
communes autonomes sont complètement séparés des structures
administratives et politiques de l’État fédéral mexicain. Ces communes
ne bénéficient d’aucune subvention, ni d’autre financement de l’État
(mais paient l’impôt !)
Les Conseils de bon gouvernement sont les instances régionales de
l’autonomie zapatiste, déclinés en trois niveaux : les décisions, en
premier lieu, sont votées à main levée par les habitant-e-s au sein des
villages : l’assemblée communautaire.
Puis au niveau des communes : le conseil municipal. Chacune rassemble
les villages par dizaines. Enfin, la région englobe trois à sept
communes (selon la géographie et la taille de celles-ci).
Il y a cinq conseils de bon gouvernement dans les territoires
autonomes, siégeant chacun dans un centre régional baptisé caracol
(escargot).
Les conseils régionaux et les conseils municipaux sont élus pour trois
ans, avec des mandats révocables à tout moment et non renouvelables. Ils
élaborent leurs décisions en assemblée régionale ; les projets qui ne
font pas l’objet d’un ample accord au sein de l’assemblée sont renvoyés
en discussion dans les villages, pour recueillir les avis, les
amendements, les oppositions, afin qu’à terme l’assemblée puisse
produire une synthèse et prendre une décision. Ce qui implique parfois
des allers-retours avant l’adoption du projet.
L’autonomie zapatiste est donc un régime politique qui s’élève de la
base jusqu’au « sommet », symbolisé par des « sous-commandants ».
On peut dénommer cette société comme une démocratie réelle, radicale,
directe, fondée sur le principe de « despécialisation » de la chose
publique, de la politique, à l’inverse de la démocratie représentative
qui, elle, permet toutes les dérives politiciennes et corruptives… Si la
hiérarchisation des classes et des catégories sociales est clairement
rejetée, le zapatisme opte pour la rébellion plutôt que pour la
révolution, afin d’éviter l’amalgame avec les révolutions du 20° siècle,
dons la finalité
fut la prise du pouvoir, avec son centralisme étatiste comme instrument
de transformation économique et sociale, mais aux antipodes de la
démocratie directe – seule véritable transformation sociale dont
l’objectif est une société sans classes. Aussi, le rejet radical du
capitalisme, du centralisme politique, des rapports de classes, est en
sécession complète vis-à-vis des structures étatistes, pour développer
un mode de vie fuyant les outils de domination (quel que soit le type de
régime politique usé jusqu’à la corde), tout en favorisant des liens nationaux et
internationaux, dont la finalité est la destruction du capitalisme. Nous
sommes bien dans un procès révolutionnaire.
… Et son mode de production
Comment produit-on au Chiapas ? La paysannerie zapatiste insiste sur
la défense et le développement de l’agro-écologie : rejet des pesticides
de synthèse, protection des semences natives, considération des enjeux écologiques, etc. Cette
paysannerie produit l’essentiel de son besoin alimentaire selon la
tradition. Sont produits en montagne le maïs, le sorgho, le frijole
(petit haricot rouge ou noir), les courges, tomates, ainsi que de
nombreux fruits tropicaux, le riz, les animaux de basse-cour, le miel,
le cacao… Cette méthode d’autosubsistance est développée sur des terres
où la propriété est collective pour un usage familial.
La politique alimentaire sera complétée par un soutien économique de
l’autonomie collective, grâce aux dizaines de milliers d’hectares de
terres récupérées après en
avoir chassé les grands « propriétaires » durant le soulèvement de 1994.
La terre est la base même de l’autonomie ; avec elle, et les travaux
collectifs qui y sont menés, le système de santé peut être couvert,
ainsi que l’autogouvernement et la justice autonome.
Le principe de produire collectivement est concrétisé au moyen des
coopératives de production : cordonnerie, textile, charpente,
ferronnerie, matériaux de construction, café…
En effet, le Chiapas est une importante zone de production d’arabica, au
détriment du robusta, déprécié, en particulier sur le marché. Les
familles disposent de petites parcelles dont la production est
commercialisée via des coopératives.
Puis les réseaux solidaires de distribution sont organisés en Amérique
et en Europe. Cette solidarité par l’économie s’appuie sur deux axes
essentiels pour le soutien à la révolte zapatiste. Primo, un apport
monétaire, certes modeste, mais proportionnellement bien plus
rémunérateur que la vente de la production sur le marché conventionnel
où les transnationales du café imposent leurs misérables tarifs, en
achetant à vil prix, par exemple, des produits de première nécessité
qu’elle ne peut produire. Secundo, la mission des réseaux de solidarité a
également pour tâche, la propagande, la publicité. Il s’agit bien moins
de vendre toujours plus de café afin de
concurrencer l’industrie, que d’informer le consommateur de la lutte des
Zapatistes, de leur projet global et d’une prise de conscience qu’un
fonctionnement sociétal en réseaux, sans hiérarchie structurelle, peut
aussi être une pratique anticapitaliste quelle que soit la latitude.
L’EZLN – une source d’inspiration
Si l’EZLN a bien une dimension militaire, comme l’a prouvé notamment
le soulèvement zapatiste de 1994, celle-ci est minoritaire. Il n’y a pas
de militaires au sens professionnel, la très large majorité de ses
membres sont des civil-e-s, vivant et travaillant dans leur village.
Le cheminement de l’expérience a consisté à poser les armes au profit de
l’action politique civile. En revanche, par défaut d’un accord de paix
avec le gouvernement fédéral, rien n’autorise à son renoncement total.
L’essentiel de l’action zapatiste - surtout à partir de 2003 - tient à
la constitution de l’autonomie dans les territoires « libérés » :
expérience entièrement civile. Son développement s’opère à côté de
l’EZLN, aussi, ceux qui ont des responsabilités en son sein ne peuvent y
participer.
Durant une bonne dizaine d’années, les Zapatistes – par le souscommandant Marcos - défrayaient occasionnellement la chronique.
Entre 1994 et 2001, les objectifs tenaient à la défense des villages, de
leur autonomisation, de la formation politique de leurs habitant-e-s,
etc.
mais également de la tenue de lapremière rencontre intercontinentale
pour l’humanité, contre le néolibéralisme et la longue marche jusqu’à
Mexico. Si depuis le silence s’est imposé, la lutte et l’expérience
continuent… Mais de temps à autre les médias devraient bien – même
partiellement – relater certaines actions. Plusieurs rencontres
internationales se sont tenues dans la forêt de Lacandon (fief
zapatiste). En 2013, pour les vingt ans, plus de 5000 personnes se sont
rendues dans les villages rebelles afin de comprendre l’autonomie
politique zapatiste. L’année suivante, il y eut le festival mondial des
rébellions et des résistances contre le capitalisme. En 2015, un
séminaire international fut convoqué sur La pensée critique face à
l’hydre capitaliste.
Ce type de rencontre s’est succédé les années suivantes…
Les Zapatistes entendent exprimer une source d’inspiration et non un
modèle, alors qu’en parallèle, la défense contre la guerre de basse
intensité est
toujours menée !
D’ailleurs les Zapatistes ne sont pas les seuls à subir le courroux
réactionnaire et criminel, pour preuve s’il en faut : la disparition de
43 étudiants de l’école normale rurale (institut de formation des
enseignants) d’Ayotzinapa (État du Guerrero), en septembre 2014, a
rappelé l’absence de droits humains au Mexique : plus de 15 000
assassinats par an et plus de 24 000 personnes disparues (chiffres
officiels). En 2018, leMexique remporte aussi la palme en nombre
d’assassinats de journalistes.
L’EZLN n’a pas omis d’envoyer au Kurdistan une déclaration de
solidarité pour le combat contre la réaction et l’obscurantisme, et pour
la justice, la paix et l’égalité… Rappelons que dans le nord de la
Syrie, entre 2014 et 2016, les Kurdes ont démontré que non seulement ils
et elles doivent se battre contre les islamistes et l’armée turque,
mais que, dans le même temps, un processus révolutionnaire est entamé
dans cette région revendiquée territoire du Kurdistan. La praxis
libertaire kurde est parallèle à celle des Zapatistes.
Enfin, toujours en solidarité avec les luttes populaires, les Zapatistes ont également formulé des vœux aux Gilets Jaunes.
Avec la formation de la population au fédéralisme et à
l’autogouvernement libérés des hiérarchies, sa protection et son combat
contre 25 ans d’agression, tout en œuvrant au quotidien, le mouvement
zapatiste démontre que l’engagement radical contre la réaction est
possible quels que soient les horizons.
JC le 14.07.2019
Sources :
http://www.cspcl.ouvaton.org/
samedi 31 août 2019
Repenser une critique radicale de l’école capitaliste
Allons-nous abandonner la
critique de l’école aux seuls courants réactionnaires ? Qui aujourd’hui
porte encore une charge radicale contre l’école, contre l’école
capitaliste ? Bien peu monde en réalité puisque l’essentiel de l’effort
fourni, tant dans les milieux enseignants que militants, porte
dorénavant sur la défense a-critique des « services publics », doublée
la plupart du temps d’un corporatisme rance. Le recul se mesure par
ailleurs à l’engouement renouvelé de ces mêmes milieux pour la
« recherche pédagogique ». Vieille limite technicienne vidée de tout
contenu politique et aujourd’hui aveu de repli afin de mieux endurer
l’insupportable au quotidien ; à fortiori dans une époque où l’absence
d’un projet collectif capable de renverser l’ordre social sur lequel
repose cette institution fait cruellement défaut.
Le plus souvent, l’école est naturalisée,
acceptée comme le lieu privilégié de la transmission des connaissances
et plus rarement comprise comme une production sociale historique.
Raison pour laquelle on parle toujours de « l’école », comme si cela
allait de soi. Pourtant, aucun système politique quelqu’il soit n’a
jamais généré de système scolaire qui aille à l’encontre de ses intérêts
propres. L’école qui léviterait, comme détachée des intérêts
particuliers, cette école n’existe nulle part et n’a jamais existé. Même
en se convaincant comme le font certains qu’elle ne serait pas une
entreprise, ce qui est vrai, ou que l’éducation ne serait pas une
marchandise, la réalité est toute différente.
La fonction de l’école
Ce sont les rapports de production qui
déterminent le rôle et le fonctionnement de l’école. L’école assume la
fonction de reproduire le rapport entre les classes sociales et de
transmettre l’idéologie de la classe dominante. Tout le discours sur les
inégalités scolaires ne vise qu’à masquer cette fonction de
reproduction du rapport de classe. La polarisation entre les filières
d’excellence d’un côté et de l’autre les branches d’exécution n’est au
final que la traduction de la division en classes de la société. Le fait
que le patronat laisse en grande partie financer les coûts de la
formation par les contributions générales entretient l’illusion d’une
école au service de tous dans laquelle les savoirs et la culture
seraient recherchés pour eux mêmes. Ce serait oublier bien vite que
c’est par l’intermédiaire d’organismes nationaux et de plus en plus
transnationaux que le capital marque aujourd’hui de son sceau le système
scolaire. Il n’est qu’a s’instruire des listes de recommandations de
l’OCDE, des enquêtes internationales à la PISA et autres outils de
management plus ou moins à distance.

L ’école à l’heure du capitalisme néolibéral
D’une réforme à l’autre, l’organigramme se redéploie mais la permanence de la fonction subsiste
; elle se voit remodelée par la nouvelle rationalité capitaliste.
L’école adopte dorénavant les formes d’organisation de la période
néolibérale : culture du résultat, programmes soumis à la logique des
compétences, nouveau management des services public, etc… Bref, comme on
le déplore souvent dans la gauche syndicale : « On aligne l’école sur le monde de l’entreprise ! », comme si cela semblait être une nouveauté, comme si l’école n’avait jamais travaillé à autre chose qu’à cela …
Bien sûr, personne ne niera l’allongement de la durée de la scolarité même pour la catégorie ouvrière. Comme « le niveau »
qui, dit-on, s’élèverait ou s’effondrerait selon les commentateurs, la
massification ne peut s’entendre qu’en rapport avec l’exigence de mettre
en adéquation la formation des différents secteurs de la main d’oeuvre
avec l’appareil de production. Dans une période où la limite entre
chômage et travail tend à devenir de plus en plus incertaine, cet
allongement de la scolarité permet aussi de retarder l’entrée sur un
marché du travail aléatoire et d’en masquer la réalité.
Les enseignants et le service public
La défense du service public représente
désormais l’alpha et l’omega de la mobilisation enseignante. De par son
antériorité, l’école publique occupe une place particulière au sein de
cet ensemble bien qu’elle s’inscrive dans un compromis identique à celui
que nous décrirons plus loin. Penchons-nous un instant sur ce que sont
les services publics. Ensemble, ils constituent les différentes pièces
de l’appareil d’Etat et furent dès 1945 les piliers de la réorganisation
de la production capitaliste en France. Résultats d’un compromis passé
entre les organisations ouvrières et la bourgeoisie sous la pression
politique et les luttes sociales, il faut tout de même reconnaître que
les travailleurs n’ont jamais eu aucun pouvoir, ni de contrôle sur
l’organisation, le fonctionnement et la finalité de ces fameux services
publics. Lorsque le secteur de l’énergie était encore sous le contrôle
entier de l’Etat, qui eut un jour son mot à dire sur le choix fait du
nucléaire, par exemple ? L’Education Nationale n’a toujours été qu’une
chaîne de commandement verticale, strictement hiérarchisée et jamais
ouvertement remise en question par ses fonctionnaires. Là comme
ailleurs, ce fut le prix à payer en contre partie d’un peu de sécurité …
Mais désormais en position de force, la
bourgeoisie entend reprendre la main sur des secteurs qu’elle estime lui
être bien trop couteux pour un rendement et une efficacité quelle juge
insuffisants. La classe ouvrière déchue voit désormais les services de
l’Etat se retourner contre elle, et les cadres de la fonction publique,
isolés, sans alliance potentielle s’accrochent à des prérogatives dont
ils sont bien seuls à se convaincre qu’ils seraient un bien commun. La
dernière grande grève des cheminots, restée largement isolée, fut
éloquente à cet égard.
Cette défense totalement a-critique des
service publics s’apparente aujourd’hui à un combat d’arrière garde. En
interne, le peu d’intérêt que suscitent auprès des titulaires le sort
réservé aux précaires, l’absence de solidarité active lorsque ceux-ci
parviennent parfois à entrer en lutte, tout cela montre l’incapacité des
fonctionnaires à faire un pas de côté. Cela signe leur impuissance à
dépasser les fables que se raconte l’école sur elle-même, l’incapacité à
admettre le secteur de l’enseignement comme compris dans une totalité,
la totalité capitaliste.
Evolution du recrutement et raidissement idéologique
Dans leur grande majorité, les
enseignants appartiennent à la petite bourgeoisie fonctionnarisée. Pour
combien de temps encore, là est une autre question qui en appellera
d’autres.
Les instituteurs et les institutrices
recrutés à la fin des années 60 provenaient pour près de 45 % d’entre
eux du milieu ouvrier-employé et de la paysannerie. Ceux issus des
familles de cadres supérieurs et moyens comptaient pour un peu moins de
25 %. En 2019, le phénomène s’est inversé sous la pression de la crise
et afin de parer au déclassement. Si l’idéologie que véhiculent les
enseignants a toujours été pétrie de méritocratie -les enseignants sont
en règle général d’anciens « bons élèves » qui « aiment l’école » et se
sentent redevables-, elle se double aujourd’hui d’un raidissement
idéologique.
A l’heure de la massification achevée et
tandis que les contradictions s’aiguisent on évoque souvent, sans la
préciser, la « crise de l’école ». On observe que la distance, parfois
la rupture, qui sépare le monde enseignant des familles prolétaires,
celles du moins qui n’ont tiré aucun bénéfice de l’école, confinent à la
haine de classe, inconsciente ou ostensiblement affichée. Le « métier
impossible » compte toujours en son sein nombre d’exécutants dévoués et
investis sur qui l’institution peut d’ailleurs s’appuyer afin que
l’édifice ne s’ effondre pas totalement, mais le repli est
incontestable.
Il se traduit entre autre par la fonte du
nombre des syndiqués et par le succès relatif des listes droitières et
corporatistes aux dernières élections professionnelles. Ce sont ces
mêmes listes qui, par exemple, réclament avec le ministère un statut
spécifique et encadré pour les directeurs d’école. La mesure ne semble
même plus rencontrer d’opposition au sein des équipes enseignantes alors
qu’elle avait soulevé un fort mouvement de contestation dans les années
80, porté par des coordinations de grévistes qui avaient bousculé les
syndicats.
Les notions d’exploitation sont absentes
de la réflexion des enseignants. N’ayant qu’un rapport abstrait et
lointain au monde de la production, leur critique se fait toujours au
travers des codes de la bourgeoisie et en référence au cadre scolaire.
Les courants de la gauche syndicale s’en tiennent quant à eux à une
terminologie vague qui réclame une « autre école » par
« l’auto-gestion » et sa « démocratisation ».
L’absence de soutien massif des
enseignants à l’égard des lycéens et étudiants en mouvement ces
dernières années révèle qu’avec le recul de la contestation ouvrière, ce
monde de l’entre-deux bascule tendanciellement du côté de la
bourgeoisie. Son absence, voire son opposition au mouvement des Gilets
Jaunes n’ a été qu’une illustration supplémentaire de ce phénomène. Un
des animateurs de la revue Temps Critiques déclarait que le
mouvement des Gilets Jaunes représente tout ce que détestent les
enseignants : le désordre, le non-respect des règles, etc … Rien n’est
plus vrai ! Les « Stylos-Rouges », cette tentative avortée aux exigences
corporatistes a tâché de profiter de la dynamique du mouvement des
Gilets Jaunes pour se faire entendre mais sans jamais s’y fondre. On ne
mélange pas les torchons et les serviettes …

L’école contre le prolétariat
Après l’effondrement du bloc de l’Est et
l’abandon des utopies collectives, l’école allait à son tour donner le
coup de grâce à un monde ouvrier désorienté et en voie d’effacement.
Dans les années 70 Baudelot et Establet affirment que l’inculcation de
l’idéologie bourgeoise passe par le refoulement et l’interdiction faite au prolétariat de formuler l’idéologie dont elle a besoin(1).
Dans les années 90, l’école passe à la vitesse supérieure en devenant
l’un des lieux de diffusion de l’identité citoyenne en remplacement de
celle de l’ouvrier et du prolétaire producteur. Dans leur enquête menée
au sein de l’usine Peugeot de Sochaux, Beaud et Pialoux montrent comment
les Lycées Technique travaillent à leur échelle à la désouvriérisation(2).
En configurant les futurs « opérateurs » par le discours patronal et
l’idéologie technicienne, ces établissements travaillent à déstabiliser
idéologiquement les restes du vieux mouvement ouvrier organisé. Les fils
apprendront à renier leurs pères, à les déchoir et les ringardiser ;
eux et la culture qu’ils s’étaient construits. Et dans cette offensive,
les enseignants ont choisi leur camp. Après avoir épousé le point de vue
de la légitimité industrielle ils s’appliqueront à disqualifier auprès
des élèves l’identité, la culture et surtout la résistance ouvrière.
L’allongement de la scolarité a également
approfondi la distance qui sépare culturellement les générations de
prolétaires entre elles. Le chômage de masse fera le reste et la
nouvelle génération contribuera à liquider la culture d’opposition au
travail de la précédente. Comme le remarquent encore Beaud et Pialoux,
c’est à la transmission d’un héritage que s’est attaquée l’école en
accentuant et en accélérant la crise d’un modèle. Cette crise, on la
mesure au sein des nouvelles générations au recul de la culture
« anti-école », jusqu’alors largement répandue et partagée au sein du
groupe. Comme l’explique Paul Willis dans une autre enquête menée en
Angleterre auprès d’enfants d’ouvriers, cette culture refusait de
prendre au sérieux un univers imaginaire, illusoire, infantilisant et
qui surtout n’avait rien à lui apporter (3). Mais comme le conclut
Willis, si cette culture constitua une réelle remise en cause
idéologique, elle ne déboucha pas nécessairement sur une action
collective. La culture anti-école propre aux jeunes ouvriers en devenir
avait intégré une part d’individualisme induite par les séparations qui
clivaient le groupe : séparations d’ordre sexuel et ethnique
essentiellement.
Les contradictions de la pédagogie
Après la sempiternelle question des
moyens, qui fixe les limites traditionnelles dans lesquelles sont
circonscrites les revendications enseignantes, c’est autour de la
pédagogie que virevolte le discours sur l’école. Il se borne le plus
souvent à une opposition aussi stérile que factice entre modernes et
anciens. Ce faux débat a surtout une vertu, celle de substituer le fond
au profit de la forme, d’amuser le regard en le détournant de
l’essentiel. Et le débat enfle d’autant que la pédagogie se targue
aujourd’hui de s’être élevée au rang d’une science. Les milieux plus
critiques ne sont pas épargnés puisque la pédagogie -« émancipatrice »
pour l’occasion- occupe une place de choix dans son corpus ; il n’est
qu’à voir auprès des éditeurs militants le nombre d’ouvrages qui se
re-publient sur la question ces derniers temps.
Sur ce terrain là, combien d’illusions
ont été entretenues et le sont encore dont les premiers bénéficiaires ne
furent certainement pas les enfants de prolétaires. Au début des années
70, Baudelot et Establet à propos des méthodes dites « actives » ou
« non directives » soulignaient qu’elles ne proposent pas d’amener les
élèves à un certain niveau de connaissances mais de les rassurer
moralement par la mise en confiance et l’affection.
Cinquante ans plus tard et libérés des
carcans d’un enseignement trop rigide, ce même pédagogisme mis au
service d’une nouvelle organisation des procès de travail produit des
élèves prétendument
« autonomes » pétris de « savoir être », prêts à « s’auto-stimuler » tout le long de leur vie et de leur carrière professionnelle. Joli retournement. A l’autre bout de la chaîne, dans les écoles élémentaires des Réseaux de l’Education Prioritaire, l’institution promeut les activités et les méthodes occupationnelles à moindre coût. Les dispositifs et projets en cascade comme la « lutte contre les écrans », la « co-parentalité » (!), etc… occupent le devant de la scène tout en stigmatisant dans une ambiance divertissante, de centre aéré, des populations reléguées. Cette culpabilisation bienveillante est d’autant plus abjecte que la reproduction du modèle familial bourgeois en milieu prolétarien est bien souvent hors de portée, à fortiori en temps de crise.
« autonomes » pétris de « savoir être », prêts à « s’auto-stimuler » tout le long de leur vie et de leur carrière professionnelle. Joli retournement. A l’autre bout de la chaîne, dans les écoles élémentaires des Réseaux de l’Education Prioritaire, l’institution promeut les activités et les méthodes occupationnelles à moindre coût. Les dispositifs et projets en cascade comme la « lutte contre les écrans », la « co-parentalité » (!), etc… occupent le devant de la scène tout en stigmatisant dans une ambiance divertissante, de centre aéré, des populations reléguées. Cette culpabilisation bienveillante est d’autant plus abjecte que la reproduction du modèle familial bourgeois en milieu prolétarien est bien souvent hors de portée, à fortiori en temps de crise.

Du reste, il est piquant de noter
qu’aujourd’hui comme hier, nombre de rétrogrades se fourvoient
lorsqu’ils prêtent à la pédagogie vertus et défauts dont on ne saurait
la tenir pour responsable. Et ce n’est pas sans raison si ce sont des
praticiens « tout terrain » tels Fernand Deligny ou Makarenko qui lui
portèrent parfois la critique la plus implacable : « De la science
pédagogique je pensais avec colère : depuis combien de millénaires
existe-t-elle ! Quels noms, quels esprits étincelants : Pestalozzi,
Rousseau, Natorp, Blonski ! Que de livres, que de papiers, que de
gloire ! Et cependant le vide, le néant, pas moyen de venir à bout d’une
jeune gouape, ni méthode, ni instrument, ni logique, absolument rien.
Une “espèce de charlatanisme”(4).
Pédagogie et mouvement ouvrier
Maintenant, au delà de l’activité
commerciale que génère aujourd’hui la pédagogie, à titre d’exemple il
suffit d’observer la recrudescence des établissements privés ou non se
réclamant des précautions de la doctoresse Montessori(5), et sans
s’étendre plus longuement sur ses prétentions scientifiques,
reconnaissons qu’il lui arriva parfois d’apporter sa contribution à
l’émancipation humaine en générale et à celle du prolétariat en
particulier. Lorsqu’elle s’adossa au mouvement ouvrier révolutionnaire,
alors, elle prit son sens. Englobée dans un processus de bouleversement
social la dépassant, elle s’en nourrissait en retour. C’est là l’intérêt
que l’on peut trouver aux différentes expériences que menèrent chacun à
leur manière Ferrer, Makarenko, Freinet et bien d’autres…

S’il y a nécessité de repenser un projet
éducatif pour le prolétariat, ce sera celui du dépassement de l’école en
tant que lieu infantilisant, séparé de la production et de la société
en général. Ce ne pourra être qu’un projet qui vise dans et par sa
pratique à l’abolition de la séparation entre activités manuelles et
intellectuelles. Mais avant cela, c’est à la refondation de notre propre
camp de classe que nous devons nous atteler et sur ce terrain là, il
n’y a guère de solution clé en main…
Boulogne-sur-mer, le 19/06/2019. *
——————————————-
(1) L’école capitaliste en France. Baudelot & Establet. Ed. Maspéro. 1971.
(2)Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbelliard. S.Beaud , M.Pialoux. Ed Fayard. 2006.
(3) L’école des ouvriers. Paul Willis. Ed.Agone.
(4)Anton Makarenko : « Un art de savoir s’y prendre » : Revue Reliance (Revue des situations de handicap, de l’éducation et des sociétés)
(5) Pour la doctoresse Montessori, la science pédagogique valait bien quelques accommodements … Etait-ce par cécité, par opportunisme ou par ignorance qu’elle trouva auprès de Mussolini, avant de rompre bien plus tard avec le régime, le soutien nécessaire à ses activités ?
* Ce texte est initialement paru dans le numéro 292 de la revue Courant Alternatif. Pour en savoir plus sur cette revue, rendez-vous sur le site de l’OCL : http://www.oclibertaire.lautre.net
(2)Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbelliard. S.Beaud , M.Pialoux. Ed Fayard. 2006.
(3) L’école des ouvriers. Paul Willis. Ed.Agone.
(4)Anton Makarenko : « Un art de savoir s’y prendre » : Revue Reliance (Revue des situations de handicap, de l’éducation et des sociétés)
(5) Pour la doctoresse Montessori, la science pédagogique valait bien quelques accommodements … Etait-ce par cécité, par opportunisme ou par ignorance qu’elle trouva auprès de Mussolini, avant de rompre bien plus tard avec le régime, le soutien nécessaire à ses activités ?
* Ce texte est initialement paru dans le numéro 292 de la revue Courant Alternatif. Pour en savoir plus sur cette revue, rendez-vous sur le site de l’OCL : http://www.oclibertaire.lautre.net
——————————————-
Encadré :
L’enfance, parlons-en !
Il en va de l’enfance comme de l’école,
elle est avant tout une construction sociale, historiquement datée et
d’origine plutôt récente. Au moyen Age, l’enfance n’existait pas. En
Europe, ce n’est qu’à partir du 18° siècle que « l’école va se
substituer à l’apprentissage et que les enfant seront séparés des
adultes auprès desquels ils apprenaient la vie ». Cette catégorie
n’est plus guère questionnée aujourd’hui, hormis sous le contrôle des
spécialistes en tous genres : neuroscientifiques, médecins, pédiatres,
psychologues, orthophonistes, la liste est longue comme le bras …
L’enfance est devenue un marché spécifique en constante expansion. C’est
ce rapport qu’entretient le capitalisme à l’enfance, un rapport qui
s’est lui aussi reconfiguré au fil du temps, qu’il s’agirait aussi de
ré-interroger et de critiquer radicalement. Dans le monde occidental,
l’école n’est plus le seul espace, ni le seul temps où l’on prolonge
arbitrairement l’enfance. Partout dans la société, l’infantilisation
fait chaque jour des progrès remarquables …
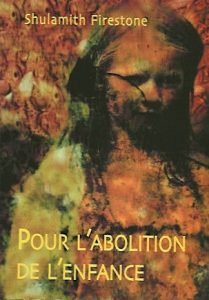
Pour l’abolition de l’enfance
Shulamith Firestone
Ed. Tahin Party
Confrontés au peu de matériel critique
produit dans la période, et pour cause … on trouvera dans cet opuscule
de Shulamith Firestone écrit il y a quelques décennies déjà, matière à
réflexion. Nullement exempt de faiblesses et cédant parfois aux
raccourcis, ce texte mériterait pourtant d’être aujourd’hui exhumé et
rediscuté.
samedi 24 août 2019
L’Espagne lance un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahu
Au moment où grâce à l'affaire Epstein, l'Occident découvre effaré,
les méthodes employées par le Mossad pour assurer un soutien
inconditionnel à l'entité sioniste, de
la part de la classe politique américaine, fragilisée par ses
perversions, certains pays européens dont l'Espagne relancent la machine
judiciaire contre les criminels israéliens.
L'image d'Israël se détériore d'heure en heure car l'opinion publique
américaine a enfin compris qu'Israël utilise le chantage sexuel pour
obtenir le soutien politique des élus pédophiles au sein du Congrès.
En France et malgré le black out de nos médias pour étouffer cette affaire qui va changer l'Amérique, Internet est en pleine ébullition et l'affaire Epstein fait partie des sujets les plus commentés.
Bien évidemment, les citoyens français s'interrogent aussi sur les raisons qui poussent nos gouvernements à soutenir un Etat condamné par plus de 200 résolutions de l'ONU pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sans oublier que la prétendue "seule démocratie du Moyen Orient" est officiellement un Etat d'apartheid.
Comment expliquer que le pays des droits de l'homme puisse être l'ami d'un Etat qui les bafoue tous ?
Existe-t-il un Epstein français ? Est-ce que le soutien incompréhensible que manifestent certains de nos élus à l'égard de l'entité sioniste ne cache pas là aussi, quelque chose d'inavouable ?
En tout cas l'étincelle qui éveille les consciences vient de se produire aux Etats-Unis et il est certain que le feu va bientôt toucher l'Europe aussi.
Cette décision judiciaire de la justice espagnole est un premier signe qui prouve que l'impunité d'Israël n'est plus garantie et qu'elle va cesser.
Voir : https://www.europe-israel.org/2019/08/lespagne-lance-un-mandat-darret-contre-benjamin-netanyahu-pour-lattaque-de-la-flottille-qui-voulait-forcer-le-blocus-de-gaza-en-2010/?fbclid=IwAR3kOMEFrj-jZ6g-2Jb5f-7szfbavaCYRDrkSwJ4hV2GYZ5YuuMfYn90Qus
En France et malgré le black out de nos médias pour étouffer cette affaire qui va changer l'Amérique, Internet est en pleine ébullition et l'affaire Epstein fait partie des sujets les plus commentés.
Bien évidemment, les citoyens français s'interrogent aussi sur les raisons qui poussent nos gouvernements à soutenir un Etat condamné par plus de 200 résolutions de l'ONU pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sans oublier que la prétendue "seule démocratie du Moyen Orient" est officiellement un Etat d'apartheid.
Comment expliquer que le pays des droits de l'homme puisse être l'ami d'un Etat qui les bafoue tous ?
Existe-t-il un Epstein français ? Est-ce que le soutien incompréhensible que manifestent certains de nos élus à l'égard de l'entité sioniste ne cache pas là aussi, quelque chose d'inavouable ?
En tout cas l'étincelle qui éveille les consciences vient de se produire aux Etats-Unis et il est certain que le feu va bientôt toucher l'Europe aussi.
Cette décision judiciaire de la justice espagnole est un premier signe qui prouve que l'impunité d'Israël n'est plus garantie et qu'elle va cesser.
Voir : https://www.europe-israel.org/2019/08/lespagne-lance-un-mandat-darret-contre-benjamin-netanyahu-pour-lattaque-de-la-flottille-qui-voulait-forcer-le-blocus-de-gaza-en-2010/?fbclid=IwAR3kOMEFrj-jZ6g-2Jb5f-7szfbavaCYRDrkSwJ4hV2GYZ5YuuMfYn90Qus
Exclusif : la liste des eurodéputés à la solde du mondialiste Georges Soros
A propos du milliardaire apatride Georges Soros, agitateur mondialiste, voici un document particulièrement intéressant, publié par l’Open Society de Georges Soros et intitulé Reliable allies in the European Parliament (2014-2019), soit les alliés au Parlement Européen durant la mandature 2014-2019.
Ce fascicule contient les noms de 226 députés européens (sur 751) susceptibles d’être des alliés fiables de l’Open Society. Le document présente une fiche individuelle pour chacun d’eux (pays, groupe politique, commissions et délégations auxquelles ils participent, parcours professionnel, politique et militant, centres d’intérêts dans lesquels ils seraient susceptibles d’être utiles et coordonnées).
Le
document se veut pratique et répertorie les députés par pays, mais aussi
par commission et délégation étrangère, afin de mieux cibler les
« alliés » de l’Open Society dans chaque lieu de pouvoir.
Voici la liste des eurodéputés français sur lesquels Georges Soros peut compter :
. Michèle ALLIOT-MARIE (notamment pour ses liens avec des dirigeants africains)
. Guillaume BALAS
. Alain CADEC (notamment pour son rôle au sein de la délégation du Parlement Européen auprès de la Russie)
. Jean-Marie CAVADA (signalé comme en perte d’influence)
. Karima DELLI (notamment pour les questions des Roms, du gender et LGBT)
. Marielle DE SARNEZ
. Sylvie GOULARD (notamment au niveau de la politique monétaire)
. Sylvie GUILLAUME (notamment sur les questions d’immigration, de lutte contre les populismes et de LGBT)
. Yannick JADOT
. Eva JOLY
. Alain LAMASSOURE
. Edouard MARTIN
. Elisabeth MORIN-CHARTIER (notamment sur le gender et les droits de l’homme)
. Younous OMARJEE
. Christine REVAULT d’ALLONNES BONNEFOY (notamment sur les questions de gender et d’immigration)
. Marie-Christine VERGIAT (notamment sur le gender et les droits des minorités)
[...]
Source : https://www.medias-presse.info/exclusif-la-liste-des-eurodeputes-a-la-solde-du-mondialiste-georges-soros/69785/
Libellés :
lobby,
politique internationale,
Union Européenne
vendredi 23 août 2019
CNT - Le nouvel ordre mondial en France [vidéo du 28 mai 2017]
Comment rendre une dictature invisible...
Source : https://www.youtube.com/watch?v=VE9PPpfx6kc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0whlrapCey6mrBaciz0uMj84Z1dTQ3un4g1Eo_nEYlttabZDP7IPwUYjY
Source : https://www.youtube.com/watch?v=VE9PPpfx6kc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0whlrapCey6mrBaciz0uMj84Z1dTQ3un4g1Eo_nEYlttabZDP7IPwUYjY
Libellés :
Eric Fiorile,
politique,
politique internationale
jeudi 22 août 2019
Epstein: Trump compromis?
Epstein a-t-il été assassiné parce qu'il en savait trop sur Trump?
Jusqu'où s'étend le pouvoir de l'État profond sur l'administration
Trump? Les patriotes américains sont-ils en contrôle? Epstein n'est pas
mort.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=SweV_mFr1yg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CzGLe78bTvL86LWC8P9Gc4AswXQ_C60NZd31mvjYDgtEzfc_9I0IHa2I
Pour aider Radio Québec : http://www.paypal.me/alexiscossette
Source : https://www.youtube.com/watch?v=SweV_mFr1yg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CzGLe78bTvL86LWC8P9Gc4AswXQ_C60NZd31mvjYDgtEzfc_9I0IHa2I
Pour aider Radio Québec : http://www.paypal.me/alexiscossette
Libellés :
actualité,
Alexis Cossette-Trudel,
politique internationale,
radio
Pathologie du pouvoir : Psychologie des leaders psychopathes – Sommes-nous complices ? (3/3)
« Lorsque tout va bien, les fous sont dans les asiles, en temps de crise ils nous gouvernent. » [Carl Gustav Jung].
N’en déplaise à ceux qui croient encore
au Père Noël, Carl Gustav Jung ne s’y est pas trompé, car comme le
disait Frédéric Lordon dans l’émission radio de Daniel Mermet, Là-bas si j’y suis du vendredi 16 septembre 2011 (partie 3/12 à 3’10) au sujet de la crise qui sévit depuis 2008 : « […] Lorsque l’on est confronté à des phénomènes sociaux bizarres, il
faut se rendre aux hypothèses psychiatriques en tout dernier ressort,
quand on a épuisé toutes les autres. Mais malgré tout il faut bien dire
que toute cette affaire[1] à tous les aspects d’une histoire de fous, et très honnêtement, je ne sais pas comment l’expliquer autrement. Donc j’essaie de résister et de ne pas me rendre à cette hypothèse, mais tout m’y porte… »
Et effectivement, certaines hypothèses
psychiatriques expliquent très bien la crise mondiale actuelle au
travers du concept de psychopathie – ou son équivalent français : la
perversion narcissique (« succesful psychopath ») – qui a tendance à
sérieusement interroger certains médias comme en témoigne
l’impressionnante série d’articles publiés récemment dans la presse
spécialisée et dont voici une liste non exhaustive :
- 6 janvier 2012, Atlantico.fr, « La psychiatrie pour expliquer la crise ? Wall Street serait un aimant à psychopathe ».
- 21 novembre 2012, Audrey Duperron sur Express.be, « Où trouve-t-on le plus de psychopathes ? Dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les conseils d’administration des entreprises ? »
- 8 février 2013, Atlantico.fr, « Toujours plus nombreux au bureau, comment repérer les psychopathes, les machiavéliques ou les narcissiques ? »
- 11 février 2013, Annie Khan sur Le Monde.fr, « Quand les patrons psychopathes nous empoisonnent la vie ».
- 27 février 2013, Nathalie Côté sur Lapresse.ca, « Mon collègue, ce psychopathe ».
- 7 mars 2013, Sylvia Bréger pour Cadre Dirigeant Magazine, « Psychopathe en costume et cravate ».
- 11 août 2014, Magazine Capital n° 274 du mois de juillet 2014, « Le pervers narcissique au bureau, le repérer, le combattre ».
- 19 septembre 2014, Manfred Ket de Vies sur le site de la Harvard Business Review France, « Votre chef est-il un psychopathe ? »
- Etc.
Précisons toutefois que compte tenu des
études actuelles sur le problème psychopathique, et comme maintes fois
rappelées au fil de mes écrits, le terme « psychopathie » devrait
s’écrire au pluriel, car la perversion narcissique n’en est que la forme
la plus « aboutie » correspondant, dans la présentation qu’en fait
Gérard Ouimet, au « renard bien cravaché » ou au « psychopathe en col
blanc » également appelé « criminel en col blanc ». Ce dernier terme
désignant des personnalités qui telle que le tristement célèbre Bernard Madoff se
livre à la criminalité la plus répandue à l’heure actuelle, mais
pourtant la plus méconnue et la moins sanctionnée de toutes. Rien
d’étonnant à cela, car dans un monde où l’imposture est
institutionnalisée, ceux qui s’y livrent le plus sont ceux-là mêmes qui
nous dirigent.
Un avis partagé par de plus en plus
d’observateurs et de chercheurs comme Clive Boddy, ancien professeur de
marketing à l’université de Nottingham et auteur de Corporate Psychopaths : Organisational destroyers,
pour qui ce sont les psychopathes d’entreprises, notamment ceux que
l’on trouve à Wall Street ou sur toutes les places boursières qui sont
responsables de la crise actuelle.
Ni plus, ni moins !
Et il faudra s’y faire, car tant que ce
problème ne sera pas réglé, les psychopathes qui détiennent actuellement
le pouvoir continueront à étendre leur emprise sur la planète entière,
car leur désir de puissance ne connaît aucune limite.
S’ils représentent moins de 1% de la
population (bien moins en réalité, car sur les 1 % de psychopathes
statistiquement présent parmi nous, seule une infime partie occupe des
postes stratégiques pouvant influer sur les décisions des États) ils
provoquent au minimum deux fois plus de désastres que de bienfaits (cf.
les études présentées à la partie 2/3 de cet exposé).
Mais ce que ne révèlent cependant
pas les quelques études portant sur le sujet, c’est la permanence des
décisions catastrophiques prises par de tels individus et leurs impacts
sur le long terme.
De fait, si l’on mesure désormais assez
bien l’impact d’une mauvaise décision d’un dirigeant psychopathe, on
limite cet impact à la durée du mandat qu’il a exercé. Or, certaines
décisions ont des conséquences qui perdurent et continuent à nuire à
ceux qui les subissent durant de nombreuses années encore – parfois même
des décennies – après les mauvais choix effectués par ce type de
leader. Par ailleurs, lorsque nous prenons conscience de la situation,
c’est toujours après que le mal ait été fait. Jamais avant.
Subséquemment, si pendant la période de
présence à des postes à hautes responsabilités on enregistre deux fois
plus de mauvaises décisions que de bonnes chez les leaders au
narcissisme pathologique, sur la durée d’influence de leurs mauvaises
décisions, on peut estimer leurs impacts dans un rapport d’échelle de
dix contre un en moyenne² (les exemples tels que Madoff & co sont
beaucoup plus fréquents que ce qui nous est présenté dans les médias
mainstreams).
Autrement dit, un leader psychopathe génère en moyenne dix (10) fois plus de problèmes qu’ils n’apportent de solutions.
On comprend le cercle vicieux dans lequel
s’enferment et nous enferment ces personnalités pathologiques qui suite
à une décision prise dans l’unique but de satisfaire leur narcissisme
pathologique créent un évènement ou une situation catastrophique qu’ils
ont ensuite à charge de devoir corriger compte tenu de leur statut. Mais
comme la solution qu’ils apportent aux problèmes qu’ils ont eux-mêmes
engendrés est uniquement motivée par leur désir de satisfaction
égocentrique, ils génèrent une nouvelle catastrophe. Et ainsi de suite ad vitam æternam jusqu’à ce que la chute – la leur et celle dans laquelle ils nous entrainent tous – les arrête.
C’est la stratégie du pompier pyromane
qui en se faisant passer pour le sauveur d’une situation dont il est
lui-même responsable, en tire un bénéfice narcissique. Peu importe les
dégâts occasionnés à son entourage, seul le plaisir personnel importe
pour ses individus au narcissisme pathologique marqué par une absence de
limite entre soi et autrui et un déni d’altérité.
C’est dire si le développement de cette pathologie au « carrefour du social, du politique, du juridique et du psychiatrique »[2]
peut rapidement conduire à une véritable catastrophe si nous n’y
prenons pas garde. C’est dire également combien il est important, comme
le disait Frédéric Lordon, de se pencher sur les hypothèses
psychiatriques.
Dans les deux premières parties de cette
série d’articles, nous avons beaucoup insisté sur le narcissisme et la
façon dont cet aspect de la personnalité est désormais envisagé par le
nouveau DSM-5. Nous avons également évoqué les nombreuses incidences
négatives de ses personnalités tant pour leur entourage que pour
eux-mêmes et l’organisation qu’ils dirigent.
Rappelons-en à grands traits les principales caractéristiques :
- autosuffisance;
- solitude revendiquée, mais non assumée;
- toute-puissance de la pensée;
- idéal grandiose de perfection;
- sentiment d’ennui et de monotonie;
- angoisses d’engloutissement et/ou d’étouffement;
- perception de son identité insuffisante[3], floue des limites soi/autrui;
- besoin constant de s’affirmer vis-à-vis des autres d’où son autoritarisme.
Outre ces aspects quelque peu rébarbatifs de la personnalité narcissique, son système de pensée a ceci de particulier que « la
logique du narcissisme pathologique est : le monde et moi nous ne
faisons qu’un, tout sera uniforme, tout sera à mon service. »[4]
D’où nous comprenons comment ils
organisent le monde autour d’une pensée unique à laquelle ils adhérent.
Dans notre société d’aujourd’hui, cette pensée unique porte un nom,
c’est celle de l’homo œconomicus qui sans être nommée est bel et bien celle qui prédomine au sein du nouvel ordre mondial actuel (cf. « Peut-on se fier à notre jugement, la fiabilité des “experts*” en cause »).
Dès lors, de plus en plus de
professionnels se posent la question de savoir comment une logique de
pensée spécifique s’actualise dans le monde réel en produisant les
malheurs que nous pouvons tous constater désormais. L’un de ces
chercheurs, Manfred Ket de Vries, auteur du dernier article cité en lien
ci-dessus, a été le premier à mettre en relation le narcissisme
pathologique des dirigeants avec les dysfonctionnements de
l’organisation qu’ils dirigent. Ses ouvrages peu connus sont d’une
remarquable perspicacité. Il y souligne l’extrême difficulté à faire la
distinction entre le génie professionnel et le psychopathe (cf. tableau comparatif de chacun de ces deux archétypes)
et passe en revue les nombreuses facettes de cette problématique, tant
du point de vue des leaders narcissiques que des personnes qu’ils
séduisent.
D’un point de vue psychiatrique, les
travaux de Manfred Ket de Vries rejoignent ceux de nombreux auteurs qui
se sont penchés sur la clinique de l’imposteur (cf. « La
fabrique des imposteurs, si le pervers narcissique m’était “compté” ou
comment le paradoxe de l’idéologie néolibérale influence nos
personnalités »)
qui sous une autre approche ont donné lieu à la théorie de la
perversion narcissique développée sur ce site tout au long de mes
articles.
Mais pour qu’une imposture se réalise, il lui faut un public, car « le mensonge et la crédulité s’accouplent et engendrent l’opinion » (Paul Valery). C’est ainsi que « d’une
manière symbolique, les imposteurs semblent assumer le rôle d’une mère
archaïque, très protectrice, qui satisfait d’immenses désirs, permettant
de réaliser le vœu de capter une totale attention, un vœu qui date de
l’enfance, presque oublié, mais auquel on n’a jamais vraiment renoncé.
Pour leur public, les imposteurs représentent quelqu’un qui comprend
tous leurs besoins, qui peut exprimer leurs désirs les plus profonds et
qui se souciera d’eux. Pour l’imposteur, l’avidité similaire du public
le stimule constamment. Le monde de rêves du public, une fois
que l’imposteur est parvenu à y pénétrer, recèle des demandes infinies.
Ainsi, imposteur et public sont liés par des intérêts qui coïncident,
pour former une entente inconsciente ; comme l’a dit W.C.
Fields, “vous ne pouvez pas tromper un honnête homme”. Le public est
heureux, car il attend ce qui va satisfaire sa demande. Quant à
l’imposteur, il a besoin du public pour neutraliser un sentiment de vide
intérieur et réaffirmer une certaine sorte d’identité. Bien sûr, le
public est davantage prédisposé en temps de crise et d’agitation,
lorsque l’imposture peut atteindre une grande échelle, car il a un
besoin, conscient ou informulé, de sauveur. »[5]
En de telles circonstances, de nombreux chercheurs parleront de complicité d’un peuple crédule
dans la genèse de l’émergence du leader narcissique. Toutefois, rares
sont ceux qui ont également interrogé cette crédulité qu’ils
reconnaissent – ou non – au peuple, même lorsque ceux-ci, comme Manfred
Ket de Vries qui parle également de complicité, ont pourtant bien cerné
la dualité bourreau/victime comme en témoigne cet extrait : « La
plupart des gens rentrent dans le droit chemin et deviennent complices,
passivement ou activement, des représailles du leader contre ceux qui ne
sont pas disposés à rentrer dans le moule. Ce comportement vise à
s’autoprotéger de deux façons. D’abord, cela limite le risque de devenir soi-même victime du leader. Ensuite […] s’identifier à l’agresseur est une façon de résoudre son sentiment d’abandon et d’impuissance en face du totalitarisme.
Se sentir proche du leader – s’intégrer au système – crée l’illusion de
devenir puissant soi-même. Ce processus d’identification à l’agresseur,
l’incitation à participer à une forme de pensée commune, cela
s’accompagne de certaines exigences. La moins subtile de ces exigences,
c’est de participer à la violence perpétrée contre les ennemis désignés
de l’agresseur. Partager de cette manière une même culpabilité devient
le signe de son engagement. C’est ainsi que le leader fabriquera
constamment des traîtres. La majorité des partisans, partagés entre
l’amour et la crainte du leader, se soumettront aux demandes qui leur
seront faites. Ils ont à leur disposition beaucoup de boucs
émissaires commodes sur lesquels venger le groupe, si les choses ne vont
pas comme le souhaite le leader – des entités bien réelles sur
lesquelles projeter tout ce dont on a peur, tout ce qui est perçu comme
le mal et qui menace le système. Une telle démarche peut aboutir
à des résultats désastreux. Elle peut conduire à la destruction
complète de l’organisation par elle-même ou, dans le cas d’un leader
politique, à la perte de la nation tout entière. »[6]
C’est ce mécanisme d’autoprotection qu’avait cherché à saisir Étienne de la Boétie dans son Discours de la servitude volontaire
écrit en 1549 à l’âge de 18 ans, sans toutefois parvenir à l’expliquer
malgré une brillante analyse psychologique des tyrans au pouvoir.
Mais à la connaissance de ce mécanisme de
protection, il convient également d’ajouter la compréhension des
conflits intra- et interpsychique que seule la théorie de la perversion
narcissique a pu conceptualiser. Ce n’est qu’à cette unique condition
que nous pouvons appréhender la destructivité dont sont porteurs les
leaders psychopathes, car ils exportent leur propre mal-être dans le
monde extérieur du fait de leur absence de limite. Ces techniques très
particulières d’export des conflits intrapsychiques sont ce que
Paul-Claude Racamier qualifie de « rien de plus difficile à comprendre [et] rien de plus important à connaître dans les rouages interpsychiques des familles, des institutions, des groupes et même des sociétés » (cf. « Pathologie du pouvoir : Psychologie des leaders psychopathes – Question de narcissisme »).
Conclusion :
L’importance du narcissisme individuel dans les organisations a longtemps été minorée. Manfred Ket de Vries s’en désole : « il
est regrettable de constater que les systèmes de protection, de freins,
et de contrepoids, qui fonctionnent dans les grandes organisations,
parviennent rarement à déceler les signes d’une personnalité narcissique
dangereuse avant que le mal n’ait été déjà fait. »[7]
Quant à Gérard Ouimet, il conclut ainsi l’un des chapitres de sa thèse : « Les
ostensibles qualités enjôleuses du leader narcissique camouflent une
dynamique psychologique à maints égards socialement dysfonctionnelle.
L’engouement collectif suscité par l’étalage d’une saisissante prestance
de la part du leader narcissique fait rapidement place à la dérive
organisationnelle et à la souffrance humaine. »[8]
Il n’est plus possible aujourd’hui de
douter sur les causes de cette souffrance humaine, car nous en
connaissons désormais les mécanismes grâce aux importants travaux
réalisés ces dernières années depuis l’apparition du concept de
harcèlement moral dans les années 90 qui ont abouti en 2002 à une loi et
à la mise en place de nombreuses structures luttant contre les risques
psychosociaux. Les incidences négatives telles que listées lors de la seconde partie de cette série d’articles
sont innombrables et nous en mesurons tous un peu plus chaque jour la
gravité. Tout reste encore à faire afin de circonscrire ce fléau qui,
quoique l’on puisse en penser nous affecte tous sans exception aucune. À
vrai dire, nous ne faisons seulement que commencer à le comprendre.
C’est pourquoi nous pouvons dire avec Gérard Ouimet que : « le choix judicieux d’un leader se doit d’aller au-delà du superficiel vernis maquillant de profonds défauts structuraux… »[9]
Cela remet directement en question le
moyen de sélection de nos leaders politiques, car lorsqu’un système tel
que celui que nous connaissons à l’heure actuelle, ne nous propose plus
que de voter pour des narcissiques pathologiques, cela revient à n’avoir
pas d’autres alternatives que celle de choisir entre la peste ou le
choléra. Il est donc essentiel de penser à un véritable changement qui
laisse place à des organisations ne favorisant pas ce type de
personnalité.
Toutefois, si nous sommes certes en droit
de nous poser des questions sur le fait que nous laissions agir ces
psychopathes en toute impunité. Nous pouvons aussi nous demander
pourquoi prolifèrent-ils ainsi au sein de certaines organisations et en
particulier les institutions d’États. Nous pouvons même pousser la
réflexion jusqu’à nous interroger sur notre responsabilité dans
l’apparition de ce phénomène et il semblerait même que ce soit par là
qu’il faille commencer, car quelle que soit l’organisation future
envisagée, le problème psychopathique leur survivra et menacera toujours
d’une façon ou d’une autre toute structure qui sera mise en place.
Gardons toujours à l’esprit que ces
personnalités sont de véritables caméléons et que tant que nous n’aurons
pas éradiqué la cause des causes de ce fléau qui puise sa source dans
les maltraitances infantiles et les traumatismes transgénérationnels, le
problème du narcissisme pathologique ne sera pas réglé et son
incessante lutte pour le pouvoir perdurera quelle que soit la forme de
société qui émergera.
Il est donc primordial, que dis-je… il est donc fondamentalement vital, de se pencher sur cette cause des causes, car comme le disait Nelson Mandela : « Il ne peut y avoir plus vive révélation de l’âme d’une société que la manière dont elle traite ses enfants » et nous vivons justement dans une société qui a bel et bien perdu son âme.
Ainsi, et pour répondre à la question
soulevée par le titre de cet article, s’il est très difficile de parler
de complicité, car d’une certaine manière ce terme – pris au sens
juridique – est en opposition avec celui de crédulité qu’évoque Paul
Valery, nous pouvons parler de manque de responsabilité ou
d’autonomisation – qu’il faut probablement cherché dans une certaine
peur de la liberté – dans la façon dont nous éduquons et instruisons nos
enfants. C’est-à-dire que non content de mal investir sur notre avenir,
nous le détruisons inconsciemment en le contraignant.
Philippe Vergnes
[1] « Cette affaire » fait référence à la crise de 2008 et aux politiques d’austérité qui depuis plombent notre économie.
[2] Rapport d’audition publique de la Haute Autorité de Santé Prise en charge de la psychopathie, p. 169.
[3] Cf. théorie de l’attachement de John Bowlby.
[4] Alberto Eiguer, « La perversion narcissique un concept en évolution » , in L’information psychiatrique Vol. 84, n° 3, mars 2008.
[5] Manfred Ket de Vries, Leaders, fous et imposteurs, éditions ESKA, 1995, pp. 106-107.
[6] Ibidem, p. 123.
[7] Ibidem, p. 44.
[8] Gérard Ouimet, Psychologie des leaders narcissiques organisationnels, p. 88.
[9] Ibidem, p. 88.
La ponérologie politique : étude de la genèse du mal appliqué à des fins politiques – l’énigme de la servitude volontaire (2/3)
« Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien » (Edmund Burke, 1729-1797)
« Le monde ne sera pas détruit par ceux
qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »
(Albert Einstein, 1879-1955)
« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants, mais l’indifférence des bons. » (Martin Luther King, 1929-1968)
« Il a toujours existé, dans toutes les
sociétés, sur cette Terre des gens atteints de déviances psychologiques.
Leur style de vie inclut une forme de prédation sur la créativité
économique de la société, parce que leur propre créativité est en
général en dessous de la moyenne. Quiconque se branche sur ce système de
parasitisme organisé perd graduellement toute capacité de travail
légal. » (Andrzej Lobaczewski, 2006, La ponérologie politique : Étude de la genèse du mal, appliqué à des fins politiques, p. 298)
Préambule :
Cet article a été rédigé à la suite d’un premier billet exposant le concept de ponérologie,
d’Andrzej Lobaczewski, publié en décembre 2015. Plusieurs événements
m’ont fait retarder sa parution (l’urgence écologique actuelle
nécessitant l’écriture d’un livre et la préparation de plusieurs suites
tant sont nombreux ceux qui ont encore du mal à comprendre la folie du
système dans lequel nous baignons). L’intervention récente de Rama Yade sur le cas d’Emmanuel Macron et la diffusion d’une vidéo le concernant
m’ont rappelé la nécessité de développer ce sujet pour tous ceux, de
plus en plus nombreux, qui souhaitent s’informer sur les raisons de la
déliquescence de nos sociétés. Souvenons-nous aussi que N. Sarkozy avait
fait l’objet d’une évaluation « empirique »
qui pourrait correspondre à de nombreux responsables politiques
nationaux (à commencer par MLP à la vue de sa prestation lors de son
« combat » contre EM si l’on s’en réfère aux définitions de ce dernier
lien). Aussi serait-il plus que temps de mener une réflexion de fond
concernant les questions légitimes que nous devrions tous nous poser en
tant que citoyen sur le fait que notre système tend à nous faire élire
(choisir) des personnalités que l’on pourrait diagnostiquer
« psychopathes » ou « perverses narcissiques » (cf. G. W. Bush, N.
Sarkozy, D. Trump, etc.) et qui interrogent sur la capacité de notre
société à favoriser la conquête du pouvoir par ce type d’individus.
Les quelques citations en introduction de
cet article ont le mérite de poser différemment le problème du mal.
Elles nous invitent à une autoanalyse et à une réflexion sur notre
propre part de responsabilité dans la genèse du mal macrosocial qui
jalonne notre histoire humaine. (Pour peu que nous ayons conservé notre
capacité à nous remettre en question.) Mais que sait-on au juste des
motivations qui incitent les gens au silence et les poussent à n’être
que des observateurs passifs de la dégénérescence de notre société,
voire de la « banalisation du mal » qui s’y développe ? Comment
comprendre les mécanismes psychiques qui sous-tendent la passivité de la
grande majorité de la population face aux nombreuses décisions absurdes[1] que prennent nos dirigeants, car comme le souligne André Sirota,
chercheur en psychologie sociale : « On échappe difficilement à la
prison de l’histoire collective quand celle-ci sédimente les haines
absurdes de plusieurs systèmes et cultures publiques et politiques,
excitées par de grands délirants pervers qui sont pourtant portés puis
laissés au pouvoir[2]. »
Si, in fine, se pose la question
de savoir quels sont donc les ressorts psychiques sur lesquels jouent
ces « délirants pervers » pour « sédimenter les haines absurdes », nous
devons également étudier les sources de notre passivité et les logiques
qui la gouvernent.
C’est ce que nous allons tenter de faire
dans ce billet en abordant « l’énigme de la servitude volontaire » de
façon quelque peu éclectique. Ce procédé pourrait passer pour
« transgressif » aux yeux des « fans » d’Andrzej Lobaczewski, inventeur
du concept de « ponérologie », mais cela serait « négliger » le fait que
pour lui : « Le meilleur conseil que puisse donner le ponérologue à cet
égard [c.-à-d. l’interprétation correcte des signes
précurseurs de la pathocratie] est que la société s’appuie sur les
sciences modernes en tirant les leçons de la dernière grande poussée
d’hystérie en Europe[3]. »
Pour cet exposé, nous ne devons pas perdre de vue l’agencement pyramidal de la psychopathogenèse du mal tel qu’évoqué lors de la première partie de cette série d’articles, à savoir, qu’à partir de l’unité de base de l’évolution sociale – c.-à-d. l’individu –, le mal se structure et se propage hiérarchiquement sous l’influence directe et indirecte – selon le niveau d’organisation atteint – de dirigeants dont les motions pulsionnelles intrinsèques peuvent être diagnostiquées comme étant de nature perverse ou paranoïaque.
Ce constat, pourtant posé par de nombreux chercheurs en sciences
humaines, est encore loin de s’être imposé à la conscience populaire.
Or, ce premier diagnostic n’est que l’étape la plus facile à franchir
dans l’étude et l’analyse du mal macrosocial tel qu’il s’impose à nous
de façon visible désormais.
Précédemment, nous avons vu qu’Étienne de
la Boétie identifiait le pire des trois tyrans – dont il peignait les
différents portraits –, comme étant l’élu, dès lors que ce dernier se
laissait gagner par un « je ne sais quoi qu’on appelle grandeur ». Un
sentiment que l’on peut rapprocher de celui que la psychanalyse a depuis
désigné sous l’appellation de « toute-puissance narcissique ».
Cependant, E. de la Boétie, qui a très bien perçu l’organisation
pyramidale du mal macrosocial, en est stupéfait à tel point qu’il
cherche à la nommer sans y parvenir : « Mais, ô grand Dieu, qu’est donc
cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice
horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais
servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens,
ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? »
Mais ce qu’il y a de remarquable dans les
écrits de la Boétie, c’est qu’après ce premier constat et ses
interrogations, il décrit parfaitement bien le fonctionnement de cette
pyramide infernale générant le mal macrosocial : « J’en arrive
maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la
domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui
penserait que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les
tyrans, se tromperait fort. Ils s’en servent, je crois, par forme et
pour épouvantail, plus qu’ils ne s’y fient. Les archers barrent l’entrée
des palais aux malhabiles qui n’ont aucun moyen de nuire, non aux
audacieux bien armés. On voit aisément que, parmi les empereurs romains,
moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de
leurs archers qu’il n’y en eut de tués par ces archers mêmes. Ce ne sont
pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de fantassins, ce ne
sont pas les armes qui défendent un tyran, mais toujours (on aura peine à
le croire d’abord, quoique ce soit l’exacte vérité) quatre ou cinq
hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. Il en a
toujours été ainsi : cinq ou six ont eu l’oreille du tyran et s’en sont
approchés d’eux-mêmes, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les
complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les
maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines. Ces six
dressent si bien leur chef qu’il en devient méchant envers la société,
non seulement de sa propre méchanceté mais encore des leurs. Ces six en
ont sous eux six cents, qu’ils corrompent autant qu’ils ont corrompu le
tyran. Ces six cents en tiennent sous leur dépendance six mille, qu’ils
élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces
ou le maniement des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par
leur cruauté, afin qu’ils les exercent à point nommé et fassent
d’ailleurs tant de mal qu’ils ne puissent se maintenir que sous leur
ombre, qu’ils ne puissent s’exempter des lois et des peines que grâce à
leur protection. Grande est la série de ceux qui les suivent. Et qui
voudra en dévider le fil verra que, non pas six mille, mais cent mille
et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les
soude et les attache à lui, comme Homère le fait dire à Jupiter qui se
targue, en tirant une telle chaîne, d’amener à lui tous les dieux. De là
venait l’accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César,
l’établissement de nouvelles fonctions, l’institution de nouveaux
offices, non certes pour réorganiser la justice, mais pour donner de
nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et les faveurs
qu’on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu’ils se trouvent
presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux
auxquels la liberté plairait. »
On reste admiratif devant la lucidité
d’un jeune homme de 18 ans à la date de la rédaction de cet essai et on
lui pardonnera sans peine le fait qu’il n’ait pas su nommer ce mal
macrosocial dont il dépeint si bien le fonctionnement. À sa décharge, il
faut souligner à quel point « le monde de la pathocratie, le monde de
l’égotiste pathologique et de la terreur est si difficile à comprendre
pour des gens qui n’ont pas été confrontés à ce phénomène qu’ils manifestent souvent une naïveté d’enfant, même quand ils ont étudié la psychopathologie et sont psychologues de profession[4]. »
Or, du temps de cet essai écrit par la
Boétie, en 1546, notre culture ne s’était pas encore dotée du langage et
des outils conceptuels qui nous permettent aujourd’hui une meilleure
compréhension de ces phénomènes que cet auteur avait déjà repérés avec
une acuité toute particulière dans l’histoire de la philosophie. Ce
n’est toutefois qu’au cours du XXe siècle que le développement des
sciences humaines nous a permis d’envisager la question du mal selon des
conceptions autres que celles qui existaient déjà d’un point de vue
mythologique, théologique ou philosophique.
Citons, pour mémoire, quelques-unes des
expériences qui, tout au long du siècle dernier, ont apporté quelques
éléments de compréhension à la problématique du mal et notre incapacité à
le juguler :
- La célèbre expérience de Milgram ou l’étude de la soumission à l’autorité réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram.
- La troisième vague est une étude expérimentale du fascisme réalisée en 1967 par Ron Jones, professeur d’histoire au lycée Cubberley à Palo Alto. « N’arrivant pas à expliquer à ses élèves comment les citoyens allemands avaient pu laisser sans réagir le parti nazi procéder au génocide de populations entières, Ron Jones décida d’organiser une mise en situation. Il fonda un mouvement nommé « la troisième vague », dont l’idéologie vantait les mérites de la discipline et de l’esprit de corps, et qui visait à la destruction de la démocratie, considérée comme un mauvais régime en raison de l’accent qu’elle place sur l’individu plutôt que sur la communauté. L’expérience de la troisième vague a inspiré le livre puis le film La Vague (2008)[5]» et probablement l’expérience de Stanford.
- Cette dernière est aussi connue sous le nom d’effet Lucifer et a été menée par Philip Zimbardo en 1971.
- La théorie de l’engagement ou de la manipulation par dissonance cognitive. (Ce thème mériterait à lui seul une longue explication, car il touche de très près ce que j’ai maintes fois expliqué ici dans plusieurs articles au sujet des injonctions paradoxales qui ne sont ni plus ni moins qu’un « effort pour rendre l’autre fou». Pour faire, court, la théorie de l’engagement est une forme de torture mentale plébiscitée par l’éducation nationale qui est la première à s’étonner de l’état régressé de notre société.)
- L’inhibition de l’action et l’impuissance apprise sont deux théories développées dans les années 1970-1980, par Henri Laborit pour la première et Martin Seligman pour la seconde, qui découlent des travaux sur le conditionnement d’Ivan Pavlov.
- Etc.
Ce que révèlent en fait toutes ces expériences sociales sans jamais le dénoncer, c’est
qu’il est possible, et même extrêmement facile, de mettre quelqu’un, un
groupe, une institution, une entreprise ou une nation entière sous emprise.
Mais pour éclairer le processus de mise sous emprise, nous devons
quitter le domaine des sciences sociales pour entrer dans celui, tant
décrié de nos jours, de la psychanalyse, seule discipline à avoir étudié
ce phénomène. Encore faudrait-il toutefois préciser que les recherches
sur l’emprise émanent d’un courant psychanalytique hétérodoxe qui n’est
pas reconnu par la psychanalyse orthodoxe freudienne.
Il existe une autre discipline qui s’est
penchée sur l’emprise pour en étudier les conséquences sur ceux qui y
sont soumis, il s’agit de la psychotraumatologie : « Une personne sous
emprise lâche prise tout simplement et, dans cette chute qui peut
sembler infinie, elle est peu à peu dépouillée de sa place de sujet.
Sous l’effet de cette influence, en fonction de sa durée et de son intensité, en fonction aussi et surtout du statut de celui qui l’exerce,
elle peut céder, par bribes, par secteurs, tout ou partie des éléments
constitutifs de son identité : son corps, sa vie psychique et affective,
sa vie sociale et relationnelle, son nom, ses biens, ses valeurs, ses
références culturelles… »[6].
Outre la soumission, dont on comprendra
dès lors qu’elle ne peut en aucun être « librement consenti », ce
« lâcher-prise » face à l’emprise induit des séquelles psychosomatiques
importantes favorisant l’apparition de très nombreux troubles de santé
comme j’ai déjà pu l’exposé par ailleurs.
Pour le dire plus clairement, sortir de l’emprise, qu’exerce sur nous
un certain type de personnalité qualifié de psychopathe (d’un genre
particulier que nous connaissons mieux en France sous le nom de pervers
narcissique), revêt un caractère de santé et de salut publics qu’il
devient urgent de comprendre pour se soigner et guérir les maux de notre
société actuelle.
Ainsi, grâce à une approche
pluridisciplinaire, comprenant comment les techniques de manipulation
nous placent sous emprise et quelles sont ses conséquences sur notre
psyché et notre organisme, l’« énigme de la servitude volontaire » peut
être résolue.
Ajoutons pour conclure que la façon dont
nos dirigeants psychopathes gèrent nos sociétés entretient une « peur de
la liberté » telle que l’a très bien analysée Erich Fromm dans son
ouvrage du même titre : « Mon propos est de montrer que l’homme moderne,
dégagé des liens de la société primitive, liens qui le rassuraient et
le limitaient à la fois, n’a pas conquis son indépendance dans le sens
positif de la réalisation de son individu, c’est-à-dire de
l’épanouissement de ses facultés intellectuelles, physiques et
sensibles. Mais la liberté, qui l’a doté de l’autonomie et de la raison,
l’a également affecté d’un sentiment d’isolement qui a créé chez lui un
sentiment d’insécurité et d’impuissance. Cet isolement lui apparaît
comme insoutenable. La seule alternative pour se délivrer de ce fardeau
qu’est la liberté est alors soit de plonger dans une nouvelle servitude,
soit d’activer le développement total de sa personnalité. Bien que
cette étude soit un diagnostic plutôt qu’un pronostic – une analyse
plutôt qu’une solution –, ses conclusions sont en rapport avec les
problèmes actuels. Car la compréhension des motivations qui incitent
une partie de l’humanité à renoncer à ses droits est une arme pour ceux
qui refusent d’abdiquer face au totalitarisme[7]. »
Ce qui signifie que, si l’on établit le lien entre toutes les
expériences précitées et les apports de la psychanalyse, l’homme est
tiraillé entre deux forces qui tendent soit vers l’emprise, la
soumission et l’esclavage, soit vers la « personnation », l’autonomie et
la liberté. De notre compréhension de ces processus et de leur issue
inéluctable dépend l’avenir de l’humanité.
[2] Sirota, André et al. (2010), « Le système totalitaire : du dehors au dedans », dans Connexions n° 94, Toulouse : Érès, p. 95-112.
[3] Lobaczewski, Andrew (2006), La ponérologie politique : étude de la genèse du mal, appliqué à des fins politiques,
[4] Ibidem, p. 238.
[6] Payet, Geneviève (2008), « L’emprise psychologique », dans L’aide-mémoire en psychotraumatologie, sous la direction de Marianne Kédia et Aurore Sabouraud-Séguin, Paris : Dunod, 291 p. (p. 83).
[7] Fromm, Erich (2007), La peur de la liberté, Lyon : Parangon, 280p. (p. 9-10). Ce livre est la traduction française de Escape from Freedom, de 1941.
Libellés :
Andrew Lobaczewski,
livre,
Philippe Vergnes,
politique,
psychologie
Inscription à :
Commentaires (Atom)