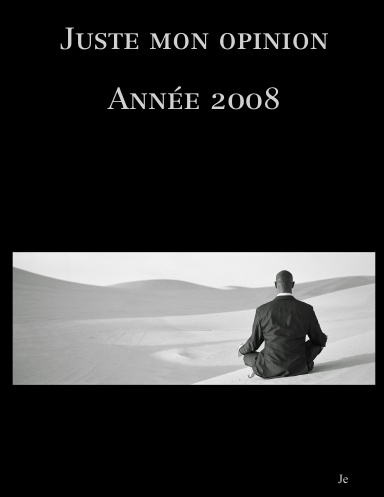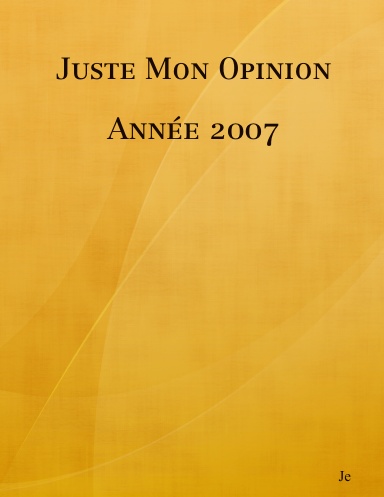“Le mal est dans la chose et le remède est violent. Il faut porter la cognée à la racine. Il faut faire connaître au peuple ses droits et l’engager à les revendiquer ; il faut lui mettre les armes à la main,
se saisir des petits tyrans qui le tiennent opprimé, renverser
l’édifice monstrueux du gouvernement et en établir un nouveau sur la
base de l’équité.”
~ Jean-Paul Marat, 1774 ~
« Marat fustigea Lafayette pour essayer de transformer la Garde Nationale en un instrument au service des riches… »
~ Clifford D. Conner, « Marat, Tribun de la révolution française » ~
Le citoyen armé : l’insoluble difficulté de 1789
Grégoire Bigot
Source :
https://juspoliticum.com/article/Le-citoyen-arme-l-insoluble-difficulte-de-1789-1431.html
“Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme ;
être armé pour défendre la liberté et l’existence de la commune patrie
est le droit de tout citoyen.”
Maximilien Robespierre[1]
Existe-t-il une problématique du citoyen armé qui nous
renseigne sur l’état de santé actuel de notre démocratie, réputée
libérale ?
La Révolution, sur ce point, et dès son avènement au printemps 1789,
est mise à l’épreuve de ses propres principes. Dans les faits, elle
n’advient qu’avec le concours de citoyens armés. En droit, elle ne
reconnaît pourtant aucun droit naturel à être armé. L’éclosion de la
démocratie est-elle consubstantielle au citoyen armé ? Bien entendu, la
France ne connaît pas à proprement parler ou stricto sensu de
démocratie en 1789. Mais en imposant, par sa Révolution, le principe du
régime représentatif fondé sur l’élection et les droits aux fondements
du politique, elle contribue bien à la naissance du principe
démocratique qui trouve sa traduction concrète dans une démocratie au
moins semi directe[2]. L’Amérique, par sa Révolution, en revanche,
impose d’emblée un régime démocratique. Là où la France pratique
jusqu’en 1792 une souveraineté nationale ambigüe, elle reconnaît
immédiatement la souveraineté populaire. Même si cette démocratie est
également semi directe – du fait du régime représentatif – elle cultive
cette différence qu’elle a tendance à considérer que, parmi les droits
naturels aux fondements du politique, figure le droit, pour les
citoyens, à porter les armes. C’est un fait connu, des déclarations
d’indépendance proclament ce droit face à l’oppresseur anglais et dans
la crainte que l’État fédéral puisse neutraliser les milices des États
du sud. Ainsi la fameuse Déclaration d’indépendance de la Virginie
de 1776, en son article 13, prévoit que le peuple soit armé pour sa
défense, l’armée en temps de paix étant jugée dangereuse pour la
liberté. Sous cette influence, Mirabeau lui-même, dans son projet de
Déclaration aux Bataves de 1788, prévoyait un article xiii ainsi
libellé : « Le peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense commune[3] ».
Enfin, en 1791, est adopté le fameux second amendement, fruit d’un
compromis entre les Républiques et l’État fédéral. Comme chacun sait, il
porte : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la
sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des
armes ne doit pas être transgressé ». D’abord conçu comme un
droit collectif, sur le fondement d’une crainte que le gouvernement
fédéral puisse désarmer le ou les peuples, ce second amendement va
changer de sens. Au début du xxie siècle, sous l’influence de la
jurisprudence de la Cour suprême, il devient un droit individuel
d’auto-défense.
La situation en France, malgré une Révolution qui porte en elle
l’avènement des idées démocratiques, diffère assez radicalement de celle
de l’Amérique. Pour cette première raison évidente que la monarchie
française, si elle cultive les particularismes provinciaux, n’est en
rien un pays fédéral qui collectionne les républiques. Elle tend à
l’unité depuis le Moyen Âge et – du moins à en croire l’historiographie
tocquevillienne – elle s’achemine vers l’uniformité sous l’Ancien
Régime, comme en témoignerait la naissance de la fameuse monarchie dite
administrative. À la veille de sa Révolution, le maintien de l’ordre, la
sécurité et la défense du régime sont le monopole de l’État et, pour
l’essentiel, de l’armée. Par ailleurs, dans une société anciennement
constituée, inégalitaire par principe (tripartition sociale), où le
sujet n’est pas encore citoyen, le port des armes est pour l’essentiel
un privilège octroyé. Il est réservé à la noblesse, y compris pour ce
qui concerne le droit de chasse depuis le xvie siècle. Les milices, si
elles ont pu exister pour la défense des villes au Moyen Âge, semblent
être tombées en désuétude à la veille de la Révolution.
Avant 1789, le sujet qui porte les armes contre l’ordre établi est un
rebelle ou un hors la loi qui subira la foudre des tribunaux ou de la
raison d’État (les guerres dites de religion en administrent la preuve).
À partir de quel moment devient-il légitime sinon comme citoyen ? On
entend par là que les individus armés contre le pouvoir doivent
nécessairement vaincre le régime contre lequel ils se dressent. C’est le
propre de toute Révolution dont les exemples américains puis français
témoignent : on ne triomphe que par les armes. On peut même dire que la
violence armée est la condition d’une Révolution réussie. La Révolution
française et ses citoyens armés est ainsi glorifiée parce que sa
légitimité est dans son résultat : elle vainc le « despotisme ». On
délivrera des diplômes au assaillants supposés de la Bastille et on
célèbrera comme un héros le citoyen qui a décapité son gouverneur,
Launay. En cas d’échec, on aurait voué aux gémonies de simples révoltés.
L’histoire a en horreur les vaincus, fussent-ils des citoyens. Les
révoltés de juin 1848 et les communards de 1871 seront de la racaille
socialiste qu’on fusille sur place dès lors qu’ils sont pris,
précisément, les armes à la main. Il existe ainsi toute une gradation au
citoyen armé dont seul le stade ultime assure qu’il soit légitime à
porter les armes. Sont ainsi illégitimes les émeutes, les révoltes, les
insurrections. Est légitime, en revanche, la Révolution. Pourquoi
énoncer de telles banalités ? Pour insister sur ce point que le thème du
citoyen armé, avant que de trouver une traduction politique (le sujet
qui devient citoyen) ou juridique (le droit à être armé), est d’abord,
de façon banale, une question de faits, de circonstances, voire de
hasards. En cela le citoyen armé met à l’épreuve la Révolution
française. Pétrie de principes et d’abstractions philosophiques, elle
doit pourtant beaucoup aux circonstances et aux faits. Pire : elle se
heurte à ces circonstances et aux faits de citoyens armés dont elle ne
réclamait pas qu’ils jouassent un rôle décisif dans le cours des
évènements et ce, dès l’été 1789.
C’est cette mise sous tension des idéaux révolutionnaires par leur
confrontation aux faits dont on voudrait ici retracer la trajectoire.
Durant la période très courte de la Constituante, les citoyens sont
légitimes dans les faits à être armés dès lors qu’ils font triompher la
révolution de la souveraineté nationale (I). Ils deviennent illégitimes
dès lors que la violence de leurs armes tend à contrarier cette
révolution bourgeoise au profit d’une révolution qui tendrait à la
souveraineté du peuple : la création de la Garde nationale et les
évènements tragiques du Champs de mars en juillet 1791 en
témoigneront (II).
I. Le citoyen armé assure le triomphe de la Révolution
La légitimité du citoyen armé est une pure question de faits (A) à
laquelle l’Assemblée constituante ne peut ni ne veut répondre dans les
premiers mois de la Révolution dans la mesure où ses idéaux
constitutionnels s’en trouvent contrariés (B).
A. L’évidence des faits, ou comment le citoyen armé consolide la Révolution bourgeoise
La Révolution pacifique et essentiellement bourgeoise qui voit
triompher les députés entre les 17 et 23 juin témoigne dans un premier
temps de l’aversion de tous, à Versailles, pour le recours à la violence
armée. À supposer que l’État monarchique ait existé, il se signale à
cette occasion par son immense faiblesse ; encore quelques semaines et
il s’effondre et s’efface dans tout le royaume.
« Cette journée du 17 nous a fait cheminer en avant de deux siècles »
aurait dit Sieyès[4]. Ce décret est en effet toute la Révolution : il
conserve intacte la souveraineté et ses attributs mais en transfère la
titulature depuis le corps physique du Roi vers cette abstraction qu’est
la Nation (représentée par les députés du Tiers suivant les idées même
que Sieyès avait développées dans son pamphlet de janvier 1789, Qu’est-ce que le Tiers-État ?).
La suite est connue : le Roi ne veut pas décider, la cour est divisée.
Face au coup d’État de papier du 17 juin, la réaction va être trop
faible pour vaincre. Elle va même avoir pour résultat d’inciter les
députés à la surenchère. Interdits de réunion aux Menus-Plaisirs le 20
juin, que le Roi a fait fermer en vue d’organiser la séance royale
du 23, les députés trouvent refuge dans une salle de sport, sans
qu’aucun garde ou qu’aucune présence militaire ne leur en interdise
l’accès. Les députés, qui craignent qu’on les arrête ou qu’on les
renvoie dans leurs provinces, s’octroient donc dans l’urgence des
pouvoirs supplémentaires. Par le serment du Jeu de Paume, l’Assemblée se
déclare constituante, permanente et indivisible. « Qu’on ne s’y trompe
pas » écrit méchamment Emmanuel de Waresquiel. « Le serment du 20 juin
n’aurait jamais existé si les députés qui l’ont prêté n’avaient été pris
d’un sentiment irraisonné de frousse universelle[5] ». Le 23 juin, le
roi va boire la coupe jusqu’à la lie. Son discours est autoritaire mais
il n’est suivi d’aucune manifestation concrète de son autorité. Le
fameux « Nous ne quitterons nos places que par la force des
baïonnettes » – qui est très probablement apocryphe – témoigne de
l’aversion de Louis xvi pour le recours à la force armée, y compris pour
la défense de sa souveraineté. Il consent au contraire à abdiquer pour
partie cette souveraineté puisqu’il reconnaît l’existence et, partant,
la légitimité de l’Assemblée nationale quelques jours plus tard. La
Révolution des juristes, feutrée, versaillaise, ne va devoir pourtant
son succès définitif qu’à l’irruption sur la scène politique des
citoyens armée, exerçant la violence populaire.
Cette violence armée est connue à travers trois évènements majeurs.
Le premier est évidemment la prise du fort de la Bastille le 14
juillet. Ce qui se trame dans les jours qui précèdent nous intéresse
ici. Paris est en proie à l’émeute – prémisse de la « Révolution
municipale » qui va gagner tout le royaume – du fait des nouvelles
alarmantes dont la capitale prend connaissance. La population est
inquiète des évènements versaillais. Ils lui font perdre ses repères par
rapport à un pouvoir politique qu’on croyait immuable autant que
potentiellement oppresseur des petites gens. En témoignerait le renvoi
de Necker – remplacé par le très réactionnaire baron de Breteuil – et la
mobilisation concomitante de régiments de l’armée royale aux abords de
Paris et de Versailles. Les faits sont connus : la population pille et
cherche des armes pour sa défense. Mirabeau, qui sait que l’Assemblée ne
peut vaincre à elle seule le Roi, met de l’huile sur le feu par ses
discours alarmistes[6]. Il incite indirectement le peuple à prendre les
armes en vue, pour l’essentiel, de sauver la représentation nationale.
Le paradoxe est que, en vouant aux gémonies l’armée, Mirabeau rend quasi
impossible le maintien de l’ordre, prérogative du Roi et de son armée.
Or la Constituante, depuis début juillet, est très inquiète des
violences parisiennes dont elle ne maîtrise le cours et qui menacent de
la déborder. Doit-elle s’approprier les prérogatives du pouvoir exécutif
dont elle se défie pour contenir « l’anarchie » et « les fureurs de la
populace[7] » ? De ce dilemme, nous le verrons, naîtra le compromis de
la Garde nationale. Pour l’heure les digues qui pouvaient contenir la
violence populaire sont rompues ou tout simplement n’existent pas. Le 13
juillet, un courrier du commandant de Paris est porté à la connaissance
des députés : « […] la foule est immense au Palais-Royal, plus de dix
mille hommes sont armés. […] toutes les barrières […] sont saccagées
[…]. Les armuriers ont été pillés. […] Ils vont ouvrir toutes les
prisons[8] ».
Le 14 juillet est une divine surprise dont la Constituante se saisit
aussitôt : les citoyens armés, dont on se défie par ailleurs tant,
assurent le triomphe des députés sur le roi. Il rappelle Necker et
annonce le retrait de ses troupes. En outre il franchit un cap dans son
humiliation lorsqu’il décide son transport à Paris, où il reçoit la
cocarde des mains de Bailly, député devenu précipitamment maire, pour
tenter de concilier l’abstrait de la souveraineté nationale avec le
concret des parisiens armés. Mais par leur présence conjointe au balcon
de l’hôtel de ville, et Bailly et Louis xvi viennent de légitimer la
violence des citoyens armés.
Une logique similaire est à l’œuvre avec ce que l’on nomme
d’ordinaire La grande peur. Cette fois ce sont les citoyens des
campagnes qui, dans la seconde quinzaine de juillet, prennent les armes
et exercent une violence spontanée contre les propriétés seigneuriales.
La Constituante aurait volontiers fait l’économie de cette seconde
difficulté qu’elle subit. Elle va pourtant savoir en tirer parti et
profit. Elle en tire parti dans la mesure où c’est l’occasion de
répondre à une revendication forte des cahiers de doléances : les droits
féodaux, réactualisés au xviiie siècle, étaient devenus insupportables à
la population des campagnes. En outre la propriété féodale, qui
consacre une propriété simultanée de plusieurs personnes sur un même
bien, est contraire aux idéaux de nombre de députés, rompus aux théories
de la physiocratie et de l’avènement souhaité de la propriété
exclusive. N’est-ce pas en quelque sorte une aubaine que ces paysans
armés qui manifestent leur violence contre les symboles de la propriété
féodale (ils brûlent châteaux mais surtout terriers) ? Cette prise de
conscience est celle qui guide la fameuse abolition des privilèges de la
nuit du 4 août, ou plus précisément son décret voté quelques jours plus
tard. Dans un premier temps, on le sait, la Constituante panique
elle-même. Elle débat de l’éventualité d’un recours à la force contre la
paysannerie armée tant son attachement à la propriété est quasi
viscéral dans le cadre d’un suffrage que l’on ne peut imaginer autrement
que censitaire (et la propriété, quand bien même féodale, est
propriété). Le décret d’application à l’abolition des privilèges profite
donc à la Constituante : la propriété féodale va être éteinte, mais par
rachat. Elle accroît sa légitimité – c’était une demande des électeurs
ruraux – mais en profite pour asseoir le principe de la propriété
– devenue exclusive – qu’elle va bientôt ériger en droit naturel. Les
armes paysannes profitent à l’idéologie propriétariste.
Les 5-6 octobre 1789 sont pour les députés mais, surtout, à travers
eux, pour la représentation, nationale, une expérience beaucoup plus
douloureuse que le 14 juillet ou le 4 août. Pour la première fois, les
députés sont en présence du peuple d’une part, du peuple armé d’autre
part. Leur légitimité ne peut que vaciller. Cette fois ni parti ni
profit : ils vont subir (notamment leur transfert à Paris). Pourtant,
dans un premier temps, la marche des femmes armées leur profite. Car oui
il s’agit de femmes – sont-elles seulement citoyennes ? – et
l’historiographie nous les présente comme armées. Des hommes s’efforcent
d’ailleurs de les désarmer. D’abord un nommé Marchand qui, au moment où
elles décident de s’ébranler sur Versailles, leur aurait précisément
confisqué leurs armes[9]. Ensuite La Fayette est sollicité, et à travers
lui la citoyenneté armée légitime ; la Garde nationale qu’il dirige
depuis le 17 juillet accompagne mais surtout encadre ces dames venues
chercher par la force « le boulanger, la boulangère et le petit
mitron ». Qu’on s’imagine la scène : le 5 octobre au soir, pour la
première fois, les députés voient le peuple. C’est pourtant le roi qui
cède. Il accepte le soir même et l’abolition des privilèges et la
Déclaration des droits du 26 août. Une nouvelle fois la citoyenneté
armée a arbitré le conflit insoluble qui opposait la représentation
nationale à Louis xvi. Elle franchit néanmoins un cap en contraignant la
représentation nationale – députés et Roi – à venir exercer ses
fonctions au sein de la capitale victorieuse. La nation, abstraite, qui
parle au nom du peuple sans être tout à fait le peuple, va devoir vivre
et agir au milieu du peuple.
B. L’impossible transcription juridico-politique d’un droit potentiellement naturel
La violence armée des parisiens, c’est un fait connu, accélère
l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou du
moins en infléchit le contenu. Les premiers débats sur la Déclaration en
tant que telle ont lieu le 13 juillet. Comme l’écrit
Jean-Clément Martin, « la coïncidence des dates fait sens […]. Les
projets des modérés, comme celui de Mounier qui inscrivait la
Déclaration dans un ensemble nécessitant une longue procédure, sont
discrédités de facto par la prise de la Bastille et le reclassement
politique qui s’ensuit[10] ». L’abolition des privilèges, pour lâcher du
lest face au peuple rural armé, accentue encore les choses. Il n’y aura
pas de déclaration des devoirs et la Déclaration doit être rédigée
avant toute Constitution. Il en résulte une radicalité des droits, posés
au fondement du politique, et qui fait l’actualité de 1789 dans ce que
nous appelons aujourd’hui la démocratie des droits. Influencée par la
violence d’un ou plusieurs peuples en armes, la Déclaration ne va
pourtant faire aucune concession à la violence populaire. Le
pouvait-elle seulement ?
Les silences pudiques de la Déclaration au sujet d’une éventuelle
liberté (individuelle ou collective) d’être armé s’éclairent ou
s’expliquent au regard de circonstances imprévues qui contredisent des
idées ou des idéaux. Devait-on céder aux individus ou au peuple un droit
à l’insurrection ? Le fait des citoyens en armes met en effet sous
tension tous les principes théoriques du contractualisme social, qu’ils
soient philosophiques, politiques ou même simplement juridiques. Il ne
s’agit évidemment pas ici de minimiser ou de relativiser la portée de la
Déclaration qui est en quelque sorte toute la Révolution puisqu’elle
assène les principes constitutionnels nouveaux et pose la fondamentalité
des droits. Il s’agit seulement de la replacer dans son contexte, qui
est celui de l’urgence politique et sociale. On sait que les députés,
par les orientations constitutionnelles qu’ils proposent le 26 août,
entérinent le coup d’État du 17 juin. La souveraineté ne sera bien
qu’abstraite et nationale à leur profit. Façon de discréditer le roi
s’il « n’en émane expressément » (cf. art. 3). Façon, aussi, de
témoigner qu’aucune concession ne sera faite à la souveraineté populaire
dont les députés se défient tous. Quant aux droits déclarés, ils posent
des difficultés insurmontables. Elles sont de trois ordre.
C’est d’abord la tension du naturel et du civil. Le droit naturel qui
triomphe dans la Déclaration n’a rien à voir avec la nature en quelque
sorte naturelle. C’est une posture ou, plus exactement, un postulat
philosophique. Sur la foi de la seule raison – comme en témoigne le
projet de Déclaration de l’abbé Sieyès des 20-21 juillet 1789 – est
naturel ce qui est anhistorique[11]. Conformément à l’idéal d’une
régénération sur le seul fondement des idées, on répudie l’autorité de
l’histoire et, partant, l’ancienne société organisée. Le rapport
présenté par Mounier le 9 juillet, et qui visait à encadrer les droits
naturels par des devoirs et qui, surtout, les inscrivait dans l’histoire
monarchique, est devenu inaudible[12]. Nul doute ici que la
radicalisation des idées n’est pas sans rapport avec ce qui s’est passé à
Paris le 14 juillet.
C’est ensuite et de façon concomitante la mise sous tension de
l’individuel et du social. Forment-ils un tout indissociable ? Il existe
un certain paradoxe à vouloir poser des droits individuels au fondement
du politique tout en les insérant dans une « société ». Est-elle
autonome, indépendante en quelque sorte des individus qui la composent ?
À s’en tenir à l’article 2 (« Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme »)
de la Déclaration, l’antinomie n’existe pas encore entre l’individuel et
le social dans la mesure où l’on y récite le b-a ba du contractualisme
précisément social : la société doit se comprendre comme l’association
des citoyens ; cette société politique ne peut dès lors avoir pour objet
que la défense des droits naturels de ceux qui la composent[13].
Seulement, comme on vient de l’indiquer, ce contractualisme scelle
précisément le passage du droit naturel au droit civil et/ou social. Le
naturel des droits peut donc rencontrer la limite d’une société civile à
préserver. La loi elle-même – expression de la volonté générale – est
conditionnée par cet impératif d’une « société » à sauver et dont on
peut se demander si elle n’est que le pacte associatif de l’article 2 au
regard des troubles graves qui agitent le royaume en cet été 1789.
Comme l’exprime l’article 5, dans sa définition en creux de la liberté,
« [l]a loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société ».
C’est enfin, et par voie de conséquence, la mise sous tension de la
liberté en rapport avec sa sécurité. Deux droits naturels – au terme du
texte définitif du 26 août – dont l’articulation devait être à tout le
moins interrogée si les Constituants avaient pris en considération le
fait de citoyens qui s’arment pour la défense de leur liberté. Or la
garantie des droits n’est pas aux mains de ceux à qui on la promet. Sans
débattre un seul instant d’un éventuel droit à l’auto-défense de la
liberté par chacun, les Constituants placent la garantie des droits dans
une « force publique » dont ils annoncent par là-même l’urgence de sa
création. Comme l’exprime en effet l’article 12 : « La garantie des
droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ». Cette
force ne saurait être l’armée. Les Constituants se méfient depuis le
printemps 1789 de la force armée qui reste théoriquement entre les mains
du roi. Sieyès, notamment, était formel sur ce point dans son projet de
Déclaration : les militaires ne doivent être déployés qu’à l’extérieur
des frontières, à défaut de quoi ils menaceraient la liberté[14]. Cette
force publique restant pour l’essentiel à créer, peut-elle être le fait
des citoyens armés ? La réponse est implicitement négative. La suite de
l’article 12 nous indique qu’elle ne sera confiée qu’à quelques-uns :
« cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour
l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ». Le monopole du
recours à la violence légitime ne saurait être celui de tous les
citoyens, pris individuellement ou en groupes.
Quant à la « résistance à l’oppression », droit réputé naturel
au terme de l’article 2 de la Déclaration, elle appelle deux remarques.
Premièrement elle ne doit pas être comprise comme un droit ou une
licence, pour les citoyens, de se dresser contre le pouvoir par la
violence. Elle ne s’entend que comme d’un droit à ne pas obéir à un
ordre illégal (dans la mesure où celui qui résiste à la loi est coupable
à l’instant). Elle diffère radicalement de ce que sera le « devoir
d’insurrection » dans la Constitution jacobine de 1793 qui, lui,
supposera l’obligation, pour les citoyens, de s’opposer au pouvoir par
la force armée. Deuxièmement les modalités de cette résistance à
l’oppression ont en effet été édulcorées par le texte définitif au
regard de certains projets de déclaration. Par crainte probablement que
les citoyens comprennent la Déclaration comme une autorisation d’avoir
recours à la violence. Dans le projet de Sieyès des 20-21 juillet,
il était ainsi prévu (art. xxii) que, contre un ordre illégal ou
arbitraire (par principe illégitime et coupable), les citoyens « ont le
droit de repousser la violence par de la violence[15] ».
En elle-même, la Déclaration est désarmante en ce qu’elle désarme les
citoyens. Qu’en est-il des modalités concrètes d’une telle opération,
politiquement délicate ?
II. Le citoyen armé menace la Révolution
Les citoyens armés ne sont-ils que les idiots utiles de la Révolution ? Alors qu’ils assurent concrètement la victoire des députés sur le roi, le
pouvoir cherche avant tout à ce qu’ils rendent les armes ou qu’ils ne
puissent les porter que dans des conditions que la loi autorise : c’est
ici qu’intervient le compromis de la création de la Garde nationale qui
dresse des citoyens dits « actifs » contre le reste du peuple (A).
Par ailleurs les révolutionnaires décrètent l’urgence de doter la nation
d’une administration uniforme dans la mesure où on lui attribuera le
monopole de la violence légitime. Il n’y a de droit à la défense que
municipalisé : les maires, agents du pouvoir, héritent dès l’automne
1789 du soin – dans la plus pure tradition de l’Ancien Régime – de
policer une société potentiellement dangereuse (B).
A. De la milice bourgeoise à la Garde nationale : les citoyens actifs contre le peuple
Tout se joue ici aux alentours du 14 juillet, dans un formidable jeu
de dupes entre les parisiens spontanément armés et ceux qui, sensés
pourtant les représenter, font tout pour canaliser et/ou contrôler leur
violence.
Les émeutes à Paris inquiètent. Il faut à la fois se prémunir de la
violence populaire et à la fois de l’éventuelle contre-révolution royale
accréditée notamment par la présence de l’armée aux portes de la
capitale. Le 13 juillet, une « pétition des électeurs de la ville de
Paris » est adressée et lue à la Constituante par Guillotin. Elle
« supplie l’Assemblée nationale de concourir […] à établir une milice
bourgeoise[16] ». Comme personne ne semble capable d’exercer la police
du maintien de l’ordre dans Paris, les députés répondent favorablement
et décident dans l’urgence « de confier la garde de la ville à la milice
bourgeoise » dont ils décrètent la création (ou la recréation). Elle
doit, bien entendu, « contribuer au retour de la tranquillité[17] ».
Les électeurs du Tiers-État parisiens, ainsi adoubés et légitimés par
la représentation nationale, vont asseoir leur pouvoir sur la capitale.
Ils concrétisent par deux arrêtés du 13 juillet l’organisation de la
milice bourgeoise. Tout commence, avec le premier arrêté, par la
constitution d’une nouvelle autorité administrative : à l’hôtel de ville
de Paris prend place un « comité permanent », essentiellement composé
des électeurs du Tiers. Il fait figure d’autorité centrale puisqu’il est
chargé de correspondre avec les districts en vue de constituer au plus
vite la milice. Les citoyens, dit l’article 5 de cet arrêté, « seront
réunis en corps de la milice parisienne, pour veiller à la sûreté
publique, suivant les instructions qui seront données à cet effet par le
comité permanent[18] ». Le second arrêté, rédigé par le comité
permanent, met en place une milice suivant un dispositif pyramidal et
hiérarchique, proche du modèle militaire. Le comité dirige le tout.
Cette subordination de la milice à un corps administratif est
annonciatrice du fait que la Révolution entendra toujours faire du
maintien de l’ordre une prérogative exclusive des institutions
publiques. Il ne saurait exister de milices en dehors des cadres de
l’administration. Le comité permanent nomme en effet les officiers
généraux au sommet : un commandant-général, un commandant général en
second, un major général et un aide-major général. Décomposée en
légions, en bataillons puis en compagnies, la milice parisienne devait
selon toute vraisemblance rassembler un effectif de 48 000 citoyens.
Afin qu’on les distingue du reste de la population, l’arrêté précise que
« chaque membre qui compose cette milice parisienne portera les
couleurs de la ville », à savoir « la cocarde bleue et rouge ».
Chargée de rétablir l’ordre public et notamment de désarmer les
« séditieux », cette milice non seulement ne rétablit rien mais elle
participe au contraire au désordre des émeutes. Lors de la prise de la
Bastille, une partie de la milice a pris fait et cause pour
l’insurrection. Mais elle a gagné en prestige et en légitimité
d’exercice : la milice a triomphé avec le peuple du « despotisme ». En
témoigne, on l’a dit, la réaction de Louis xvi, qui lui-même adoube la
violence armée du 14 juillet. Les députés, soucieux de garder
politiquement la main, envoient immédiatement, dès le 16 juillet, une
importante « délégation », dont La Fayette et Bailly. D’après les
Archives Parlementaires, les élus rencontrent sur leur passage plus
de 100 000 citoyens armés « rangés en haie ». Avec une rapidité de
décision qui lui est propre, Louis xvi « autoris[e] le rétablissement de
la milice bourgeoise », et, dans l’enthousiasme d’une foule en liesse,
le marquis de La Fayette est bombardé « général de la milice
parisienne ». On lui fait prêter serment de fidélité « à la nation, au
roi et à la commune de Paris ». La Fayette décide alors de renommer la
milice bourgeoise : elle devient « Garde nationale de Paris » (et sa
cocarde devient tricolore). Comme on peut le lire aux Archives
Parlementaires, « Paris va jouir des douceurs de la paix. La milice
bourgeoise préviendra tous les désordres ; elle sera commandée par un
héros dont le nom est cher à la liberté dans les deux mondes[19] ».
Les députés contrôlent-ils pour autant les gardes nationales ? En
effet, dans le cadre de la Révolution municipale de juillet, l’ensemble
des communes ou villes du royaume se dotent d’une garde nationale, par
imitation du modèle parisien. Ces gardes nationales sont-elles la
manifestation d’une société qui organise elle-même sa défense et la
défense des libertés ? Peut-il y avoir dans la France régénérée de 1789
un pouvoir civil indépendant de la représentation politique et/ou de
l’administration d’État ? Cette société civile ne présente-t-elle pas le
danger de vouloir dresser ses armes contre le pouvoir s’il est jugé
oppresseur ?
Alors que l’historiographie au sujet de la Révolution est
heureusement surabondante, l’historiographie au sujet des gardes
nationaux est relativement peu importante[20] ; cela donne le sentiment
que les spécialistes de la Révolution française eux-mêmes fuient les
difficultés que posent les gardes nationales en termes d’interprétation
dans les rapports que peuvent entretenir la société et l’État.
En outre cette historiographie a longtemps été divisée, comme c’est le
cas sur l’essentiel des sujets en rapport à la Révolution. On en veut
pour preuve les deux articles consacrés à la garde nationale par les
deux principaux dictionnaires de la Révolution française, publiés à
l’occasion du bicentenaire. Pour l’historiographie néo marxiste, à
savoir pour le Dictionnaire historique de la Révolution française
publié sous la direction d’Albert Soboul, la garde nationale ne saurait
être réduite à une ruse de la raison bourgeoise (celle de l’Assemblée)
pour tenter de canaliser la violence armée et spontanée du peuple. Il
est évident que pour ce faire, la notice « Garde nationale » insiste
davantage sur le moment 1792-1793 que sur le moment 1789[21]. Pour
l’historiographie qui se présente comme critique, à savoir pour le Dictionnaire critique de la Révolution française publié
sous la direction de François Furet et de Mona Ozouf, la création de la
garde nationale est au contraire comme cette ruse de la représentation
bourgeoise pour tenter d’apporter une réponse institutionnelle, en sa
faveur, au problème des citoyens armés. À l’entrée « Fédération », on
peut lire :
L’acteur central des Fédérations, c’est cette garde nationale qui a
été baptisée le 16 juillet 1789 par La Fayette. La date de l’acte de
baptême dit assez le lien avec l’émeute et avec la nécessité de la
contrôler : la députation de l’Assemblée nationale – 88 hommes dont
La Fayette et Bailly –, qui est arrivée à Paris le mercredi 15 juillet,
trouve un comité permanent, une milice bourgeoise déjà formée et une
ville pleine d’hommes en armes. Désarmer ces hommes menaçants pour
l’ordre social, mais conserver contre les troupes royales les forces
d’une armée civique, tel est le plan de La Fayette[22].
Les faits immédiats, sous la Constituante, accréditent plutôt cette seconde grille de lecture. Lorsqu’il
réorganise la Garde nationale le 31 juillet 1789, La Fayette la
restreint « aux citoyens aisés par l’obligation faite aux gardes de
payer leur armement et leur bel uniforme aux trois couleurs. La
finalité de cette création à Paris – conclut Mona Ozouf – est donc sans
ambiguïté : il s’agit de régulariser une situation
insurrectionnelle[23] ». Les gardes nationales, qui se sont constituées
sans règles claires quant à savoir qui pouvait y avoir accès, sont
reprises en main par l’Assemblée au printemps 1790, un mois avant la
fameuse Fête de la fédération, qui avait de quoi inquiéter la
Constituante dans la mesure où certaines gardes prétendent à l’autonomie
(de fédération à fédéralisme, comme le souligne Jean-Clément Martin, la
frontière est mince[24]). Par son décret du 12 juin 1790 elle met fin à
la diversité des recrutements. Conformément à la dichotomie,
essentiellement inventée par Sieyès, entre citoyens actifs et passifs,
il réserve l’accès aux gardes nationales aux seuls citoyens aisés, à
savoir les « actifs », propriétaires qui s’acquittent du cens, qui sont
tenus de s’inscrire auprès de leurs municipalités[25]. Les moins aisés
qui avaient pu s’enrôler ne sont pas rayés des cadres. On n’ose pas les
désarmer. Mais la porte leur est désormais fermée et, partant, le port
des armes, en théorie, interdit. « Quant au commandement des milices, il
continue d’aller soit à la noblesse (souvent désignée en fonction de
son expérience militaire), soit à la haute bourgeoisie des professions
libérales, de l’administration et des finances[26]. » Ce décret du 12
juin s’inscrit dans toute une série de mesures visant à prévenir les
violences des citoyens et à les réprimer. On peut ainsi citer le décret
des 2-3 juin 1790 « concernant les poursuites à exercer contre les
individus qui séduisent, trompent ou soulèvent le peuple ». Les citoyens
armés y sont qualifiés dès le préambule de « brigands » ou de
« voleurs ». Le sont-ils réellement ? On peut en douter à la lecture de
l’article 5 du décret : « Il est défendu à tout citoyen actif de porter
aucune espèce d’armes ni bâtons dans les assemblées primaires ou
électorales […]. Il est expressément défendu de porter aucune espèce
d’armes dans les églises, dans les foires, marchés et autres lieux de
rassemblement, sans préjudice des gardes chargés du maintien de la
police[27] ».
B. La violence légitime : un monopole de l’État administratif
Cette violence est même préventive. Du latin prae venire :
venir avant. Elle interdit comme ou parce qu’elle est libre d’inventer
un ou plusieurs délits qui n’ont pas encore eu lieu. C’est ce qu’on
appelle aujourd’hui la police administrative. Clémenceau la considérait
comme inavouable en démocratie (où seule la police judiciaire peut
exister). Et pour cause : elle s’inscrit dans le prolongement de la
Police d’Ancien Régime qui vise à policer une société au détriment de
droits qui préexisteraient à l’ordre politique. Avec la police
administrative, la Révolution fait une entorse à ses propres
principes[28].
Le débat houleux relatif à la création des communes, dès
l’automne 1789, s’explique en partie par cette obsession de maintenir
une police publique et quasi étatique : les troubles caractéristiques de
la révolution municipale de juillet inquiètent une majorité des députés
à la Constituante. Lorsque Thouret, au nom du second comité de
constitution, présente, le 29 septembre 1789, son rapport relatif à
l’administration régénérée du royaume, les députés sont quasi unanimes à
reconnaître l’utilité de la création des départements dans la mesure où
ils servent de circonscription électorale pour la représentation
nationale une et uniforme et parce que les institutions qui y seront
créées (conseil général et directoire de département) assureront une
exécution toute aussi uniforme de la loi souveraine. Là où le rapport
rencontre l’opposition, c’est dans sa partie relative à l’administration
communale. Thouret propose en effet de ne créer que 720 grandes
communes (elles deviendront les districts dans le projet définitif de
décembre) par subdivision des départements. Mirabeau s’insurge aussitôt
contre l’abstraction du projet ; et il le fait pour des motifs qui
tiennent aux circonstances politiques et/ou sociales immédiates des
citoyens armés. Au moment où des municipalités se constituent en dehors
de tout cadre légal, Mirabeau craint « un véritable chaos ». Le 12
novembre 1789, jour où Thouret devient président de l’Assemblée, les
députés décrètent qu’il « y aura une municipalité dans chaque ville,
bourg, paroisse ou communauté de campagne[29] ».
Même si la reconnaissance de près de 44 000 communes contrarie le
projet du comité de Constitution, la loi du 14 décembre 1789 relative
aux communes (votée avant celle relative aux départements du 22
décembre) les dote d’une administration uniforme tant du point de vue de
leur composition (conseil municipal et maire) que du point de vue de
leurs attributions. Or, sous cet angle, la loi témoigne d’une obsession
sécuritaire qui doit être remise exclusivement aux mains du maire, comme
agent de l’État, par délégation de la loi. Il est en effet prévu que
c’est « sous la surveillance et l’inspection des assemblées
administratives » (i.e. de district et de département) que le
« pouvoir municipal » doit « faire jouir les habitants des avantages
d’une bonne police, notamment de la propriété, de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics »
(article 50). Or, « [p]our l’exercice des fonctions propres ou déléguées
aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir le secours
nécessaire des gardes nationales et autre forces publiques, ainsi qu’il
sera plus amplement expliqué » (article 52). Pour l’heure, dans
l’urgence de gardes nationales qui peuvent préexister à la mise en place
des nouvelles municipalités, la loi du 14 décembre prend soin de
préciser – par souci d’une reprise en main – que « [l]e maire et les
autres membres du conseil municipal, le procureur de la commune et son
substitut ne pourront exercer en même temps les fonctions municipales et
celles de la garde nationale » (article 53)[30].
La garde nationale, qui est aussi nécessaire au maintien de l’ordre
qu’elle inspire la crainte aux élus de la nation, ne peut disposer
d’aucune autonomie : elle ne peut être requise et mise ne branle que par
les institutions administratives. Alors que les gardes
nationales sont nées plus ou moins spontanément durant l’été 1789, la
constituante entend les enrégimenter sous la tutelle de l’État, dans la
mesure où, dans la France révolutionnée, l’administration réalise
l’État. Dès le 7 janvier 1790, sur proposition de Target,
la Constituante exige ainsi que les Gardes nationaux prêtent serment
devant les autorités publiques afin, notamment, d’affermir l’autorité
des municipalités en voie de formation. Il est en effet décidé que
jusqu’à l’époque où l’Assemblée nationale aura déterminé, par ses
décrets, l’organisation définitive des milices et des gardes nationales,
les citoyens qui remplissent actuellement les fonctions d’officiers ou
de soldats dans les gardes nationales, même ceux qui se sont formés sous
la dénomination de volontaires, prêteront par provision, et aussitôt
après que les municipalités seront établies, entre les mains du maire et
des officiers municipaux, en présence de la commune assemblée, le
serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi[31].
Les gardes nationales doivent d’autant plus ne dépendre que de la
souveraineté nationale que, le 21 octobre 1789, sur proposition de
Mirabeau, les députés ont osé voter le « décret contre les
attroupements, ou loi martiale[32] ». Elle a pour origine la réaction
indignée de l’Assemblée lorsqu’elle apprend qu’à Paris, des citoyens ont
décapité d’un coup de sabre le boulanger François qu’ils accusaient de
vouloir affamer le peuple. La loi martiale « considérant que la liberté
affermit les empires, mais que la licence les détruit », dispose que
« [d]ans les cas où la tranquillité publique sera en péril, les
officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils
ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être
déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public » (article 1er). Il
est prévu que les municipalités puissent requérir « les Gardes
nationales, troupes réglées et maréchaussée » (article 2). La suite du
décret est connue : on hisse le drapeau rouge et si, après trois
sommations, « le peuple attroupé » ne se retire pas, l’usage de la force
est autorisé. Cette loi d’octobre 1789 fait l’objet, le 26
juillet 1791, d’un second décret « relatif à la réquisition et à
l’action de la force publique contre les attroupements ». Il intervient
dans le cadre de la répression menée par la Constituante contre
l’opposition politique après la fusillade du Champs de Mars. On supprime
les trois sommations qui n’avaient pas été respectées par la garde
nationale et/ou la municipalité de Paris et on durcit la définition de
l’attroupement séditieux[33]. Une nouvelle fois, il est bien précisé que
les Gardes nationales ne disposent d’aucun pouvoir propre. Elles ne
s’ébranlent que sur réquisition du procureur de la commune. Si elles
sont en nombre insuffisant, il doit en informer immédiatement le juge de
paix du canton et le procureur syndic du district afin qu’ils procèdent
à des réquisitions à l’échelon administratif où ils sont situés.
Précisément, un doute subsiste du fait des circonstances de leur
création : les gardes nationales, désormais intégrées dans la hiérarchie
des institutions administratives, et soumises à leur autorité,
doivent-elles être (ré)organisées en dehors des communes ? C’est dans le
cadre d’une législation d’ensemble relative aux forces de l’ordre
(création de la Gendarmerie nationale le 16 janvier 1791) que la
Constituante décide enfin de répondre clairement par le vote d’une loi
relative à « l’organisation de la Garde nationale ». Le débat s’ouvre le
21 novembre 1790 par un rapport, lu à l’Assemblée par
Rabaut Saint-Etienne, au nom des comités militaires et de constitution.
L’obsession de l’été 1789 n’a pas disparue d’une méfiance absolue des
députés à l’égard du roi. Pour Rabaut Saint-Etienne, si les gardes
nationales doivent demeurer subordonnées aux corps administratifs, il
est hors de question qu’elles dépendent en dernier lieu de Louis xvi,
qui est pourtant réputé chef suprême de l’administration. Au sommet de
l’État, seule la représentation nationale peut requérir les citoyens
armés : « Le corps législatif qui seul représente la volonté générale,
doit avoir seul la surveillance de la réquisition générale. C’est lui
qui doit parler et requérir pour la nation dans les crises
extraordinaires où les pouvoirs inférieurs deviennent insuffisants ». Le
même jour, Dubois Crancé insiste davantage encore dans le débat sur la
différence entre la garde nationale et l’armée. La première, parce
qu’elle est une force purement civile, forme même un contre modèle à
l’armée, où règnent l’esprit de corps et les hiérarchies. Là où l’armée
pourrait être l’instrument du despotisme royal, la garde nationale forme
rempart en faveur de l’Assemblée. En effet, « la garde nationale doit
avoir spécialement pour but de son institution de s’opposer aux excès du
pouvoir exécutif […] de faire respecter la souveraineté nationale,
enfin de résister à l’oppression [34]».
Pour autant, le suffrage étant censitaire pour constituer la
représentation nationale, il est hors de question pour les députés de
revenir sur le principe d’une garde nationale réservée aux seuls
citoyens actifs. Sur ce point le projet rencontre l’opposition de
Robespierre lorsque les débats reprennent, au printemps 1791. À la
séance du 27 avril, comme il l’avait fait au sujet du suffrage
censitaire, il fustige l’instauration d’une inégalité entre les
citoyens, fondée sur la distinction entre riches et pauvres. Prenant
très au sérieux le contractualisme social, il rôde en quelque sorte ce
que sera le droit à l’insurrection dans la Déclaration des droits
de 1793. Dans l’indifférence d’une Assemblée qui bavarde[35], Robespierre met en garde ses collègues :
Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière
armée pour défendre au besoin ses droits ; il faut que tous les citoyens
en âge de porter les armes y soient admis sans aucune distinction
[…]. Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme ;
être armé pour défendre la liberté et l’existence de la commune patrie
est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la
défense naturelle et indivisible dont il est la conséquence, puisque
l’intérêt et l’existence de la société sont composés des intérêts et des
existences individuels de ses membres. Dépouiller une portion
quelconque des citoyens du droit de s’armer pour la patrie et en
investir exclusivement l’autre, c’est donc violer à la fois et cette
sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lois les plus
irréfragables et les plus sacrées de la nature[36].
Nonobstant ce rappel aux principes, qui ressurgiront au moment où la
souveraineté populaire sera consacrée, les députés, conformément à leur
désir de désarmer les citoyens dits passifs, entérinent la règle d’une
garde nationale exclusivement réservés aux citoyens dits actifs, qu’il
s’agit par ailleurs d’identifier. Dès l’article 1er de sa première
section, la loi du 29 septembre 1791 réitère l’obligation, pour ces
derniers, de s’inscrire sur les registres municipaux pour le service de
la garde nationale. Et comme le précise l’article 2 : « À défaut de
cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits
que la constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que
celui de porter les armes ». À quel échelon administratif les gardes
nationales doivent-elles se situer pour ne plus représenter une menace
du fait de ses armes ? Les députés optent sciemment pour le district et
le canton. Ce n’est que par exception, pour « les villes
considérables », que l’on maintient des gardes nationaux à l’échelle de
la commune (section ii, article 1er)[37]. L’heure du désarmement arrive.
La loi dispose en effet que « [l]es anciennes milices bourgeoises,
compagnies d’arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l’arc ou de
l’arbalète, compagnies de volontaires et toutes autres, sous quelques
forme et dénomination que ce soit, sont supprimées » (section ii,
article 28). Ironie involontaire, cet article est précédé de celui qui
prévoit que « [l]es drapeaux des gardes nationales seront aux trois
couleurs, et porteront ces mots : Le peuple Français, et ces autres
mots : La liberté ou la mort[38] ».
Grégoire Bigot
Grégoire Bigot est Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France.
= = =
La suite de tout cela c’est la France des sections et les
sans-culottes de 1790 à 1793, qui furent la véritable ébauche du peuple
en armes efficace. Les “gardes nationales” ne sont que des récupérations
étatico-marchandes de la légitimité de l’auto-défense des peuples.
Elles ne sont donc que des
entités réformistes et inféodées au pouvoir étatico-marchand, qui à
terme ne peuvent que trahir le peuple au profit du pouvoir en place et
de ses sbires le faisant fonctionner et le finançant. Suffit de voir à
quoi est systématiquement employée la “Garde Nationale” à Yankland
depuis la guerre du Vietnam et les mouvements anti-guerre : à réprimer
le peuple…
~ Résistance 71 ~