Pendant les trois mois du mouvement social du printemps 2016, on a vu fleurir des projets reprenant les pétitions de masse contre la «loi travail» ou les tentatives d’imposer par pétition aux députés de voter la censure, contre le 49.3, et l’essai de votation impulsé par les centrales syndicales. Tous ces projets étaient proches d’un référendum et annonçaient la fonction que le Référendum d’initiative citoyenne (RIC) joue chez les Gilets jaunes. Sur le fond, le RIC est une sorte de réponse aux désastres démocratiques auxquels ont abouti le vote grec contre la troïka ou les votes de 2005, français et hollandais, contre la «constitution européenne», tous purement et simplement annulés par les gouvernants…
Dans le cas français de 2005, un référendum qui relevait clairement des institutions autoritaires de la Ve République, nous avons bien senti comment le vote populaire tendait à rejoindre par certains aspects un exercice démocratique, au sens ancien, celui qui permet une expression populaire directe. Ce genre de vote fonctionne en effet à la jonction entre les deux significations courantes du mot «démocratie», où on retrouve aussi bien l’idée d’un gouvernement qui accepte de revenir périodiquement devant les électeurs, que celle d’une intervention directe des gens sur les questions qui les concernent. Entre les deux significations, il existe désormais dans la plupart des pays, même développés, des éléments évidents de crise de représentation politique, suite à des élections vécues comme de véritables hold-up, genre Trump ou Macron, pour n’en citer que deux. Bref, bien avant le début des Gilets jaunes, la «question démocratique» se posait à nous et il était pertinent de réfléchir à sa place dans les mouvements sociaux.
Retourner aux sources de cette confrontation entre «représentation» et exigences d’expression populaire pourrait nous emmener loin car le débat sur la démocratie (pouvoir du peuple, au sens littéral) date de l’Antiquité grecque. Mais on peut aussi revenir à un passé moins éloigné dont les initiatives populaires de ces derniers mois nous ont montré qu’il pouvait ressurgir avec une facilité déconcertante. Lorsque, dans les mouvements progressistes, on oppose démocratie formelle et démocratie directe, on renvoie le plus souvent à des situations révolutionnaires brèves et intenses, comme la Catalogne ou l’Aragon de 1936-1937, ou à certains moments des débuts de la Révolution russe, en 1905 puis entre 1917 et 1919, et surtout à la Commune de Paris de 1871. Libertaires et marxistes, dans toutes leurs variétés, ont toujours donné une importance capitale à ce mouvement. Les parisiens de 1871, refusant de capituler devant les troupes du roi de Prusse comme devant l’armée du parlement de Bordeaux puis de Versailles, ont effectivement créé leur propre pouvoir populaire et tenté de le défendre, les armes à la main, jusqu’au massacre de la Semaine sanglante. On peut partir ici d’une question toute simple : pourquoi donc les parisiens et parisiennes de 1871 ont-ils choisi de désigner ce qu’ils mettaient en place comme étant la Commune de Paris ?
La réponse, évidente, est que les Communards tentaient de prendre appui sur le souvenir de la Commune de Paris, telle qu’elle avait existé pendant la Révolution française, essentiellement en 1792-1794. Les combattants parisiens de 1871 ont fait ce choix alors qu’ils étaient séparés de la période 1789-1799 par un quasi-siècle, au moins trois générations, et alors qu’ils avaient à leur disposition tout un répertoire politique et insurrectionnel bien plus récent, avec les révolutions de 1830 et de 1848-1852. Pourtant, les Communards ont accepté de se battre et finalement de mourir sous cet étendard de la Commune. Pas simplement pour relever un drapeau des temps jadis mais pour défendre leur mode de vie depuis le siège, toute une conception de la vie en société, des valeurs, comme on dit, incompatibles avec celles que défendaient Versailles et son armée.
Au cœur de ce mode de vie et de ces valeurs, il y avait nécessairement autre chose qu’un souvenir lointain, mais des pratiques politiques, ancrées dans la vie des quartiers et du travail, une conception de la démocratie différente de celles de l’ennemi. Ces valeurs et ces pratiques pouvaient-elles être, malgré le temps écoulé, plus ou moins directement reliées à ce qui s’était construit pendant la première révolution française ? On peut le penser dans la mesure où cette expérience démocratique et sociale déjà ancienne avait concerné une immense quantité de gens pendant une période de dix années, une durée exceptionnelle de mobilisation après les siècles qu’avait duré l’Ancien régime. Malgré les années de réaction, toute la société française est restée imbibée de ces souvenirs que chaque crise révolutionnaire et même chaque émeute ouvrière importante dans les années 1830 et 1840 ont ranimés, jusqu’à la Commune.
Nous savons bien que se référer à la Révolution française n’est jamais neutre et qu’en France cette référence traîne souvent à sa suite une forte dose de chauvinisme. Les hommes politiques de droite mais surtout de gauche parlent volontiers de la Grande révolution sur un ton cocardier et nationaliste. Ce cocorico est pour eux une façon de traiter implicitement, non de la seule Révolution mais de toute l’histoire de France, de sa «contribution» à l’histoire de l’humanité, y compris de ses entreprises coloniales, comme globalement progressistes, du moins « en dernière instance ». Il faut donc rester vigilant mais aussi être plus curieux de cette histoire que nous ne le sommes souvent, et depuis longtemps, parce que l’ignorance n’arrange rien. La Révolution française n’est pas la « Mère de toutes les révolutions » et il existe une littérature passionnante sur les courants radicaux dans les révolutions anglaise du XVIIe siècle et nord-américaine du XVIIIe, mais les dix ans du cas français méritent vraiment le détour !
- Révolution et invention démocratique
Le déroulement pratique de la Révolution française tout entière s’inscrit, de 1789 à 1795, dans une alternance permanente entre votes de masse et insurrections populaires.
Il faut toujours le garder à l’esprit car on explique trop rarement que
le caractère massif et la durée exceptionnelle de la Révolution
s’expliquent en bonne partie par la multiplicité et l’intensité des
pratiques collectives dans la population, dont les formes de vote et
d’élection. Il faut bien sûr préciser que ces formes pratiques du vote
et de l’élection sont assez différentes des nôtres mais qu’elles avaient
une légitimité considérable, parce qu’elles reposaient sur des assemblées de citoyens, des réunions au niveau des villages, des petites villes et des quartiers (sections)
dans les grandes villes. Donc, à côté des insurrections et des
batailles, la Révolution française repose aussi sur un immense et
durable réseau d’assemblées de citoyens (et parfois citoyennes).
Au départ, c’est la monarchie qui a pris l’initiative politique qui a «amorcé» la Révolution : elle convoque pour 1789 des états généraux, une institution disparue depuis presque deux siècles (1614), ceci dans un but précis : réaliser des élections contrôlées afin de faire voter par une assemblée légitime les impôts dont le gouvernement a besoin; il s’agit de forcer le clergé et la noblesse, les deux ordres (ou états) privilégiés, à payer l’impôt.
La convocation des états se veut donc un essai réformiste prudent mais octroie aux sujets du roi la capacité de rédiger des cahiers de doléances locaux. Il ne s’agit donc pas seulement d’élire mais aussi de rédiger des mandats pour les députés, des sortes de programmes politiques locaux. Toutes sortes de gens essaient alors de rédiger des modèles de cahiers qui circulent, créant donc une première campagne de presse publique. Il s’enclenche un immense mouvement de rédaction, un gigantesque tâtonnement d’écriture, pour lesquels le nombre de journaux et de brochures publiés explose ; cela crée un vaste kaléidoscope d’opinions, forcément contradictoires. C’est du jamais vu.
Répondant à l’effort de la monarchie pour s’auto-réformer, les dizaines de milliers de cahiers de base de 1789 invoquent facilement le patronage du roi mais leur conformisme apparent peut tout aussi bien masquer l’insolence des sujets de Sa Majesté : en célébrant longuement la bonté du roi, en le complimentant à l’excès, il arrive qu’on se paye surtout sa tête : c’est le persiflage, dont le roi, tout absolu qu’il est, et ses dignitaires, ne peuvent jamais vraiment savoir si c’est du lard ou du cochon.
La formation des états généraux s’organise selon un découpage territorial et social archaïque et selon des formes médiévales surannées. Le clergé, représentant de la Divinité, et la noblesse votent à part, et pèsent autant que les 98 % du reste de la population, les roturiers du troisième état (le tiers état). Les élections de ce tiers état se font par paliers successifs, depuis les communautés d’habitants, les paroisses et les corps de métiers des villes, jusqu’à des réunions dans les sièges d’anciennes justices (les baillages et sénéchaussées) où les délégués élus à la base sélectionnent les doléances et s’autosélectionnent, choisissant les députés qui seront finalement élus et partiront pour Versailles.
Les cahiers adoptés à la base sont totalement revus dans les circonscriptions secondaires, où sont sélectionnés les «vrais» députés du tiers état, ainsi «écrémés», avec la formation d’une sorte de front politique, d’une alliance encadrée par de gros notables qui mobilisent ainsi une légitimité écrasante. Cette alliance va s’imposer à une partie des députés des deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, et permettre, à Versailles, la décision majoritaire de transformer les états en une seule Assemblée nationale constituante. Cette transformation place la monarchie en face d’un interlocuteur imprévu, une Assemblée nationale légitime bien au-delà de l’impôt.
En vérité, cette procédure de sélection des hommes et des doléances est également une expérience politique fondatrice, y compris pour ceux qui ont échoué à se faire entendre. Derrière le succès fondateur du tiers état, qui s’affirme comme étant par lui-même l’immense majorité du pays, une grande partie du «peuple proprement dit» n’a pas eu voix au chapitre. Paysans et artisans de 1789 ont mal maîtrisé les exercices de rédaction et d’adoption des cahiers, mais ils y ont participé de leur mieux. Dans l’élaboration des doléances, leur point de vue antiseigneurial a largement été noyé dans les cahiers primaires et surtout dans ceux des assemblées secondaires. Il n’empêche que ça a été aussi pour eux une formidable école, une expérience fondatrice. En profondeur, à partir de l’adoption des cahiers locaux, l’idée de mettre les revendications par écrit va rester bien vivante pendant les dix années qui suivent : chaque fois que les citoyens s’assembleront, ils auront tendance à reprendre la parole et la plume.

Le succès global de la transformation des états généraux de Versailles en Assemblée nationale et la résistance du pouvoir royal à cette nouvelle autorité légitime expliquent à leur tour la puissance du mouvement populaire d’autodéfense : le 14 juillet à Paris, on s’arme en prenant l’arsenal des Invalides puis celui de la Bastille. Succès et politisation de masse. Comme en écho, en province, surgit alors le gigantesque mouvement dit de la Grande peur: une rumeur omniprésente diffuse la menace d’un ravage imminent des récoltes, d’un péril militaire imprécis mais vécu comme réel; pour y faire face, on improvise des autorités locales, on s’arme ; pour réquisitionner des armes, on fait des raids dans les châteaux, où, déjà, on cherche à détruire les archives seigneuriales. Ce mouvement de municipalisation et d’armement transforme définitivement la situation, prenant le relais des assemblées électives du début 1789. La monarchie absolue est durablement affaiblie en face de l’Assemblée nationale, dont personne ne sait encore si elle peut résister durablement, mais les conséquences vont à leur tour aller au-delà du but politique initial.
Ceux qui commencent à se nommer eux-mêmes des «citoyens» et parfois des «citoyennes» ne conçoivent pas leurs droits politiques comme uniquement liés au vote. Ils tiennent tout autant à porter les armes, un privilège qu’ils sont tout juste en train d’arracher aux nobles en formant leurs propres Gardes nationales, et à leur droit à s’exprimer librement par pétition ou à lire une presse libre… Les débats font rage sur la façon d’organiser les nouvelles autorités. Dans le cas de Paris, les 60 districts qui avaient été les structures électorales de 1789 se transforment en assemblées permanentes qui débattent à l’infini des limites que les citoyens veulent mettre aux pouvoirs de la future municipalité parisienne. C’est là qu’on peut repérer le premier débat moderne sur le mandat impératif et la révocabilité des élus. Mais, dans le même temps, les membres de l’Assemblée constituante décident d’abandonner la totalité des mandats impératifs qu’ils avaient reçus de leurs défunts ordres, provinces ou de leurs villes d’élection, afin de discuter librement de la refonte de toutes les institutions.
L’Assemblée débat d’abord, dans ce cadre, de la façon de maîtriser les nouvelles structures spontanées, municipalités et garde nationale, dont elle va organiser le remplacement lors de procédures électorales organisées au long de 1790. C’est délibérément que la Constituante généralise alors l’élection comme mode d’accès à toutes les fonctions publiques, avec des mandats très courts de deux ans maximum, ce qui restera la norme jusqu’à la fin de la décennie, mais ne fait aucune place au mandat impératif ou à la révocabilité des élus.
Pour ces élections [1], la procédure qui a permis la formation des états généraux reste logiquement le modèle de référence: elle seule a permis de réunir plusieurs millions de votants dans une cinquantaine de milliers d’assemblées élémentaires. Sur ce modèle, des assemblées municipales mais aussi cantonales délibéreront puis éliront en leur sein ceux qui vont les administrer, mais aussi ceux qui vont se réunir à leur tour en assemblées électorales secondaires et choisir finalement les administrations des 560 districts et des 83 départements, ainsi que, dans le futur, les députés. Dans cette logique, pour chaque élection, pour chaque vote, les citoyens continueront à s’assembler à un niveau donné : municipal, ou par section dans les grandes communes, et cantonal pour les élections politiques. C’est l’invention de ce que nous appelons la démocratie locale, en 1789-1790.
À cette époque, presque personne ne pense qu’il soit possible de voter autrement que dans une assemblée de voisins, au village ou dans un quartier urbain, donc dans des réunions qui prennent au minimum une journée entière. Il faut bien sûr pouvoir consacrer du temps à cette succession pyramidale d’élections, ce qui a tendance à sélectionner des élus plus disponibles parce que plus riches ou plus instruits. Ce cadre est pourtant celui d’une égalité juridique qui, précisément parce qu’elle est radicalement nouvelle, n’est pas que formelle. Adopter, par exemple, le simple ordre alphabétique des noms (ou des prénoms !) pour établir la liste des citoyens assemblés paraîtrait banal de nos jours mais, à l’époque, cela permet de refuser l’ordre de préséance de l’Ancien régime et donc ses privilèges. L’égalité juridique n’abolit pas les inégalités sociales, mais tenir ces réunions de citoyens, c’est réellement, à chaque fois, «mettre en scène[2]» leur citoyenneté récente, autour des choix à faire.
Ces réunions sont une force du système et, surtout en période de forte participation, une formidable école. Pour que les assemblées de citoyens parviennent à se tenir, il faut que les participants arrivent à maîtriser les contradictions qui les divisent, affrontements religieux ou antagonismes sociaux. Sinon elles explosent, au sens strict. Elles doivent donc, simultanément, traiter de toutes sortes de questions qui les impliquent à fond mais aussi respecter un rituel collectif, garant d’un minimum de consensus et de légitimité. Elles sont donc de véritables écoles politiques, à une échelle jusque-là inconnue, en même temps qu’elles procurent un auditoire régulier à tous ceux qui ont un message à transmettre. À l’échelle de tout le pays, ce réseau des assemblées cantonales, municipales et de sections urbaines est bien plus dense que celui des clubs et sociétés politiques qui se créent par ailleurs.
En pratique, des institutions élues par la base fonctionneront de façon à peu près constante de 1789 à 1799, des assemblées de citoyens se réuniront pendant presque dix années, une expérience en tous points exceptionnelle, et les différents moments du «retour à l’ordre» seront eux aussi scandés par des votes, devenus la norme de la légitimation. On doit tenir compte de la puissance de cette vie collective si on veut comprendre comment la mobilisation des foules révolutionnaires a pu durer si longtemps, mais aussi comment cette première expérience démocratique de masse a pu transformer la conscience collective.
On élit donc toutes les administrations des municipalités, cantons, districts, départements, mais aussi tous les juges de tous les niveaux, les directeurs des postes et les commissaires de police, tous les grades de la Garde nationale jusqu’au rang de colonel, aussi bien que les syndics des gens de mer… Au-delà des élections municipales, où les nouveaux citoyens mais aussi parfois les veuves peuvent voter directement s’ils payent un impôt direct de la valeur de trois journées de travail, les élections politiques ont lieu dans des assemblées primaires, cantonales, où on ne trouve plus que les citoyens actifs mâles, qui doivent se réunir au chef-lieu, ce qui prend nécessairement au moins une journée. Ils y délibèrent sur les affaires communes, élisent leurs juges de paix et choisissent des électeurs (que nous dirions «secondaires»). À leur tour, ces électeurs sont chargés de se réunir, au département et au district, pour y procéder aux élections administratives et politiques.
Ces élections systématiques de peut-être un million de fonctionnaires publics rappellent ce qui se pratique alors dans les 13 colonies américaines qui viennent de former les États-Unis, mais à une tout autre échelle. Couronnant le nouveau réseau d’autorités élues et la généralisation du droit de porter les armes, il s’organise un mouvement de fédération : des délégations des nouvelles Gardes nationales se forment dans tous les départements et finissent par se rassembler à Paris, le 14 juillet 1790, pour célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille.
Le droit de vote s’étend aussi à la nomination des nouveaux curés et évêques. Vu le rôle majeur du clergé dans la société de l’époque, le fait que les fidèles choisissent eux-mêmes ces nouveaux desservants n’est absolument pas anodin et instaure une réelle capacité de contrôle. Les catholiques traditionalistes ne s’y trompent pas et cette réforme débouche sur une scission (un schisme) entre les catholiques qui acceptent le nouveau régime de constitution civile du clergé et les adversaires de tout changement, fidèles à l’autorité du Pape.
En face de cette extension vertigineuse du système électoral, il n’existe encore aucune offre politique standardisée qui soit pareillement comprise de tous, rien qui ressemble à des «partis». Les journaux et pamphlets tentent d’influer, mais leurs tirages sont techniquement limités et ils ont tendance à se recopier ! De plus, quand il s’agit d’élire, l’idée même de candidature est franchement suspecte : la conception admise est que celui qui convoite une place prouve par là même qu’il en est indigne. L’idée maîtresse, d’origine religieuse, est qu’au niveau d’une assemblée de voisins, chacun sait, en son for intérieur, qui mériterait d’être élu. C’est pourquoi, dès 1789, les élections se font sans candidatures. On vote d’abord totalement au hasard (et chacun peut voter pour soi !), puis de même pour le second tour. S’il n’y a pas eu de majorité absolue, on organise alors un troisième tour, un ballottage limité aux deux candidats arrivés en tête du second tour.

Le système de vote en assemblées permet en pratique la cohabitation de deux orientations qui s’opposent plus ou moins sourdement au long des dix années de Révolution : en effet, la culture politique mathématisée qui est la nôtre n’existe absolument pas encore à cette époque. Des exigences aujourd’hui élémentaires comme de connaître les pourcentages de participation ou la répartition des voix lors de chaque vote ne sont pas même envisagées. Le point fondamental est la bonne tenue, paisible, de l’assemblée municipale, primaire ou électorale, dont d’ailleurs les listes, décomptes de voix, bulletins et autres instruments du vote sont le plus souvent brûlés à l’issue de la réunion. L’assemblée des libres citoyens crée de la légitimité en délibérant librement, et pas en remplissant des critères quantifiés. Les votes sont la façon technique de connaître les choix mais leur légitimité est celle des citoyens réunis.
De ce fait, cette légitimation se dédouble elle-même : les citoyens une fois librement assemblés doivent-ils se borner à élire, ou bien peuvent-ils aussi exercer leur droit de délibérer sur les sujets de leur choix ? Les élites conçoivent ce débat comme celui entre la représentation et la démocratie, mais il a une réalité très pratique et ne cessera jamais vraiment pendant les dix ans de révolution, battant son plein pendant les étés de 1792 et de 1793, lorsque les exigences sociales liées à la redistribution de la production agricole commenceront de s’exprimer dans les institutions politiques. L’expérimentation, entre 1790 et 1794, du vote en assemblée de citoyens n’est donc jamais éloignée de ce que nous appelons démocratie directe. La population peut essayer de s’exprimer dans ces assises locales et la généralisation de cette pratique permettra les premiers exercices du vote populaire direct (nous disons le référendum) entre 1792 et l’été 1793.
Si on compare le système électoral créé au début de la Révolution avec nos pratiques d’aujourd’hui, on constate que les assemblées de citoyens ont combiné l’exercice de plusieurs types de droits que nous pratiquons désormais dans des domaines séparés : non seulement le droit d’élire (alors beaucoup plus étendu et fréquent) mais le droit d’association (les citoyens assemblés s’associent pour exercer leur portion de souveraineté) et le droit de pétition (ils adoptent toutes sortes de vœux), sans parler du droit de porter les armes (dans la Garde nationale) qui fait figure de garantie supplémentaire.
Fréquence des votes, droit de délibérer en assemblées de base, brièveté des mandats, organisation militaire citoyenne : il y a une étrange proximité avec ce que nous pouvons imaginer comme une démocratie directe. Ces pratiques ont en tout cas des effets politiques immenses. Même après la décapitation des mouvements populaires, en 1794-1795, la période dite du Directoire restera dans ce cadre électoral et verra les premiers essais d’un régime de démocratie représentative limitée, en 1795-1799. Et même Bonaparte, après son coup d’État de décembre 1799, devra encore avoir recours en 1800 à un plébiscite, truqué mais décisif.
- Contradictions, reculs et avancées
La
généralisation des élections s’est faite dans l’enthousiasme du grand
mouvement populaire de 1789 mais en masquant une contradiction
fondamentale. L’Assemblée constituante ne se considère nullement comme formée de démocrates chargés de mandats impératifs mais comme un collectif de représentants du peuple, investis des pleins pouvoirs. Elle se donne donc du mal pour annuler les mandats par
lesquels les assemblées locales de 1789 avaient tenté de protéger les
anciens privilèges des provinces, villes et corporations. Il s’agit pour
l’Assemblée de construire un régime purement représentatif, c’est-à-dire où les citoyens auront comme tâche principale de choisir leurs représentants
et où ces derniers auront toute la responsabilité du pouvoir, avec un
roi ou bien, éventuellement, sans. Toutes les élections autres que
celles de ces députés sont donc conçues comme des gestes administratifs,
indispensables, mais pas comme des lieux de délibération populaire. Il
n’est pas question de créer un régime où l’Assemblée des législateurs
recevrait ses ordres des assemblées de citoyens. Une fois que les
députés sont élus, les citoyens leur doivent un respect religieux.
Pour conforter ce monopole politique des représentants, d’importantes mesures visent à limiter l’autonomie des assemblées de citoyens, des municipalités et des unités de la Garde nationale. Il s’agit par exemple du remodelage complet de l’organisation de la ville de Paris qui, de 60 districts passe à 48 sections, supposées être essentiellement administratives – mais qui, au contraire, deviendront des lieux de forte participation populaire et de radicalisation. Il s’agit par exemple de n’accorder le droit de vote qu’à ceux qui paient en impositions au moins l’équivalent local de trois journées de travail. Cette limitation exclurait une bonne partie des journaliers, compagnons, petits paysans et artisans – mais la mesure s’avère une marque de faiblesse car elle oblige les assemblées de base à discuter longuement du détail de ces exclusions, traitées publiquement, et donc à souligner les limites mises aux droits des citoyens «non actifs».
En réalité, l’existence du réseau des assemblées de citoyens est largement contradictoire avec le principe de la représentation et rend moins efficaces les lois qui, par exemple, interdisent aux citoyens de s’associer selon leurs métiers ou leurs professions (lois Le Chapelier). Si les lettrés qui ont lu Jean-Jacques Rousseau protestent contre la toute-puissance donnée à la représentation, dans l’ambiance évidemment chaotique d’une grande révolution populaire, le droit qu’ont les citoyens de s’assembler régulièrement dans les localités fait plus que contrebalancer les interdictions qui leur sont faites. Le projet d’exiger le paiement d’un impôt majoré (le marc d’argent) pour accéder aux fonctions d’électeur secondaire se heurte à une opposition démocratique résumée dans un grand discours de Robespierre : la mesure, adoptée, ne sera jamais appliquée.
L’exercice des droits de citoyens dans la Garde nationale contamine progressivement la vieille armée royale. Les soldats des régiments de ligne, les équipages de la flotte et les ouvriers des arsenaux commencent à revendiquer pour eux-mêmes la fin des châtiments corporels arbitraires, le contrôle des caisses régimentaires, ou le droit à l’avancement pour les non-nobles. Leurs protestations collectives sont durement réprimées: condamnation à des coups de plat de sabre, flagellation, travaux forcés, voire intervention d’autres unités, avec fusillades et pendaisons. Ceci entraîne l’action solidaire de comités de patriotes. Dans le même temps, et puisqu’on remet en question leur autorité, beaucoup d’officiers supérieurs nobles commencent à émigrer. Pour la masse des sous-officiers et soldats, il apparaît enfin imaginable d’être traité humainement et promu selon son mérite, et non selon son origine. Travaillée par ces conflits, l’armée royale ne sera bientôt plus en mesure d’agir comme force de maintien de l’ordre. Le vieux monde part en lambeaux avec son armée et la reconstruction d’une force publique prendra du temps.
Au-delà de la réalité des assemblées de base et de la pyramide des élections, le pays est très vaste: l’idée de consulter directement tous les citoyens reste encore abstraite. Elle est posée dès 1790 par de petits groupes de radicaux, en particulier au club des Cordeliers à Paris, en vue de peser sur la rédaction de la Constitution, mais sans beaucoup d’écho. Pour la masse de la population, ce qui a été acquis comme transformations est déjà extraordinaire : les citoyens font donc preuve d’une grande patience en attendant que leur sort s’améliore vraiment. Des questions aussi fondamentales que le contrôle du prix du pain sont débattues dans les assemblées de citoyens, mais toujours en balance avec la crainte d’un retour de l’absolutisme, d’une revanche du roi et des seigneurs comme il y en a tant eu dans le passé. Dans ces conditions, il n’est pas évident d’aller mettre la pression sur les élus du peuple. Mais le pouvoir royal, lui, accepte de moins en moins de coopérer avec l’Assemblée, et empêche tout compromis qui pourrait stabiliser la monarchie.
Le roi et la reine gardent des liaisons secrètes avec les autres cours d’Europe. En juin 1791, leur tentative de rejoindre l’armée de l’Est est un cruel révélateur. Clairement, l’échec de cette fuite du roi est dû à la mobilisation des patriotes et des institutions révolutionnaires de base, les municipalités et surtout les gardes nationales qui se mobilisent au long des routes, et neutralisent les unités d’élite de hussards… pour finir par ramener le roi, bien piteux, à Paris. Une avant-garde politique de militants républicains exige à ce moment la déchéance du roi mais l’Assemblée est décidée à sauver la monarchie : les pétitionnaires qui se rassemblent au Champ de Mars se font fusiller à bout portant par la garde nationale parisienne (17 juillet 1791). Une vague de répression s’étend dans les villes, les casernes, la flotte…
La royauté, maintenue à grand-peine, refuse tout compromis. La nouvelle Assemblée, la Législative, élue en septembre 1791, se réunit le 1er octobre mais n’a pas l’autorité de la Constituante. Elle devient le jouet de la Cour qui a adopté la « politique du pire » : déclencher au plus vite la guerre dans le but que l’armée se décompose une bonne fois pour toutes, afin que, avec l’appui militaire des souverains européens, le roi puisse enfin recouvrer l’intégralité de ses pouvoirs. Dans un enthousiasme trompeur, la Législative vote une déclaration de guerre aux puissances continentales (avril 1792), malgré l’opposition désespérée d’un Robespierre, presque seul à en signaler les risques politiques. La désorganisation de l’armée apparaît dès les premiers combats du printemps, tous désastreux. L’invasion est en marche.
Pourtant, l’accumulation d’expérience politique dans les assemblées locales a continué pendant toute cette époque. Dans les sections urbaines, dans les communes et les cantons, et même dans les administrations des districts, de plus en plus de questions sociales et politiques viennent en débat : il devient bien difficile de faire taire les citoyens alors que le roi, malgré tous ses serments, s’appuie sur les autres monarques. Du printemps 1791 à l’été 1792, l’idée répandue que Louis XVI est un mauvais souverain se double progressivement d’une autre, plus générale: la monarchie est-elle encore un régime admissible ? Et, si ce n’est pas le cas, qui pourrait être un meilleur souverain que le peuple lui-même ? Se réunir et voter en assemblées de citoyens est devenu de moins en moins une modalité technique et importe de plus en plus politiquement aux intéressés, comme leur droit de pétitionner ou leur organisation dans la Garde nationale. La capacité qu’a eue ce peuple, depuis 1789, de se réunir régulièrement prouve bien qu’il existe collectivement.
- Une révolution mise en permanence
À l’été
1792, les armées ennemies pénètrent de toutes parts sur le territoire,
et leurs chefs menacent Paris et les Parisiens d’une destruction exemplaire.
Cette menace est on ne peut plus concrète. Dans le même temps, toujours
à l’approche des moissons, des actions paysannes spontanées se
déclenchent contre les droits seigneuriaux, pendant que se multiplient
les saisies de convois de grains pour assurer le ravitaillement à bas
prix, la taxation populaire. En réponse à ces menaces, le 10
août 1792, une insurrection organisée par des sections parisiennes, des
patriotes et des sans-culottes force la Législative à «suspendre» les
pouvoirs du roi. C’est la « seconde révolution » qui scelle le sort de
la monarchie. La Législative se met en sursis en convoquant les
assemblées primaires pour le 26 août, afin de réunir au plus tôt les
assemblées électorales départementales qui éliront une Convention, une assemblée munie des pleins pouvoirs pour régler le sort du roi et rédiger une nouvelle Constitution.
Entre août et novembre 1792, alors que tombent les obstacles mis à la participation des citoyens les plus pauvres, les assemblées primaires et électorales se réunissent à plusieurs reprises pour renouveler d’abord l’Assemblée nationale, en élisant la Convention, puis finalement toutes les administrations. Les assemblées de citoyens en profitent pour délibérer sur ce que doit être le nouveau régime. On peut dater de ce moment, avec les allers-retours entre assemblées primaires et électorales, une montée spectaculaire des pratiques de ce qu’on appelle alors la démocratie, une démocratie «tout court» qui n’est conçue ni comme «directe» ni comme «réelle» mais comme un pouvoir délibératif exercé directement par le peuple proprement dit.
Ce ne sont pas seulement les 48 sections de Paris qui connaissent cette radicalisation démocratique. Si le nombre de sociétés et de clubs populaires augmente sur tout le territoire, ce sont les électeurs, délégués des citoyens, qui font la navette entre leurs assemblées. Ces électeurs secondaires ne sont d’ailleurs plus tout à fait les mêmes que les années précédentes. Les artisans et petit paysans y sont plus nombreux, plus exigeants, et ils essaient de peser. Beaucoup viennent de localités où ont lieu des manifestations armées pour la liquidation des droits seigneuriaux ou bien la taxation des prix du pain et des farines. Désormais, la question de leur prix maximum se pose crûment.
Cette angoisse du ravitaillement, la peur devant l’invasion, la crise de représentation que crée l’effacement de la Législative et la mise en place de la Convention poussent à l’auto-organisation, à la mise en permanence des assemblées de citoyens, et aussi à prendre des mesures spontanées pour terroriser les adversaires, et même pour les exterminer : à Paris, entre le 2 et le 6 septembre 1792, les militants sectionnaires entreprennent de «vider» les prisons avant de partir aux frontières ; ils jugent sommairement et massacrent une bonne partie des détenus. Le risque de voir se répéter ces actes de «terreur populaire» va obséder la Convention dès sa réunion.
Dans les grands départements agricoles qui nourrissent Paris et les armées, les assemblées connaissent des discussions acharnées où se confrontent les intérêts des salariés et artisans, des vignerons, des petits et grands exploitants agricoles… Tous ceux qui ont besoin d’acheter leur blé, ou qui en produisent pour eux-mêmes, ou sont de petits vendeurs, ne s’opposent plus seulement aux seigneurs mais désormais aussi aux grands fermiers capitalistes qui dominent ces régions, monopolisent les terres, fixent les salaires et les prix. En d’autres termes, le cadre unitaire du tiers état, formé en 1789 contre les privilégiés, est en train de voler en éclats, non plus dans les quelques grandes villes mais dans l’immensité du pays rural.
Dans les assemblées de Seine-et-Oise[3], le vaste département céréalier qui entoure Paris, les revendications classiques sur le prix du pain, mais aussi sur la dimension des grandes fermes, commencent à se combiner avec des motions pour l’abolition de la monarchie et pour des projets proprement démocratiques [4]. Le 17 septembre, Pierre Dolivier, curé d’Auvers, près d’Étampes, un militant radical relativement connu, propose d’imposer dans la nouvelle Constitution que soit organisée une discussion nationale sur chaque loi nouvelle[5]. Sa proposition amplifie les demandes des radicaux parisiens ; elle suppose un contrôle des assemblées locales sur l’action des députés et l’adoption du mandat impératif. La proposition de Dolivier est repoussée mais elle n’est plus un cas isolé : au même moment, Babeuf argumente pareillement devant l’assemblée électorale de la Somme[6].
Finalement, l’assemblée de Seine-et-Oise élabore une Adresse à la Convention, une sorte de programme qui combine la défense des intérêts des artisans et salariés, en fixant une proportion entre le prix du pain et celui de la journée de travail, avec les revendications des paysans moyens et pauvres, en limitant la taille des grandes fermes. Avec ses propositions de contrôle populaire, l’Adresse des élus de Seine-et-Oise, présentée le 15 novembre 1792 à la Convention résonne moins comme un appui que comme une menace : «Ne vous effrayez point […] ce ne sont pas les vérités mises au jour qui font les révolutions, ce sont celles que l’on étouffe»… L’Assemblée va rejeter en bloc cette Adresse. Face aux revendications qui remontent de partout, il lui importe de protéger le rôle central du Parlement et de casser toute logique alternative fondée sur les assemblées locales de citoyens. Mais l’Adresse[7] témoigne de la profonde radicalisation sociale en cours et de l’élaboration progressive des alliances politiques qui vont devenir indispensables.
La Convention, assemblée depuis le 21 septembre 1792, a logiquement décidé l’abolition de la monarchie. Elle a appris à ce moment que, pour la première fois, à Valmy, l’armée nouvelle avait été capable de subir la canonnade ennemie et de ne pas s’enfuir. Il est donc possible de combiner l’expérience des culs blancs, des vieilles troupes royales, avec le patriotisme des bleus, les volontaires issus de la Garde nationale. Ce début de stabilisation, qu’on sait provisoire, donne un peu de temps à la Convention. Former une République dans un pays de 25 à 30 millions d’habitants, c’est pour elle sauter dans l’inconnu, même si elle a été élue pour rédiger la Constitution de cette République de taille inédite, et donc pour se débarrasser du roi. Cette dernière tâche l’occupe de la fin de l’année 1792 jusqu’en janvier 1793 mais, d’emblée, la Convention rend un hommage (peut-être involontaire) à la maturité politique acquise par les assemblées de citoyens en décidant, par un décret d’octobre 1792, que tous les votes se feront désormais à deux et non plus trois tours de scrutin. Cette simplification technique signifie aussi que l’espace politique s’est simplifié, et ce mode de scrutin va rester la règle.

- La troisième révolution et l’idée du «référendum»
Les
membres de la Convention connaissent parfaitement l’activité multiforme
des assemblées de citoyens de l’été 1792, puisqu’ils y ont été élus. En
fait, ils sont confrontés à une situation inédite où le peuple agit
déjà comme le Souverain, mais doivent désormais définir ce que vont être ses pouvoirs.
La question est d’emblée en débat, dans des décisions encore
tâtonnantes. L’idée de ce que nous appelons « référendum » apparaît
immédiatement avec le projet encore vague de soumettre la future
Constitution au suffrage populaire, et des mises en pratique partielles
surviennent simultanément, avec des votes populaires directs pour
sanctionner, fin 1792 et début 1793, la réunion à la France d’une série de territoires frontaliers qui n’en faisaient pas partie.
Il est également question d’un vote de ce genre, mais national, lorsqu’un vif débat a lieu pour savoir si le verdict à rendre sur le sort du roi sera ou non soumis au vote des assemblées primaires. Les députés hésitent, comprenant bien que cette consultation ouvrirait la voie à d’autres, mais ignorant surtout quels seraient les résultats d’une sanction populaire de la décision qu’ils vont rendre sur le sort du roi. Ils savent bien que si les monarques européens gagnent la guerre, chaque député sera tenu pour personnellement responsable de son vote et que les ennemis pendront tout simplement ceux qui auront mal voté. Mais la majorité des conventionnels refusent pourtant de renvoyer aux assemblées primaires la sanction de la décision qu’ils vont prendre.

Le roi, condamné pour haute trahison, est exécuté le 21 janvier 1793. Par ce choix, la majorité des membres de la Convention assument leur statut de représentants. Ils fondent, d’une certaine façon, la légitimité politique de la bourgeoisie française. En face de ce choix, les monarques européens ne peuvent plus transiger : la guerre prend un caractère inexpiable, qui va diviser encore plus la Convention. Celle-ci tente de reconstruire un appareil d’État et une armée largement démembrés mais continue aussi à conforter sa légitimité en multipliant les recours au vote direct des citoyens, des votes qui en fait aiguisent à leur tour les contradictions d’un régime encore très faible.
La Convention décide ainsi, en février 1793, l’amalgame des unités issues de l’ancienne armée avec celles formées des volontaires de la Garde nationale mais elle doit, pour conserver l’adhésion de ces volontaires, généraliser l’usage du vote pour l’avancement. Cette pratique de l’avancement selon un mérite reconnu par le vote des soldats, depuis les caporaux jusqu’au grade de colonel, réserve quand même un tiers des postes à l’ancienneté. Il se révélera durablement efficace mais, en réponse, les officiers supérieurs désertent massivement. Dumouriez, commandant en chef en Belgique, passe à l’ennemi dans les derniers jours d’avril 1793, avec tout son état-major, en emmenant prisonniers le ministre de la Guerre et les conventionnels qui l’accompagnaient. Les troupes, abandonnées à elles-mêmes, résistent comme elles peuvent, mais la méfiance totale envers les généraux issus de l’ancien régime s’étend désormais à toute l’armée et à tous les patriotes.
Pour renforcer ces armées, un autre décret de février 1793 a décidé la levée de 300 000 hommes, mais donne aux assemblées locales de citoyens concernés le choix de la façon de procéder à cette levée : on pourra soit tirer au sort, soit «élire» les partants. Le principe du volontariat est maintenu mais surtout parce qu’il permet de recourir de façon officieuse à la pratique du «remplacement» des partants, contre une somme d’argent. Cette levée, son recours à un mode de décision très critiquable, les injustices et les inégalités sociales qu’elle accroît entraînent des conflits ouverts dans l’Ouest. Le refus de ce mauvais procédé de recrutement est le point de départ de ce qui va devenir la révolte vendéenne, mais il a été conçu comme une vaste décision démocratique, décentralisée.
Dans le même genre, la Convention crée en mars 1793 des comités de surveillance municipaux, chargés des tâches de police. Ces organes sont formés par élection directe de douze citoyens, dont sont exclus les prêtres, les nobles et leurs agents. Ces comités formeront une autorité locale efficace mais également rivale de celle des municipalités et des gardes nationales. Toutes ces innovations démocratiques, avec leurs improvisations, témoignent des difficultés que la Convention éprouve à gouverner, car ces tâtonnements témoignent aussi de l’émergence, dans son sein, de deux courants politiques qui se cristallisent.
Ce clivage se fait au printemps 1793, non pas tant sur les termes de la future Constitution, qui avance très lentement, que sur les choix sociaux cruciaux imposés par la guerre contre tous les monarques d’Europe. Faut-il, peut-on, mobiliser directement la masse de la population, et gagner ? La Gironde ne le pense pas ; elle veut privilégier la voie diplomatique et convaincre les monarchies européennes de la folie d’une guerre totale, pour éviter des mesures sociales drastiques et leurs conséquences à long terme. La Montagne, au contraire, est prête à appuyer les revendications des sans-culottes parisiens organisés dans leurs sections et, à la campagne, à en finir définitivement avec les droits seigneuriaux pour mobiliser l’ensemble des ruraux. En mai 1793, avec les défaites en Belgique et aux frontières, avec l’extension de la guerre civile dans l’Ouest, aucun compromis n’apparaît plus possible. À nouveau mûrement préparée par une commune insurrectionnelle, avec l’appui de la Montagne, une nouvelle insurrection des sections parisiennes force, le 2 juin 1793, la Convention à exclure le noyau dirigeant des Girondins et contraint au ralliement le reste des députés. La «troisième» révolution est enclenchée.
Sous la contrainte de l’insurrection, il se forme dans la Convention une nouvelle majorité, composite mais animée par la Montagne et qui domine un nouvel organe exécutif, le Comité de salut public. Pour la Constitution, il est rapidement admis que le futur régime devra combiner la représentation avec la possibilité pour les citoyens de trancher par eux-mêmes les choix majeurs ou qui les concernent directement. Preuve en est bientôt donnée avec la loi du 10 juin 1793 sur le partage des Communaux. Discutée depuis longtemps, cette loi ouvre, dans sa version finale, le droit de décider des partages par un vote local, ouvert à tous les majeurs domiciliés, hommes et femmes. Si le partage est décidé, il sera égalitaire, avec une parcelle pour chaque habitant de la localité, propriétaire ou non, homme ou femme, majeur ou non[8]. Cette loi du 10 juin est largement diffusée et commentée, d’autant que ce vote d’intérêt local est le premier à admettre explicitement une participation des femmes et que son adoption éclaire à sa façon le projet de Constitution que la Convention adopte le 24 juin 1793 et va cette fois soumettre au vote populaire.
- La Constitution de 1793 et ses critiques
L’insurrection
des 31 mai-2 juin a décidé une partie des cadres girondins à se
réfugier en province, d’où ils engagent une virulente campagne contre le
coup de force qui a violé l’Assemblée souveraine. Deux légitimités
existent donc, sources d’une possible guerre civile. À Paris, une
commission issue de la nouvelle majorité élabore une Déclaration des
droits et une Constitution, en retravaillant les textes partiels adoptés
dans les mois précédents. Ce projet est mené à bien entre le 5 et le 24
juin, une rapidité qui, au milieu d’une actualité multiforme, rend plus
difficile la critique.
Ces documents vont être massivement diffusés, comme probablement aucun texte politique ne l’avait été jusque-là. Plusieurs de leurs aspects sont d’un genre unique dans les annales : ainsi la définition des conditions requises pour exercer la citoyenneté, qui est ouverte à tous ceux qui résident sur le territoire et participent à la vie sociale, quelle que soit leur nationalité. L’Acte constitutionnel, lui, reprend des mécanismes très proches de ceux qui existaient déjà depuis 1790, mais transformés par l’élection désormais directe des députés dans des circonscriptions territoriales spécifiques. Le travail des futurs parlementaires, élus pour un an, sera pourtant contrôlé par un mécanisme démocratique, lui aussi direct, puisque les projets de loi élaborés par l’Assemblée seront soumis à l’approbation ou à l’improbation des assemblées primaires. Le système n’organise en réalité que l’improbation pour laquelle les assemblées primaires devront s’auto-convoquer, selon des modalités bien définies, avec des taux de participation exigés pour que leur convocation soit valable comme pour que la validité de leurs votes soit admise. Le schéma adopté articule donc représentation et démocratie avec un sérieux élargissement des droits politiques, dont les femmes restent cependant exclues.
L’Acte constitutionnel de 1793 ne va pas non plus jusqu’à reconnaître les droits sociaux, comme le droit au travail ou à l’assistance pour ceux qui ne peuvent travailler. Le projet de Déclaration des droits élaboré en ce sens par Robespierre n’a pas été retenu mais ce dernier n’insiste plus : après le 2 juin, il s’agit de conserver la nouvelle majorité, trop fragile. Or les militants radicaux parisiens, profondément impliqués dans l’activité politique des sections entre les deux insurrections du 10 août 1792 et du 2 juin 1793, ne veulent rien savoir du tournant politique rapide qui s’est produit. Ils sont poussés en avant par les exigences populaires sur le ravitaillement, à un moment où la voie semble ouverte pour une République démocratique. Ces militants et militantes que nous avons pris l’habitude d’appeler les Enragés, même s’ils ne se désignaient nullement ainsi, ont un vrai rôle d’animation dans les sections de Paris qui s’auto-administrent.
Jacques Roux, Jean Varlet et Théophile Leclerc, ou bien Pauline Léon[9] et Claire Lacombe, sont liés dans une vie politique sectionnaire qui prend toujours plus d’ampleur, avec toute la variété des sociétés qui font le lien entre le club des Cordeliers et la «gauche» de celui des Jacobins. Curé militant de la section des Gravilliers, Roux est également membre de la municipalité parisienne qui l’a délégué à l’exécution du roi, en janvier 1793. Par ailleurs, entre février et mai 1793, s’est constituée la société des Républicaines révolutionnaires, expérience profondément originale d’une association féminine à la fois radicale et implantée dans la population laborieuse. Les Enragés ne sont pas un groupe politique constitué mais un réseau de porte-parole. Roux, par exemple, intervient presque toujours en nom collectif et ne dit rien qui n’ait déjà été abondamment discuté dans une ou des sections, dans un ou des clubs ou sociétés. Il est cohérent en cela avec les sectionnaires pour qui la politique, c’est d’abord celle des assemblées de citoyens[10]. Or le mouvement des sections parisiennes exige depuis des mois l’interdiction du commerce de l’argent monnayé, de la spéculation qui joue contre l’assignat, de l’accaparement des denrées qui gêne l’approvisionnement.
Les radicaux ont donc bien d’autres soucis que la Constitution et n’engagent que très tard la bataille sur son contenu, se heurtant alors à forte partie. Le 20 juin, au club des Cordeliers[11], Roux propose d’adjoindre un article à la Déclaration : «La nation protège la liberté du commerce mais elle punit de mort l’agiotage et l’usure». Hébert, procureur de la Commune, l’appuie et propose d’aller chercher le soutien de la Commune. Le 21 juin, Roux demande à cette dernière dans quel chapitre de la Constitution l’agiotage et l’accaparement sont proscrits. «Qu’est-ce que la liberté quand une classe d’hommes peut affamer l’autre ? Qu’est-ce que l’égalité, quand le riche peut par son monopole exercer droit de vie et de mort sur son semblable ?» La Commune applaudit mais passe à l’ordre du jour. Roux revient à la charge devant les Cordeliers le 22 : «Les sangsues de ce bon peuple peuvent toujours boire son sang goutte à goutte à l’ombre de la loi». Appuyé entre autres par Varlet et Leclerc, il obtient la nomination d’une commission qui passe la nuit à produire une pétition pour qu’elle puisse être présentée dès le lendemain à l’Assemblée, car il y a désormais urgence, avant les votes.
La Convention consacre sa séance du 23 juin à l’adoption globale de la Déclaration des droits, avec le défilé des autorités venues l’en féliciter. Pour marquer son horreur de la guerre civile, elle renonce solennellement à la possibilité de recourir aux pouvoirs d’exception de la Loi martiale [12]. Roux et les commissaires demandent alors à présenter leur pétition. Si le texte qu’ils portent est proche de la Déclaration proposée en avril par Robespierre, tout a changé avec le renversement de la Gironde et la formation de la nouvelle majorité. Ils se heurtent à un blocage politique parfaitement délibéré. C’est précisément Robespierre qui intervient pour que la présentation soit reportée à un autre jour, afin que ce jour de fête ne soit pas consacré à des intérêts particuliers mais permette sereinement de scander l’achèvement de la Constitution, puisque le vote d’ensemble des textes est prévu le lendemain, 24 juin, et doit logiquement déboucher sur l’appel au vote des assemblées primaires.
Le 25 juin 1793, Jacques Roux n’intervient donc qu’une fois les textes adoptés, et tout se passe comme si la manœuvre de Robespierre, en retardant son intervention, permettait désormais de présenter Roux comme celui qui veut faire repousser la date de réunion des assemblées primaires et bloquer la procédure démocratique en relançant le débat. D’où un tollé général, une protestation mise en scène contre le prêtre intriguant, le fauteur de troubles, l’agent de l’étranger, celui qui ose comparer défavorablement le nouveau régime à l’ancien. Roux vacille sous la stigmatisation et ses amis semblent encore plus démoralisés. Ces rudes attaques marquent en fait la rupture de l’alliance des radicaux avec la gauche jacobine, qui fait cette fois front avec le reste de l’Assemblée. En demandant des mesures légales contre les spéculateurs, en défendant des principes de redistribution sociale, Roux s’exclut du nouveau cadre majoritaire.
Réunir un vote populaire massif sur la Constitution est l’objectif du jour. Robespierre, en maître tacticien, a utilisé Roux pour conforter la majorité, avec l’appui de Marat. Histoire de mettre les points sur les «i», il réattaque Roux le 28 juin aux Jacobins mais explique son choix politique en produisant une description grinçante de la nouvelle majorité de la Convention, qui ne s’était ralliée en juin que sous la menace de l’insurrection. Puisque les textes adoptés fixent le compromis admis, malheur à ceux qui s’en écarteront, à Roux, qui se suicidera en prison, comme à ceux qui le suivront mais aussi aux girondins récalcitrants.
C’est qu’à ce moment une majorité d’administrations des départements et des municipalités des grandes villes glissent vers l’insurrection en appuyant les dirigeants girondins fugitifs, en se fédérant contre le coup de force parisien. Contre cette réaction «fédéraliste», pour conjurer le risque de guerre civile, la rupture avec les enragés ne suffira pas : la Convention convoque les assemblées primaires par le décret du 27 juin. C’est là une décision politique majeure qui vise à placer l’ensemble des administrations devant leurs responsabilités : accepter ou refuser d’organiser le vote populaire c’est accepter ou refuser allégeance à la nouvelle majorité de la Convention. Pour les membres de cette Assemblée, cette procédure d’un vote direct des assemblées primaires, dans un pays menacé de guerre civile, est un saut dans l’inconnu, un risque à peine calculé. Alors, pour conjurer le péril, pour tenter de s’assurer du vote du pays rural, les députés finiront par adopter le 17 juillet, pendant les votes provinciaux, la grande loi de suppression totale des droits féodaux, une décision retardée depuis 1789 mais qui va avoir à son tour des effets immenses.
- Le vote populaire
Dix
mois après la réunion de la Convention, la République est menacée de
succomber sous les assauts militaires combinés des monarchies
européennes, de la révolte vendéenne et du début d’insurrection
girondine. Nous avons vu que l’Assemblée priorise pourtant une riposte politique, celle du «référendum», sans d’ailleurs que ce mot soit utilisé car on parle de vote populaire,
précisément pour ne pas le confondre avec des élections. En pratique,
le corps électoral s’est élargi lentement depuis août 1792, même s’il
reste en principe masculin, passant peut-être de 4 à 5 millions de
votants. Mais si les compétences politiques des révolutionnaires sont
remarquables, leurs connaissances statistiques ne le sont pas. Des
notions devenues aujourd’hui courantes leur sont étrangères, comme notre
usage quotidien des pourcentages, notre culture mathématisée qui nous
permet de lire directement les taux de participation en regard du nombre
d’inscrits, avec les taux d’abstention, significatifs ou non… La
Convention ignore d’ailleurs combien d’hommes ont pu bénéficier de
l’élargissement du droit de vote et, au-delà d’une réunion paisible des assemblées primaires,
elle n’a aucune idée de ce que devrait être statistiquement un «bon»
résultat du vote populaire qu’elle a lancé. Elle choisit un procédé
politique : par-dessus la tête des administrations départementales,
girondines, fédéralistes ou travaillées par les insurgés catholiques et royaux,
elle s’adresse aux administrations des 548 districts, des quelque 5 000
cantons et, au-delà, aux 44 000 municipalités ; il s’agit d’isoler la
bourgeoisie des capitales provinciales, rebelles.
Le vote populaire de 1793 est organisé du début juillet au début août, alors que les moissons mobilisent toute la population, un travail éreintant et vital. C’est un défi. Sitôt arrivés, les textes sont affichés et proclamés publiquement, dans des cérémonies d’information qui rappellent les pratiques de la royauté. Pourtant, même si une partie des citoyens se contentent d’assister aux proclamations, environ deux millions vont prendre une journée pour aller s’assembler au canton. C’est un succès qui ne sera pas de sitôt dépassé puisque entre 40 % et 45 % des ayants droit se déplacent[13], malgré les travaux. De surcroît, dans une centaine de cantons, des femmes essaient énergiquement de participer à des assemblées dont elles sont théoriquement exclues. Il ne s’agit pas seulement d’un résultat de la radicalisation en cours, à laquelle il serait absurde d’imaginer que des femmes ne participent pas, mais également des contradictions du système : pour beaucoup de gens, le fait de payer l’impôt conditionne encore l’exercice de la citoyenneté, comme en 1789-1792 ; les femmes, du moins quand elles sont veuves (et selon la démographie de l’époque, les veuves sont nombreuses) sont censées payer l’impôt. Or les municipalités craignent que, si on leur refuse le droit de vote, en particulier sur les questions locales, elles ne refusent de cotiser. Surtout, malgré le fait que les témoignages sont rarement ceux des femmes elles-mêmes, on comprend qu’il s’agit pour elles de démontrer qu’elles peuvent parfaitement s’assembler paisiblement, participer aux assemblées sans causer aucun trouble, qu’elles sont, comme nous le dirions, politiquement «responsables».

Réfléchir à cette présence des femmes, attestée par des documents dont elles sont rarement les auteurs, est une bonne introduction à la lecture des procès-verbaux des assemblées primaires[14] de l’été 1793. Sollicitées de donner leur vœu sur la Déclaration des droits et la Constitution, beaucoup d’assemblées tentent et parfois réussissent à s’accorder également sur des vœux, au pluriel, en fait des demandes qui sonnent, quatre ans plus tard, comme de nouveaux cahiers de doléances, ou des pétitions de masse émises par le Souverain : «Ce que nous pensons, ce que nous voulons». Il n’y a pas d’homogénéité politique ou sociale des vœux de l’été 1793, mais cette procédure largement improvisée témoigne de la puissance délibérative d’un peuple assemblé.
Les assemblées primaires s’emparent également de l’article du décret qui leur prescrit de choisir un citoyen qui sera envoyé porter directement leur vœu à Paris. Des centaines en profitent pour le charger de leurs vœux particuliers. Ces milliers d’envoyés de l’été 1793, véritables hommes de confiance des assemblées de citoyens, se rassemblent dans la capitale début août. Ils sont les élus récents, directs et nombreux d’un peuple qui avait élu, une longue année plus tôt et au suffrage indirect, une Assemblée aux effectifs limités et qui a déjà dû être épurée par la force. On comprend la méfiance dont la Convention entourera les envoyés.
- Deux représentations face à face
Lorsque
les délégations des assemblées primaires parisiennes viennent informer
la représentation nationale de leur vote d’adoption, il est de plus en
plus question d’une présence directe d’un Peuple-souverain. Le 3
juillet, alors qu’une délégation de Bondy se présente, le député radical
Billaud-Varenne souligne que «les citoyens qui sont ici faisant acte du souverain, je demande qu’ils soient reçus dans l’intérieur de la salle».
Les jours suivants, ces délégations viennent se placer dans l’espace
réservé aux députés. Le 8 juillet, le Montagnard Levasseur demande
l’admission d’une délégation de Versailles-hors-les-murs[15] et « que toute discussion finisse jusqu’à ce que le Souverain qui est ici soit entendu (murmures dans la salle)… J’ai voulu dire “membres du souverain”»,
rectifie Levasseur qui cherche à limiter son propos : signaler que le
Souverain s’exprime directement en face de la Convention, c’est
souligner que cette dernière est désormais en sursis, en attendant
qu’une autre Assemblée soit élue.
Un des animateurs des Enragés, Varlet, intègre de son côté les envoyés dans la vision démocratique radicale de sa Déclaration solennelle des droits de l’homme dans l’état social [16] dont la version finale s’adresse directement à eux. Varlet y propose (art. 23) aux envoyés de faire connaître les propositions de leurs assemblées primaires : «Lorsqu’une nation souveraine se constitue en état social, ses diverses sections envoient des députés revêtus de mandats explicatifs ; rassemblés en commun, ces fondés de pouvoir développent les intentions de leurs commettants, leur font des propositions de lois ; si la majorité les accepte, ces conventions forment un ensemble, nommé le contrat social.» Et, art. 24 : «Les lois sont l’expression de la volonté générale : cette volonté ne peut se connaître qu’en rapprochant, comparant, recensant les vœux partiels qu’émettent par sections les citoyens réunis en assemblées souveraines.»
L’Enragé Varlet présente les envoyés comme des fondés de pouvoir, dépositaires d’une autorité émanée des assemblées primaires souveraines mais, au même moment, Jacques Roux, autre Enragé qui a critiqué une Constitution qui ne protège que les riches, subit un véritable harcèlement judiciaire. L’isolement des Enragés s’accroît encore après l’assassinat, le 13 juillet, de Marat qui les avait durement attaqués. Roux et Leclerc, menacés, tentent séparément de donner des suites au journal de l’Ami du Peuple. Roux diffuse des appels virulents à faire de l’anniversaire du 10 août le tombeau des accapareurs et des concussionnaires, projet qui peut être compris comme celui d’assassinats en masse dans les prisons et évoque donc pour la Convention les très mauvais souvenirs de septembre 1792. Leclerc, de son côté, martèle les mises en garde contre le danger de la dictature, celle dont Danton vient de proposer d’investir le Comité de salut public[17]. Les Enragés sont l’objet de menaces de plus en plus précises mais seul Varlet semble à ce moment tenter de s’appuyer sur les envoyés.
Le 10 août 1793, les envoyés jouent un rôle central lors de la grande cérémonie qui marque l’achèvement du vote populaire, parvenant à modifier à leur profit le programme conçu par le peintre David. Ce succès ne les incite nullement à se séparer. Leur réunion à Paris apparaît bien comme une sorte de seconde représentation de la Nation, directe, nombreuse et récente. L’Assemblée et ses comités prennent les plus grandes précautions pour surveiller, encadrer et influencer la masse des envoyés. Leurs discussions avec les militants parisiens, dans le fourmillement des sociétés, clubs et sections, finissent par modifier les termes du débat public. Deux thèmes politiques majeurs et durables naissent de ces discussions : la «Levée en masse du peuple français» et la «Mise à l’ordre du jour de la Terreur». Contrainte et forcée, l’Assemblée accepte ces termes mais veille à ne jamais perdre la maîtrise des décisions pratiques.
Le compromis autour duquel s’était formée, début juin, la nouvelle majorité parlementaire, supposait explicitement que la Convention se sépare dès sa tâche accomplie et la Constitution adoptée. Après la cérémonie du 10 août, beaucoup de députés souhaitent effectivement rentrer chez eux mais tout se passe comme si le Comité de salut public, où Robespierre a été élu le 27 juillet, doutait du niveau d’approbation et de légitimité recueillies par la Constitution. Le total de quelque deux millions de votes, établi le 20 août par la commission qui les centralise, paraît très inférieur à ce qui était espéré. Le Comité de salut public préfère ne pas publier ce total, dont il ne comprend pas qu’il est un succès. Ce relevé est enfermé avec l’Acte constitutionnel, dans une Arche d’alliance symboliquement placée au-dessus de la tribune de l’Assemblée. Le vote a pourtant permis de renforcer la légitimité de la Convention, qui élit un Comité de salut public chargé désormais de faire face aux différents périls militaires.
- Du succès politique aux mesures de mobilisation
Si
les monarchies européennes restent militairement prudentes depuis leurs
échecs de l’été 1792, elles n’en sont pas moins à l’offensive. Elles
ont reconquis la Belgique en mai 1793 et occupent toute une partie nord
du territoire français, tout en marquant des points dans les Pyrénées et
les Alpes. Le meurtre de Marat, le 13 juillet, fait craindre la
multiplication d’assassinats «terroristes» organisés par les Girondins,
alors qu’une série de mouvements sectionnaires, bien encadrés dans
plusieurs grandes villes fédéralisée contre Paris, tournent à la
contre-révolution. Le Comité de salut public prépare donc activement la
campagne militaire qui s’avère nécessaire pour reprendre Lyon, Marseille
et le grand port militaire de Toulon, qui a entre-temps été livré à la
flotte anglaise, sans compter d’autres accrochages qui ne nous semblent
mineurs qu’avec le recul du temps.
Enfin, et peut-être surtout, l’été 1793 est le moment où l’insurrection vendéenne représente le danger stratégique maximal. Paroisse par paroisse, ses «compagnies» ont élu elles aussi leurs «capitaines» et recruté des officiers nobles. Elles passent très vite d’une activité de partisans à des raids sur les villes du bocage, puis à une offensive de grand style. L’Armée catholique et royale a pris Angers et tente fin juin de prendre Nantes. Victorieuse à Torfou, puis défaite à Cholet, cette armée passera la Loire le 18 octobre pour essayer de s’emparer d’un port breton qu’elle puisse ouvrir aux Anglais et aux nobles dont elle besoin pour s’organiser… La menace est plus que sérieuse mais, traînant à sa suite une foule de non-combattants, l’armée vendéenne divague en Bretagne, pillant pour se nourrir, ce qui mobilise contre elle les populations des zones côtières pour qui l’Anglais reste l’adversaire traditionnel. Les troupes républicaines sont donc sans cesse renforcées par l’afflux de gardes nationales[18].
Mais l’écrasement des Vendéens et la reprise des grandes villes du sud ne surviendront que plus tard : au lendemain du 10 août 1793, au moment où le Comité de salut public et la Convention doivent décider ou non de fixer les dates des nouvelles élections et de leur propre séparation, toutes les menaces militaires sont bien réelles et se combinent. La loi antiféodale du 17 juillet, la réussite du référendum comme processus politique novateur et le caractère démocratique de la Constitution qu’il a entériné ont permis de rassembler une majorité et d’isoler durablement les élites provinciales. Si le Grand comité ne comprend pas le sens des chiffres des votes, les excellents juristes qui siègent à la Convention comprennent fort bien que les milliers d’envoyés, avec leurs milliers de vœux, sont symptomatiques de la façon dont peut évoluer, à chaud, l’équilibre entre représentation et démocratie, du moins si on passe à l’application de la Constitution adoptée par le peuple.
Dans ce que les républicains appelleront ensuite, pudiquement, ces «circonstances», non seulement les résultats du vote ne sont pas publiés mais décision est prise de ne pas mettre immédiatement en activité la Constitution : les nouvelles élections municipales prévues sont suspendues et, pour plus de sûreté, les envoyés eux-mêmes sont envoyés se rendre utiles dans leurs cantons. Sans que jamais soit adopté le principe d’une dictature «à la romaine», le choix est fait d’aller vers un régime provisoire d’extrême recentralisation, capable d’impulser et d’organiser la mobilisation par la Levée en masse et de mettre à l’ordre du jour une forme de terreur qui reste sous le contrôle de l’Assemblée. C’est le mandat qui est élaboré entre la Convention et le Comité, par touches successives entre fin août et début décembre : toutes les élections sont en principe suspendues, même si les citoyens continuent à se réunir : le «Gouvernement est révolutionnaire jusqu’à la paix» et les représentants du peuple envoyés en mission épurent systématiquement les administrations locales. La Convention, qui a rencontré un éclatant succès politique, choisit de le prolonger par une forme de dictature de salut public.
- L’opposition des radicaux
À la fin d’août 1793, les Enragés parisiens ont commencé à comprendre ce qui se jouait, en particulier autour de la séparation des envoyés.
Le 26, dans une pétition à la fois terroriste et favorable à
l’organisation immédiate du gouvernement prévu par la nouvelle
Constitution[19], le club des Républicaines révolutionnaires écrit à la Convention : «Empressez-vous
surtout de prouver à la France entière, par des effets, que l’on a pas
fait venir à grands frais de tous les coings [sic] de la
république les envoyés d’un grand peuple pour jouer simplement une scène
pathétique au Champ de Mars ; montrez-nous que cette constitution que
nous avons cru accepter existe». Leclerc fait preuve d’une étonnante lucidité dans son Ami du peuple des 1er et 4 septembre, et il est utile de le citer un peu longuement :
Législateurs, vous nous avez donné une Constitution ; le Peuple français y a applaudi et l’a acceptée ; il attendait avec impatience les heureux effets qui devaient en résulter de son assentiment ; comme il s’est aperçu qu’elle n’était qu’imprimée, il a pensé que son exécution dépendait de quelque formalité à laquelle il ne s’était pas avisé de penser jusqu’alors. Il vient donc vous prier de l’accepter vous-même. Que répondriez-vous au souverain, s’il vous parlait ainsi ? Rien sans doute ; quand il se fait entendre c’est aux préposés à obéir et se taire ». Dans le numéro du 4 septembre : « On a avancé que si l’on se hâtait de convoquer les assemblées primaires, l’esprit public se trouvant corrompu dans quelques-uns de nos départements, le résultat de leur nomination serait détestable, la législature détestable, le conseil exécutif détestable. D’abord c’est insulter au peuple, c’est commettre un crime de lèse-nation, c’est calomnier les Français que de les supposer dans cet état d’avilissement et de corruption dans lequel il faudrait qu’ils fussent plongés en très grande majorité, pour nous donner cette législature, dont on cherche à nous épouvanter comme les enfants du loup-garou. En second lieu, c’est une atteinte portée à la vérité, puisque nous avons sous les yeux des preuves matérielles qui nous ont démontré que les Français n’étaient pas susceptibles de faire d’aussi mauvais choix que l’on a bien voulu le dire.
« Dites-moi, graves Législateurs, les envoyés des assemblées primaires, députés immédiats du peuple pour l’acceptation de la Constitution, étaient-ils aussi détestables ? Croyez-vous que les Français ne raisonnent pas sur leurs choix, étaient-ils des Brissotins, des Girondins, des Rolandins [20], les envoyés des assemblées primaires ? Non, législateurs, ils étaient presque tous d’excellents patriotes ; et ils vous ont prouvé aussi clairement qu’à nous que l’esprit public des départements n’était pas aussi détérioré que quelques hommes, qui les ont calomniés par complaisance pour d’autres, avaient osé l’avancer. En troisième lieu : cette assertion ridicule semble dire au peuple entier : la Nature a fait un effort lorsqu’elle a produit les membres qui composent la Convention nationale, le peuple français s’est dépouillé de ce qu’il avait de plus pur, de plus vertueux, de plus savant pour la former, et toute la sagesse humaine, tous les talents possibles s’y trouvant renfermés, on ne pourrait avec les meilleures intentions du monde, créer une législature qui vaille la Convention actuelle. Je laisse à l’opinion publique, je laisse à la postérité à faire justice de cette gasconnade.
Leclerc insiste donc sur les ressources démocratiques inépuisables que symbolisaient les envoyés, désormais dispersés. Il reviendra inlassablement sur la question jusqu’à la disparition forcée de son journal [21] mais ce n’est pas seulement le minuscule courant des Enragés
qui va être balayé par la mise en place du Gouvernement
révolutionnaire : dès l’automne, les mesures de remise en ordre
commencent à s’appliquer aux sections parisiennes, en commençant par les
formes de la participation politique féminine.
- Remise en ordre, mobilisation pour la guerre et mouvements populaires
Le
Comité de salut public n’était rien de plus au départ qu’un collectif
d’une douzaine de députés choisis par la Convention et responsables
devant elle ; il a désormais comme priorité de mobiliser toutes les
ressources pour rétablir la situation militaire et, fait qui n’est pas
banal, il va y parvenir en un an. La brutalité pointilleuse de ce régime
centralisé va s’appliquer à tous les secteurs, en disciplinant l’action
des administrations et en déférant systématiquement les opposants au
Tribunal révolutionnaire dans des procès expéditifs où sont mélangés
toutes sortes de gens, opposants ou supposés tels. Il n’est pas utile
ici de détailler la façon dont ce Gouvernement révolutionnaire
met sous tutelle la Commune de Paris, les sections parisiennes puis les
sociétés sectionnaires, entre septembre 1793 et juillet 1794 : c’est un
sujet sur lequel existent de nombreux ouvrages détaillés. Il est par
contre nécessaire de comprendre qu’au plan national, même pendant cette
« dictature de salut public », et malgré sa surveillance administrative,
ses mesures policières, ses recours au Tribunal révolutionnaire et à la
guillotine, les citoyens ne perdent pas une occasion de se réunir. Les
rapports de police et les procédures qui sont parvenus jusqu’à nous
témoignent de leur inégale adhésion aux mesures de contrainte, voire de
leur insolence. Malgré la Terreur, les formes démocratiques de la
politique héritées des années précédentes résistent plutôt bien, prêtes à
ressurgir.
Mais le cadre a changé ; à la campagne, l’application de la loi du 17 juillet 1793 sur la totalité des droits féodaux a sonné la fin de l’alliance antiseigneuriale qui avait succédé en 1791-1792 au tiers état de 1789. Désormais les luttes sociales à la campagne ont radicalement changé de cadre, alors que des agents du gouvernement mais aussi des escouades de militants urbains [22] parcourent les villages pour réquisitionner les stocks de grain pour les villes et les armées… C’est la lutte de tous contre tous pour l’appropriation des bénéfices de la Révolution. Affrontements autour des anciennes règles collectives de culture et de glanage, spéculation foncière sur les anciens biens du clergé et des émigrés, batailles sur le partage des anciennes rentes seigneuriales et ecclésiastiques, conflits salariaux… Les paysans les plus pauvres n’ont toujours pas obtenu de limitation de la taille des grandes fermes, et encore moins des propriétés, mais ils ne savent évidemment pas qu’il n’en est plus question et ils continuent à se battre.
Les quatorze armées de la République sont renforcées par la Levée en masse où se combinent levées d’hommes, mobilisation économique et contrôle des prix. Elles seront opérationnelles au printemps 1794. Le Comité de salut public, qui a la main sur les fabrications de guerre, cherche à y instaurer une réelle discipline industrielle, ce qui le mène à l’affrontement avec les sections urbaines. À Paris, au printemps 1794, le prix maximum du pain et des denrées indispensables est doublé d’un maximum des salaires, qui détourne les travailleurs parisiens de tout soutien à l’équipe du Comité de salut public.
La victoire de Fleurus, début juillet 1794, montre que la situation militaire a commencé à basculer. Une bonne partie de la population croit que la Constitution de 1793 va donc être mise en application. D’amples manifestations populaires se produisent en ce sens, mais le Comité de salut public ne veut pas en entendre parler et réprime ces gestes collectifs. Dans la Convention, tous ceux qui ne supportent plus la politique de Terreur s’accordent alors secrètement pour préparer le renversement du Grand comité, un changement de majorité qui ne peut se faire sans affrontement mortel. Les 25-26 juillet 1793 (8 et 9 thermidor an II), l’équipe robespierriste est mise en minorité à la Convention. Une partie de ses dirigeants s’échappent et tentent de soulever la Commune et les sections, ou du moins ce qui en reste après les épurations et la mise en tutelle. La réponse des sections est claire : leur grande majorité appuie la Convention, légitime, et le retour à la légalité constitutionnelle. Les robespierristes sont mis hors la loi et immédiatement envoyés à la guillotine mais leur exécution n’entraîne pas de retour à la Constitution démocratique : la « quatrième révolution » est une journée de dupes.
Le Gouvernement révolutionnaire est prorogé, avec un nouveau Comité de salut public, mais d’orientation économique ultralibérale. Les sections et les sociétés sectionnaires qui avaient connu la tutelle bureaucratique du Comité vont connaître la dictature du marché : le régime de garantie des prix maximum est démantelé, la monnaie révolutionnaire s’effondre, le terrible hiver 1794-1795 voit le retour de la disette et les suicides de désespérés qui se jettent à la Seine [23].
- Une lente normalisation
La
situation n’est pas stabilisée, malgré la réapparition d’une société de
nantis et de nouvelles fortunes, malgré la violence des bandes de la
jeunesse dorée qui, à leur tour, font résonner leurs gros bâtons sur le
pavé parisien. Les militants sans-culottes sont toujours là et se
réorganisent. La Convention réintègre les Girondins vaincus en juin 1793
et, en se débarrassant des terroristes les plus compromis, se
fixe deux objectifs. Elle programme un affrontement final avec les
sections parisiennes, provocant délibérément les tentatives
d’insurrection du printemps 1795 (germinal puis prairial) dont
l’écrasement lui permet d’occuper militairement les quartiers populaires
de l’Est parisien pour enfin désarmer les militants sans-culottes. Au
plan politique, il s’agit alors de remplacer la Constitution de 1793,
acceptée par le peuple mais jamais officiellement mise en application,
par un texte beaucoup plus proche du modèle représentatif, cette fois sans aucune concession à la démocratie. Mais l’esprit dominant est tel que la Convention doit pour cela organiser à nouveau un vote populaire,
dans les formes… Ce vote a lieu en octobre 1795, à la fin de l’an III,
et conserve la forme d’un vote de citoyens assemblés, ce qui confirme
que cette façon de voter reste admise par tous : non seulement par les
patriotes mais également par une large partie des modérés, favorables
non au retour d’un roi mais à une défense rigoureuse des propriétés et
des propriétaires, les honnêtes gens. Si le camp républicain a
éclaté pendant l’expérience de 1794, ses adversaires sont eux aussi
profondément divisés, et l’utilisation – ou non – des institutions du
vote pour reprendre le pouvoir est un des points de rupture avec ceux
des monarchistes qui rêvent de reconquête militaire.
Cet imbroglio apparaît dès le vote d’octobre 1795 : la participation est nettement inférieure à celle de 1793, avec environ un million cent mille votes, mais le retard dramatique des moissons, en particulier dans l’Est, explique probablement cette baisse autant que les abstentions proprement politiques et les exclusions de militants. Les vœux sont également beaucoup moins nombreux qu’en 1793 mais les votants doivent également donner un avis sur la prolongation du mandat des deux tiers des conventionnels. Sur cette question ultrasensible du maintien de l’essentiel des députés sortants, la droite monarchiste se sent en capacité de tenter à son tour un coup de force. Elle conteste les résultats, effectivement manipulés, et déclenche une insurrection, ressoudant en riposte les rangs des républicains, qui vont jusqu’à faire libérer de prison et réarmer une partie des cadres politiques de la sans-culotterie, pour écraser les insurgés.
Ce jeu du renversement permanent des alliances politiques va se répéter pendant les quatre années que va durer le régime nouveau, dit du Directoire ou de la Constitution de l’an III, que des lois de police rigoureuses interdisent de contester ouvertement. Mais les militants de tous bords ont accumulé depuis 1789 une énorme expérience et savent manœuvrer. Dans ce qui tente d’exister comme une démocratie représentative (l’association des deux termes apparaît à ce moment), la vie politique reste caractérisée par la fréquence des élections, toujours en assemblées de citoyens, même si la fréquentation est en forte baisse, même si les exclusions se multiplient et même si c’est sous l’autorité d’une administration d’État inquisitrice coiffée par le Directoire, une sorte de présidence collective tournante.
Pour sa part, le radical Gracchus Babeuf a rapidement improvisé une façon de contester la légitimité [24] de cette Constitution. Dès le 6 novembre 1795, dans le numéro 34 de son Tribun du Peuple, il propose une comparaison des neuf cent mille votes alors recensés [25] avec les résultats de 1793, pourtant jamais publiés. Il affirme que le texte de 1793 avait reçu quatre millions huit cent mille voix. Ce chiffre découle d’une simple évaluation, à partir de l’effectif des 8 000 envoyés des assemblées primaires de l’été 1793, en supposant le nombre de citoyens par qui ils auraient été mandatés, les suffrages de 600 citoyens représentant le maximum prévu par assemblée primaire dans la Constitution de 1793. Ce résultat est évidemment très exagéré mais, massif à défaut d’être vrai [26], il lui paraît suffisamment vraisemblable pour fonder la légitimité supérieure qu’il veut défendre.
Le calcul improvisé par Babeuf en novembre 1795 est le premier à faire une démonstration chiffrée sur la légitimité politique supérieure obtenue par un texte donné. Au début de 1796, dans le contexte de la Terreur blanche, il se forme autour du journal de Babeuf, le Tribun du Peuple, un courant qui réunit d’anciens militants sans-culottes et d’anciens conventionnels et qui met en avant la référence à la Constitution de 1793. À mesure que ceux qui se désignent comme les Égaux précisent leur projet clandestin d’un mouvement insurrecteur, avec la formation d’un directoire secret et le projet d’un nouveau Gouvernement révolutionnaire, ils basent leur propagande sur le texte de 1793 dont ils défendent ouvertement la légitimité. Il semble vraiment que le raisonnement de Babeuf, sur la légitimité supérieure acquise par la supériorité arithmétique des votes, ait contribué à unifier les rangs de cette conspiration pour l’égalité, puisque ses publications le reprennent abondamment.
Babeuf et ses amis contribuent à imposer dans l’opinion non pas tant leurs chiffres que l’usage public, à grande échelle, d’une comparaison des résultats des votes directs. L’innovation est de taille, même s’il leur a fallu pour cela reconstituer – inventer – un des deux résultats, besoin qui découlait directement de la décision du Comité de salut public de 1793 d’enfermer dans l’Arche les résultats du vote, devenus secret d’État. Implicitement, le calcul de Babeuf pointe ce que serait l’élargissement républicain du droit de vote, tendant à ce qu’on appellera plus tard le suffrage «universel». À cette époque, ce genre de conceptions démocratiques est défendu ouvertement par un Antonelle, un Lanthenas ou un Paine.
Le Directoire ne peut opposer qu’un profond silence aux allégations des babouvistes, car tout démenti l’obligerait à ordonner une publication des chiffres de 1793, que les rares initiés savent effectivement supérieurs aux résultats officiels de 1795. En soulignant l’écart, ceux qui emploient de bonne foi le chiffre fabriqué par Babeuf ont donc en partie raison… Avec tous les risques que cela peut comporter pour eux car la grande loi de police du 16 avril 1796, opportunément adoptée quelques jours avant l’arrestation de Babeuf et de ses associés, voue à la peine de mort les «auteurs» de discours et imprimés qui «provoqueront au rétablissement de la royauté, ou celui de la constitution de 1793 ou celui de la constitution de 1791, ou de tout gouvernement autre que celui établi par la Constitution de l’An 3, acceptée par le peuple, ou l’invasion des propriétés publiques, le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière…» Si tous les opposants sont visés, ceux qui prônent à la fois le retour à la Constitution de 1793 et une réforme des propriétés sont évidemment ciblés en priorité.
Arrêtés le 10 mai 1796, Babeuf et ses amis sont jugés en 1797 par une Haute cour, réunie à Vendôme. Pendant ce procès politique majeur, les références sulfureuses à l’ancienne Constitution et à son vote majoritaire reviennent constamment dans les débats et la presse… On grave une estampe inspirée d’un dessin de Charles Monnet [27], représentant la cérémonie inaugurale du 10 août 1793, qui est amplement diffusée et commémore ouvertement le premier vote populaire. À Vendôme, l’inculpé Philippe Buonarroti affirme devant ses juges que la Constitution de 1793 est «demandée à grands cris» par le peuple et rappelle les «grandes assemblées » populaires que ce texte «consacrait». Sa démonstration, comme le témoignage d’Antonelle, s’appuie encore et toujours [28] sur les calculs de Babeuf et ses 4,8 millions de votants. Jusqu’au bout de leur aventure, les babouvistes auront diffusé ce credo démocratique quantifié, dont ils paraissent avoir été les inventeurs.
Après le procès de Vendôme et l’exécution de Babeuf, il reste aux démocrates survivants à tirer leur bilan et à acter la dégradation des rapports de force : avec prudence, ils font désormais référence aux «constitutions acceptées par le peuple» et, de plus en plus souvent, à celle de 1795 comme devant maintenant être, elle aussi, défendue contre la réaction militante. Ce changement d’optique entraîne d’âpres querelles de programme parmi ceux que les historiens désignent comme des néojacobins. Ces derniers, tout comme les honnêtes gens monarchistes qui rêvent d’une restauration en douceur, peuvent bien rêver à une impossible révision de la Constitution de 1795. Les détenteurs du pouvoir s’en émancipent en organisant, après chaque élection, des coups d’État parlementaires par lesquels ils « épurent » les votes des assemblées électorales. L’armée, exécutante et finalement arbitre de ces coups d’État du Directoire, finira par s’emparer elle-même du pouvoir.
Cette armée construite pendant la Révolution restera la principale force européenne pendant quelque vingt ans. Elle pille durement les pays envahis et y commet les pires horreurs (voyez les dessins de Goya) mais, avec son fonctionnement interne basé sur l’égalité juridique, sur l’avancement au mérite, sur l’élection des cadres par la base ou par les pairs, la base de cette contre-société militaire n’est comparable à aucune de celles que lui opposent les rois, et qu’elle bat régulièrement. Ses succès reposent fondamentalement sur la dynamique d’un nouveau régime social et politique, autoritaire mais efficace. Le pronostic qu’avait porté Robespierre se vérifie, même si c’est huit ans plus tard ; s’opposant presque seul à la déclaration de guerre, il en avait signalé les conséquences ultimes : la militarisation nécessaire pour gagner la guerre sera, en dernière instance, contradictoire avec la démocratie.
Le général victorieux qui organise le coup d’État militaire du 2 décembre 1799 juge toujours indispensable de proposer à la population un vote politique direct sur une Constitution nouvelle, même si son frère, Lucien Bonaparte, ministre de l’Intérieur, est chargé à tout hasard de truquer les chiffres (qui seront plus que doublés). Mais l’interdiction des votes tenus en assemblées de citoyens est aussi essentielle au régime napoléonien que l’application stricte des lois Le Chapelier de 1791, que l’instauration du Livret ouvrier, que la création du Franc-germinal (Franc-Or) ou de la Banque de France ...
Ce cadre sera maintenu pendant tout le XIXe siècle, mais le bonapartisme sépare surtout, et radicalement, les deux composantes essentielles de la vie politique révolutionnaire ; d’un côté les assemblées de citoyens sont réduites à la clandestinité, où végète pour longtemps le droit d’association ; de l’autre, le droit de vote direct des citoyens est confisqué sous la forme du plébiscite, soigneusement encadré, pendant que se mettent en place des élections contrôlées, réservées à de toutes petites minorités de notables.
Si le vote en assemblée réapparaît plus ou moins lors des changements de régime, en 1830 et 1848, le droit d’association s’en détache de plus en plus, jusqu’à la formation du premier mouvement ouvrier qui en fait son horizon avec l’association des producteurs, mais qui se pose, au départ, en dehors de la politique.
- Eux et nous
Les succès qui marquent le «premier référendum», ou plutôt les premiers votes populaires
directs et décisoires, sont intimement liés aux élargissements
successifs des fonctions politiques exercées par les assemblées de
citoyens, depuis les premières réunions délibératives de 1789 qui
choisissaient leurs doléances. La mise en place, à partir de
1790, d’une incroyable variété d’institutions élues, puis l’accumulation
d’essais de votes citoyens décisoires en 1792, font que le vote
constituant de 1793 reprend tout ou partie de chacune de ces
expériences. Les essais de participation féminine ou les discussions qui
abordent une foule de préoccupations de l’heure entourent l’adoption
d’une Constitution qui, de droit comme de fait, est à la fois démocratique et représentative.
En ce sens, ce vote apparaît comme une sorte de synthèse de la façon dont les citoyens ont pu, dix années durant, exercer leurs droits dans des assemblées de tous types. Cette expérience exceptionnelle, presque unique à cette échelle, fixe le statut qu’aura ensuite, un bon siècle durant, la Constitution de 1793. Largement diffusée en brochure, elle est constamment rééditée et devient LE texte de référence des démocrates, ou plutôt le projet commun des révolutionnaires et des démocrates. Pourtant, elle se sépare, même dans ces milieux restreints, de la mémoire concrète des assemblées délibératives de 1789 à 1799.
Le droit d’association lui-même naît au XIXe siècle de la capacité d’un groupe d’habitants ou de résidents à exercer leur propre portion de souveraineté et affirmer ainsi leur citoyenneté au quotidien. La conception d’un peuple capable de s’assembler ne s’est que très lentement effacée, et bien plus tard. Dans cette transmission, forcément partielle, nécessairement déviée, obligatoirement reformulée, l’importance des transgressions sociales de la Révolution et celle des formes pratiques de l’exercice de la citoyenneté se sont «calées» sur des souvenirs majeurs : celui du jugement d’un roi par une Assemblée élue pour le faire, et de son exécution, celui de la façon dont le peuple français, assemblé et délibérant, a fini par se constituer comme un nouveau Souverain.
Bien entendu, toute l’énergie employée ensuite pour gommer ce moment fondateur, toutes les tentatives faites par les dominants, du Consulat à l’Empire et à la Restauration monarchique pour banaliser voire pour effacer ce double moment du tyrannicide légal et son remplacement par une République ont eu des effets. En ramenant la Révolution à un festival de violences et de spoliations, on a consolidé la formation d’une tradition proprement contre-révolutionnaire. C’est là l’origine même des traditions politiques opposées, dont nous pouvons voir quotidiennement qu’elles ne sont pas mortes.
Il est clair que la population de la France entretient un rapport bien particulier avec le souvenir de la Grande révolution. Des preuves ? N’importe quel professeur du secondaire qui entreprend un cours sur la Révolution constatera, parfois avec surprise, l’étendue des convictions des élèves sur ce point, même si leurs familles sont issues d’une immigration, ancienne ou bien récente. Et lorsque, de nos jours, un gouvernement français quelconque, mis en difficulté par la population, suggère de recourir à la rédaction de cahiers de doléances, nous avons vu la quantité de précautions dont il l’entoure immédiatement.
Dans leur livre Ce cauchemar qui n’en finit pas (2016), Pierre Dardot et Christian Laval énoncent que «le néolibéralisme travaille activement à défaire la démocratie» (p. 43) et montrent qu’il ne s’agit nullement d’un passage en force ponctuel pour des mesures d’austérité provisoires mais bien d’un projet élaboré qui vide la démocratie de sa substance sans la supprimer formellement. Ils expliquent en effet que la gouvernance sociolibérale, au niveau mondial, exige de rompre totalement avec les «formalités» démocratiques. Dardot et Laval emploient le mot «démocratie» dans son sens le plus courant, celui qui est fondé sur des institutions électives, la délégation de pouvoir, la représentation, cette démocratie dont les gouvernants nous assurent tous les jours qu’elle justifie leur politique et qui se présente comme un compromis relativement indolore entre les classes. On peut avoir une autre conception, plus exigeante, de la démocratie, et réfléchir à ce qui en a fait dans le passé la force que nous revisitons ces jours-ci.
En France, depuis des décennies, les courants radicaux ont tendance à ne guère étudier la Révolution française. Réfléchir sur une révolution «bourgeoise» leur paraît un peu incongru au regard des tâches de l’heure. Mais renoncer à ce travail nous prive des ressources de beaucoup de débats anciens et c’est même, d’une certaine façon, favoriser les approches chauvines si fréquentes. Au point que la médiocre connaissance de la Révolution française par les militants radicaux en France a fini par devenir une… exception française. Les progressistes d’autres pays cherchent au contraire à l’étudier, continuent à lire ce qui paraît à son sujet et comprennent mal nos réticences, voire parfois notre ignorance.

 ______________
______________[1] S. Aberdam, S. Bianchi, B. Gainot et autres (ouvrage collectif), Voter, élire pendant la Révolution française, 1789-1799. Guide pour la recherche, seconde édition revue et augmentée, Paris, CTHS 2006, 494 p.
[2] Dans les colonies esclavagistes des îles à sucre, les assemblées de citoyens mettent au contraire en visibilité les inégalités raciales entre blancs, personnes libres de couleur et esclaves, et mettent ainsi en mouvement les terribles guerres qui entraîneront finalement la première abolition de l’esclavage (1794) puis l’indépendance d’Haïti (1804).
[3] En termes modernes, les départements des Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95).
[4] S. Aberdam, « Sur le maximum des fermes », État, finances et économie pendant la RF, Comité pour l’histoire économique et financière… Imprimerie nationale, 1991.
[5] Archives départementales des Yvelines : 1 LM 361, manuscrit et imprimé du PV ; pp. 150-161 de l’imprimé.
[6] V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la RF… éd. du Progrès, Moscou, 1987, pp. 402 et ss.
[7] Cette Adresse de Seine-et-Oise frappera plus tard Jaurès par sa hardiesse ; il y verra un Manifeste qui martèle les droits des travailleurs à la vie, dans l’affrontement entre ceux qui dépendent du prix du pain pour manger et ceux qui font des profits sur les farines.
[8] Les enjeux de ce partage dépendent évidemment de l’importance locale des communaux, et leur histoire ne s’arrêtera pas là.
[9] Cl. Guillon, Deux enragés de la Révolution, Leclerc de Lyon et Pauline Léon, La Digitale, Paris, 1993, 255 p.
[10] L’enragé Varlet avait insisté dans l’hiver 1792-1793 sur la nécessité de donner aux élus des mandats impératifs. Voir sa brochure de décembre 1792, Projet d’un mandat spécial et impératif…, Impr. du Cercle social ; Bnf : 8°Lb41 109, qu’il continue à diffuser en juillet.
[11] W. Markov, Jacques Roux, le curé rouge, Libertalia/SER, Paris 2017, CD-ROM annexé, Scripta et acta, p. 469.
[12] Le drapeau rouge est l’emblème officiel arboré quand on proclame la loi martiale, pour avertir qu’on va tirer !
[13] Il s’agit du premier vote pour lequel nous ayons une idée des taux de présence.
[14] Les Archives nationales conservent copie de milliers de ces PV, alors que la quasi-totalité des originaux, rédigés dans les cantons, ont disparu.
[15] Archives parlementaires, tome 68 (1905) , p. 437.
[16] Depuis la mi-mai, Varlet a présenté ses trente articles à l’assemblée électorale de Paris, puis à la Commune ; rééd. Edhis 1969 ; L. Jaume 1989, pp. 265-279 ; R. Gotlib, article « Enragés » dans A. Soboul, Dictionnaire historique de la RF, Paris, PUF, 1989.
[17] Commentaire de Jacques Roux dans son journal du 6 août, de Théophile Leclerc dans ceux des 4 et 8.
[18] En novembre, les Vendéens, mis en échec devant le port de Granville, reflueront vers le sud et seront à leur tour victimes d’une gigantesque et féroce battue exterminatrice. Ils retourneront à la guérilla.
[19] Arch. nat. C 267, 26 août, signée de Champion, présidente, Lacombe et Barrée, secrétaires.
[20] Brissotins, rolandins : partisans de Brissot, député girondin, de Roland, ministre girondin.
[21] Le dernier numéro porte le n° 24, daté du 15 septembre : «On avait demandé qu’on mette la terreur à l’ordre du jour, on y a placé le funeste esprit de vengeance et de haine particulière […]. J’attends à chaque instant la lettre de cachet qui doit me couper la parole », voir Cl. Guillon, 1993 (note 9).
[22] Ces groupes de militants portent le titre d’armées révolutionnaires mais ne relèvent pas d’un régime militaire. Voir les travaux de Richard Cobb.
[23] Richard Cobb, La mort est dans Paris, éditions Anacharsis, Toulouse, 2018.
[24] Il s’inspire aussi de la façon dont certains monarchistes ont contesté le détail des votes d’octobre.
[25] Le dépouillement est alors en cours, pour environ 1 100 000 au final.
[26] M. Dommanget, Sur Babeuf et la conjuration des égaux, rééd. Maspéro, Paris 1970, mis en ligne par Spartacus [une coquille, pp. 179-181, qui porte à 6 000 les votes par envoyé, rend incompréhensible le calcul de Babeuf].
[27] M. Vovelle, La Révolution française, Images et récit, Messidor, Paris 1986-1988, 5 vol., ici vol. 4, p. 142 : Collection des principales journées de la révolution…
[28] Débats et jugements de la Haute-cour séante à Vendôme…, Paris, Baudouin an V, t. 3, p. 217-222.
Source : https://unsansculotte.wordpress.com/tag/serge-aberdam/










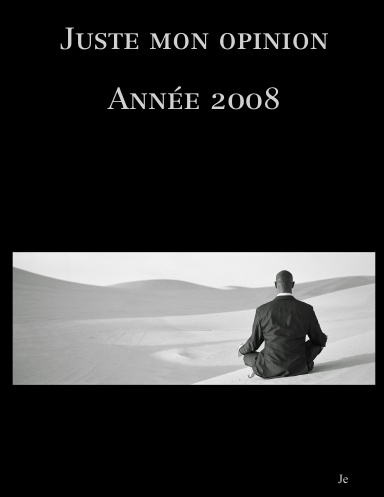
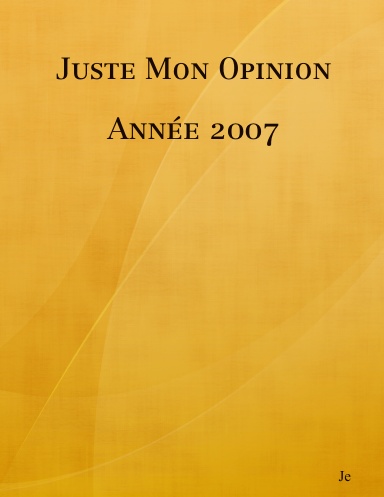

20 commentaires:
Ceux qui commencent à se nommer eux-mêmes des «citoyens» et parfois des «citoyennes» ne conçoivent pas leurs droits politiques comme uniquement liés au vote.
Ils tiennent tout autant à porter les armes, un privilège qu’ils sont tout juste en train d’arracher aux nobles en formant leurs propres Gardes nationales, et à leur droit à s’exprimer librement par pétition ou à lire une presse libre…
De plus, quand il s’agit d’élire, l’idée même de candidature est franchement suspecte : la conception admise est que celui qui convoite une place prouve par là-même qu’il en est indigne.
L’idée maîtresse, d’origine religieuse, est qu’au niveau d’une assemblée de voisins, chacun sait, en son for intérieur, qui mériterait d’être élu. C’est pourquoi, dès 1789, les élections se font sans candidatures.
Les citoyens une fois librement assemblés doivent-ils se borner à élire, ou bien peuvent-ils aussi exercer leur droit de délibérer sur les sujets de leur choix ? Les élites conçoivent ce débat comme celui entre la représentation et la démocratie.
Fréquence des votes, droit de délibérer en assemblées de base, brièveté des mandats, organisation militaire citoyenne : il y a une étrange proximité avec ce que nous pouvons imaginer comme une démocratie directe.
L’Assemblée constituante ne se considère nullement comme formée de démocrates chargés de mandats impératifs mais comme un collectif de représentants du peuple, investis des pleins pouvoirs. Elle se donne donc du mal pour annuler les mandats par lesquels les assemblées locales de 1789 avaient tenté de protéger les anciens privilèges des provinces, villes et corporations. Il s’agit pour l’Assemblée de construire un régime purement représentatif, c’est-à-dire où les citoyens auront comme tâche principale de choisir leurs représentants et où ces derniers auront toute la responsabilité du pouvoir, avec un roi ou bien, éventuellement, sans. Toutes les élections autres que celles de ces députés sont donc conçues comme des gestes administratifs, indispensables, mais pas comme des lieux de délibération populaire. Il n’est pas question de créer un régime où l’Assemblée des législateurs recevrait ses ordres des assemblées de citoyens. Une fois que les députés sont élus, les citoyens leur doivent un respect religieux.
Le 17 septembre 1792, Pierre Dolivier, curé d’Auvers, près d’Étampes, un militant radical relativement connu, propose d’imposer dans la nouvelle Constitution que soit organisée une discussion nationale sur chaque loi nouvelle.
Sa proposition amplifie les demandes des radicaux parisiens ; elle suppose un contrôle des assemblées locales sur l’action des députés et l’adoption du mandat impératif.
La proposition de Dolivier est repoussée ...
Le roi, condamné pour haute trahison, est exécuté le 21 janvier 1793. Par ce choix, la majorité des membres de la Convention assument leur statut de représentants. Ils fondent, d’une certaine façon, la légitimité politique de la bourgeoisie française.
La Convention crée en mars 1793 des comités de surveillance municipaux, chargés des tâches de police. Ces organes sont formés par élection directe de douze citoyens, dont sont exclus les prêtres, les nobles et leurs agents. Ces comités formeront une autorité locale efficace mais également rivale de celle des municipalités et des gardes nationales.
Pour la Constitution de 1793, il est rapidement admis que le futur régime devra combiner la représentation avec la possibilité pour les citoyens de trancher par eux-mêmes les choix majeurs ou qui les concernent directement.
Le schéma adopté articule donc représentation et démocratie avec un sérieux élargissement des droits politiques, dont les femmes restent cependant exclues.
Jacques Roux, Jean Varlet et Théophile Leclerc, ou bien Pauline Léon et Claire Lacombe, sont liés dans une vie politique sectionnaire qui prend toujours plus d’ampleur, avec toute la variété des sociétés qui font le lien entre le club des Cordeliers et la «gauche» de celui des Jacobins.
Curé militant de la section des Gravilliers, Roux est également membre de la municipalité parisienne qui l’a délégué à l’exécution du roi, en janvier 1793.
Par ailleurs, entre février et mai 1793, s’est constituée la société des Républicaines révolutionnaires, expérience profondément originale d’une association féminine à la fois radicale et implantée dans la population laborieuse.
Les Enragés ne sont pas un groupe politique constitué mais un réseau de porte-parole. Roux, par exemple, intervient presque toujours en nom collectif et ne dit rien qui n’ait déjà été abondamment discuté dans une ou des sections, dans un ou des clubs ou sociétés.
Il est cohérent en cela avec les sectionnaires pour qui la politique, c’est d’abord celle des assemblées de citoyens. Or le mouvement des sections parisiennes exige depuis des mois l’interdiction du commerce de l’argent monnayé, de la spéculation qui joue contre l’assignat, de l’accaparement des denrées qui gêne l’approvisionnement.
Le 20 juin, au club des Cordeliers, Roux propose d’adjoindre un article à la Déclaration : «La nation protège la liberté du commerce mais elle punit de mort l’agiotage et l’usure». Hébert, procureur de la Commune, l’appuie et propose d’aller chercher le soutien de la Commune.
Le 21 juin, Roux demande à cette dernière dans quel chapitre de la Constitution l’agiotage et l’accaparement sont proscrits. «Qu’est-ce que la liberté quand une classe d’hommes peut affamer l’autre ? Qu’est-ce que l’égalité, quand le riche peut par son monopole exercer droit de vie et de mort sur son semblable ?» La Commune applaudit mais passe à l’ordre du jour.
Roux revient à la charge devant les Cordeliers le 22 : «Les sangsues de ce bon peuple peuvent toujours boire son sang goutte à goutte à l’ombre de la loi».
La Convention consacre sa séance du 23 juin à l’adoption globale de la Déclaration des droits, avec le défilé des autorités venues l’en féliciter. [...]. Roux et les commissaires demandent alors à présenter leur pétition. Si le texte qu’ils portent est proche de la Déclaration proposée en avril par Robespierre, tout a changé avec le renversement de la Gironde et la formation de la nouvelle majorité. Ils se heurtent à un blocage politique parfaitement délibéré. C’est précisément Robespierre qui intervient pour que la présentation soit reportée à un autre jour, afin que ce jour de fête ne soit pas consacré à des intérêts particuliers mais permette sereinement de scander l’achèvement de la Constitution, puisque le vote d’ensemble des textes est prévu le lendemain, 24 juin, et doit logiquement déboucher sur l’appel au vote des assemblées primaires.
Un des animateurs des Enragés, Varlet, intègre de son côté les envoyés dans la vision démocratique radicale de sa Déclaration solennelle des droits de l’homme dans l’état social dont la version finale s’adresse directement à eux. Varlet y propose (art. 23) aux envoyés de faire connaître les propositions de leurs assemblées primaires : «Lorsqu’une nation souveraine se constitue en état social, ses diverses sections envoient des députés revêtus de mandats explicatifs ; rassemblés en commun, ces fondés de pouvoir développent les intentions de leurs commettants, leur font des propositions de lois ; si la majorité les accepte, ces conventions forment un ensemble, nommé le contrat social.» Et, art. 24 : «Les lois sont l’expression de la volonté générale : cette volonté ne peut se connaître qu’en rapprochant, comparant, recensant les vœux partiels qu’émettent par sections les citoyens réunis en assemblées souveraines.»
À la fin d’août 1793, les Enragés parisiens ont commencé à comprendre ce qui se jouait, en particulier autour de la séparation des envoyés. Le 26, dans une pétition à la fois terroriste et favorable à l’organisation immédiate du gouvernement prévu par la nouvelle Constitution, le club des Républicaines révolutionnaires écrit à la Convention : «Empressez-vous surtout de prouver à la France entière, par des effets, que l’on a pas fait venir à grands frais de tous les coings [sic] de la république les envoyés d’un grand peuple pour jouer simplement une scène pathétique au Champ de Mars ; montrez-nous que cette constitution que nous avons cru accepter existe».
[Après l'éviction de Robespierre] au plan politique, il s’agit alors de remplacer la Constitution de 1793, acceptée par le peuple mais jamais officiellement mise en application, par un texte beaucoup plus proche du modèle représentatif, cette fois sans aucune concession à la démocratie.
Ce vote a lieu en octobre 1795, à la fin de l’an III
Pour sa part, le radical Gracchus Babeuf a rapidement improvisé une façon de contester la légitimité de cette Constitution. Dès le 6 novembre 1795, dans le numéro 34 de son Tribun du Peuple, il propose une comparaison des neuf cent mille votes alors recensés avec les résultats de 1793 pourtant jamais publiés.
Arrêtés le 10 mai 1796, Babeuf et ses amis sont jugés en 1797 par une Haute cour, réunie à Vendôme.
Le pronostic qu’avait porté Robespierre se vérifie, même si c’est huit ans plus tard ; s’opposant presque seul à la déclaration de guerre, il en avait signalé les conséquences ultimes : la militarisation nécessaire pour gagner la guerre sera, en dernière instance, contradictoire avec la démocratie.
Le général victorieux qui organise le coup d’État militaire du 2 décembre 1799 juge toujours indispensable de proposer à la population un vote politique direct sur une Constitution nouvelle, même si son frère, Lucien Bonaparte, ministre de l’Intérieur, est chargé à tout hasard de truquer les chiffres (qui seront plus que doublés).
La Constitution de 1793, largement diffusée en brochure, est constamment rééditée et devient LE texte de référence des démocrates, ou plutôt le projet commun des révolutionnaires et des démocrates. Pourtant, elle se sépare, même dans ces milieux restreints, de la mémoire concrète des assemblées délibératives de 1789 à 1799.
Le néolibéralisme travaille activement à défaire la démocratie (et même la représentation).
Ce long article m'a appris que la Révolution de 1789 ne se limitait absolument pas à une prise de pouvoir par les bourgeois contre les aristocrates et le clergé. La démocratie directe a coexisté avec le régime représentatif voulu par la nouvelle élite; hélas sans réussir à s'imposer.
C'est la force armée, policière, qui a manqué. C'est pour cela que, dès les premiers extraits (recopiés dans les commentaires), j'ai mis en évidence la nécessité d'une garde nationale composée de citoyens indépendants d'un pouvoir centralisé. Il ne faut pas une force policière ou militaire coupée de la population; sinon, elle finira par la tyranniser.
Enregistrer un commentaire