Pour Reinert, le défaut majeur de Ricardo, et plus
généralement des théories traditionnelles du libre
échange, est de ne pas opérer de distinction entre
les activités à rendements croissants et les activités à
rendements décroissants. Leur tort est de faire comme
si toutes les activités étaient à rendements décroissants
et de ne pas prendre en compte l’existence d’activités
permettant des économies d’échelle. L’existence de
celles-ci était pourtant bien connue des économistes
qui ont précédé Ricardo, au moins depuis Xénophon
(427-355 av. J.-C.).
Bien que cet argument ne soit pas complètement nouveau, Reinert montre de manière particulièrement précise et claire que toutes les spécialisations ne se valent pas. Il souligne qu’un pays ne peut faire croître durablement son niveau de vie par habitant sans développer des activités à rendements croissants, c’est-à-dire les activités dont la productivité augmente avec la production. Ceci concerne l’industrie mais aussi certains services. Les pays pauvres sont ceux qui se sont spécialisés dans des activités à rendements décroissants, comme l’agriculture ou l’extraction de ressources naturelles. Dans ces activités, tôt ou tard, une augmentation des quantités produites entraînera une augmentation du coût moyen du fait de l’épuisement des terres ou des gisements.
Comme l’auteur le fait remarquer, « généralement les rendements croissants vont de pair avec une concurrence imparfaite » car les rendements croissants produisent un pouvoir de marché, ce qui permet d’accroître les profits et les salaires réels. À l’inverse, les rendements décroissants engendrent de la concurrence parfaite. Et, par conséquent, « les marchés parfaits sont pour les pauvres » car sur ces marchés, même si des gains de productivité sont réalisés, ils ne bénéficient pas aux producteurs sous forme de hausse de salaire mais aux consommateurs sous forme de baisse des prix. Or, pour Reinert, « les habitants des pays riches sont devenus plus riches en transformant les améliorations de la productivité sous la forme des salaires plus élevés plutôt que de prix plus bas ».
L’augmentation des salaires réels dans les activités à rendements croissants ne bénéficie pas uniquement aux travailleurs concernés mais se diffuse à l’ensemble des travailleurs qui partagent le même marché du travail. C’est parce qu’ils ont pu bénéficier de l’augmentation du pouvoir d’achat de leurs clients travaillant dans les activités à rendements croissants que les barbiers des pays riches ont des revenus incomparablement supérieurs à ceux des pays pauvres bien que leur productivité ne soit pas plus élevée. C’est pourquoi, pour Reinert, les innovations de produit n’ont pas du tout les mêmes effets que les innovations de procédé. Les premières tendent à créer une concurrence imparfaite et des salaires plus élevés, comme c’est le cas chez Microsoft. Alors que les secondes « tendent généralement à créer une concurrence de prix et de pression sur les salaires ». Lorsque les technologies de l’information sont introduites dans l’industrie hôtelière ou dans les transports aériens, « les résultats obtenus sont la baisse des marges pour les hôtels de Venise et de la Costa del Sol, et une baisse des salaires pour les hôtesses de l’air ».
Reinert réfute également les bienfaits de la spécialisation que prône Ricardo. Il montre que la diversité des activités économiques favorise le développement et la prospérité d’une ville ou d’une nation. Les économistes pré-ricardiens, comme Antonio Serra dès 1613, l’avaient établi et on le constate aujourd’hui encore : les villes les plus riches sont celles où la diversité des professions est la plus élevée. Cette diversité crée des effets de synergie et permet aux innovations de « sauter » d’un secteur à un autre. Les économies les plus avancées reposent toutes sur des activités diversifiées et ce sont les pays les moins avancés qui sont le plus spécialisés.
Les théories traditionnelles du commerce international adoptent un point de vue essentiellement scolastique, c’est-à-dire spéculatif et théorique, et ne reposent pas suffisamment sur l’observation attentive des faits économiques. L’intérêt de l’ouvrage de Reinert est qu’il s’appuie sur de nombreux exemples historiques qui permettent d’établir une véritable réfutation empirique des thèses des économistes classiques.
Il montre que, contrairement à la présentation caricaturale qu’en a faite Smith (et qui est encore aujourd’hui reprise dans de nombreux manuels), le cœur de la doctrine mercantiliste n’est pas tant de préconiser l’accumulation de métaux précieux que de plaider en faveur d’une action de l’État pour développer les industries manufacturières.
L’auteur met en évidence le fait que les pays dont les gouvernements ont mis en pratique cette doctrine mercantiliste en ont tiré de grands profits et que ceux qui y ont renoncé ont été distancés.
Il est rarement mentionné que l’Angleterre a mis en place un protectionnisme très strict dès le XVe siècle, sous le règne d’Henri VII, de manière à éviter que la laine des moutons britanniques ne soit tissée ailleurs que sur son propre territoire. De même, la prospérité du royaume de France doit beaucoup au développement des manufactures, en partie grâce à la politique colbertiste mise en place à partir du XVIe siècle. À l’inverse, les pays, qui comme l’Espagne, renoncèrent à pratiquer une politique industrielle, ou le firent trop partiellement et tardivement, ont vu leur industrie manufacturière décliner. Jusqu’au XVIe siècle, l’Espagne était renommée pour la qualité de son industrie textile : pour décrire la meilleure soie, on disait autrefois « de la qualité de Grenade », pour décrire les meilleurs textiles, « de la qualité de Ségovie ». Cette industrie avait presque entièrement disparu deux siècles plus tard, en partie parce que les monarques espagnols, sous l’influence des propriétaires terriens auprès desquels ils étaient endettés, protégèrent les activités agricoles et firent peser de lourds impôts sur les activités manufacturières.
On trouve beaucoup plus récemment des faits similaires concernant beaucoup de pays de l’ancien bloc soviétique à la fin de la guerre froide, lorsqu’ils subirent la « thérapie de choc ». L’exemple le plus frappant concerne la Mongolie, qui lorsqu’elle était sous domination soviétique avait lentement, mais avec un relatif succès, bâti un secteur industriel diversifié. La part de l’agriculture dans le PIB n’était plus que de 16 % en 1980 contre 40 % en 1940. À la suite de l’ouverture brutale de son économie sous les conseils du FMI et de la Banque mondiale, le secteur industriel de la Mongolie fut presque entièrement détruit entre 1991 et 1995. La baisse de production industrielle fut de l’ordre de 90 %. Cette désindustrialisation provoqua un chômage de grande ampleur et beaucoup de gens furent contraints de revenir à leur mode de vie ancestral : le pastoralisme nomade. Mais celui-ci ne pouvant nourrir une population nombreuse, un grand nombre prirent le chemin de l’exil. Dans de multiples cas, les pays qui abaissent brutalement leurs barrières douanières le font sous la contrainte, par exemple à la suite d’une conquête militaire. Ceci s’applique en particulier aux pays colonisés à qui la métropole, dans la plupart des cas, a interdit toute industrialisation et imposé la spécialisation dans la production de produits primaires ou, dans le cas de l’Inde, ruiné l’industrie textile en lui imposant le libre-échange. La même contrainte est aujourd’hui exercée par les institutions de Washington lorsque des pays en difficulté sollicitent leur financement. Il est frappant de constater que les pays qui prônent officiellement le libre-échange n’ont pas appliqué et, dans une certaine mesure, ne s’appliquent toujours pas à eux-mêmes les principes qu’ils préconisent pour les autres. Si les économistes de l’école de Chicago proclament à la face du monde que les États et les gouvernements locaux ne devraient pas intervenir dans l’économie, cela n’empêche pas le maire de Chicago de dépenser des millions de dollars de fonds publics pour des incubateurs d’industries de haute technologie.










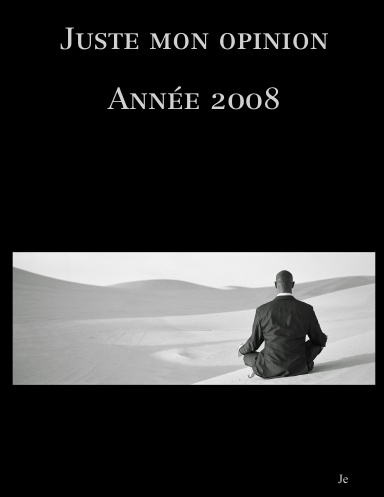
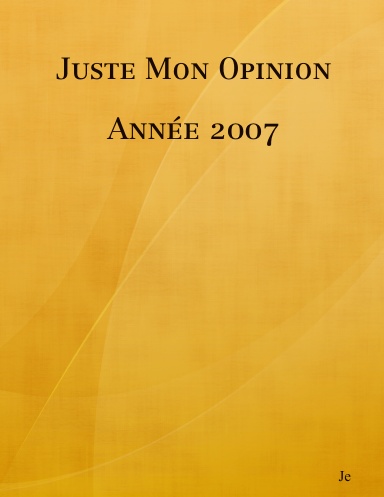

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire