
Prisonniers du camp de concentration installé dans les écuries du palais de la Magdalena (province de Santander).
Pour les putschistes, la guerre civile tenait peu, en bien des aspects, de la guerre classique mais beaucoup plus du nettoyage idéologique. Ainsi, les camps de concentration franquistes sont nés vingt-quatre heures à peine après le coup d’Etat, dans le cadre d’un « plan préconçu par les rebelles » avec pour objectif de « semer la terreur et d’éliminer l’adversaire politique ». Le général Franco lui-même a dit que dans une guerre comme celle que vivait l’Espagne « une occupation systématique du territoire, accompagnée d’un nettoyage nécessaire » était préférable à une victoire militaire rapide « qui laisserait le pays infecté d’adversaires ».
Ainsi, l’idée la plus répétée fut celle du « nettoyage ». « Nettoyez cette terre des hordes sans patrie et sans Dieu », dira José María Pemán, un intellectuel et propagandiste des rebelles. Le général Mola, dans ses directives avant le coup d’Etat, appelait à « l’élimination des éléments de gauche : communistes, anarchistes, syndicalistes, maçons… ». Ce général navarrais avait souligné son objectif : « l’extermination des ennemis de l’Espagne ». L’attaché de presse de Franco, Gonzalo de Aguilera, avait de fait chiffré ce « nettoyage ». Selon ses calculs, il fallait « tuer, tuer et tuer » jusqu’à « se retrouver avec un tiers de la population masculine de l’Espagne ».
 La
première étape de ce « nettoyage » fut la création de camps de
concentration. Durant les premiers mois de la guerre, chaque commandant
militaire de chaque province et chaque général commandant une unité
ouvraient des camps sur le territoire relevant de leur responsabilité.
Ce n’est qu’à partir de juillet 1937, avec la création par Franco de
l’Inspection générale des camps de concentration de prisonniers (ICCP),
qu’une « gestion centralisée » commença. Mais l’impact de cet ordre de
Franco, cependant, resta limité. Tous les généraux voulaient faire la
loi dans leurs camps de concentration respectifs. Et dans ces camps il n’y avait pas de prisonniers de guerre. Non. Il y avait des « hors-la-loi », des « hordes de délinquants » et des « animaux ». Le franquisme niait à ses ennemis jusqu’aux droits de la Convention de Genève.
La
première étape de ce « nettoyage » fut la création de camps de
concentration. Durant les premiers mois de la guerre, chaque commandant
militaire de chaque province et chaque général commandant une unité
ouvraient des camps sur le territoire relevant de leur responsabilité.
Ce n’est qu’à partir de juillet 1937, avec la création par Franco de
l’Inspection générale des camps de concentration de prisonniers (ICCP),
qu’une « gestion centralisée » commença. Mais l’impact de cet ordre de
Franco, cependant, resta limité. Tous les généraux voulaient faire la
loi dans leurs camps de concentration respectifs. Et dans ces camps il n’y avait pas de prisonniers de guerre. Non. Il y avait des « hors-la-loi », des « hordes de délinquants » et des « animaux ». Le franquisme niait à ses ennemis jusqu’aux droits de la Convention de Genève.Mais combien y eut-il de camps de concentration dans l’Espagne de Franco ? Il y a deux réponses à cette question. La première réponse vient de Carlos Hernández, également auteur du livre Los Españoles de Mauthausen : « Il n’y en eut qu’un seul et il s’appelait Espagne. L’ensemble de la nation, à mesure que son territoire était conquis par les troupes rebelles, est devenu un gigantesque camp de concentration. Une enceinte dans laquelle, dans un premier temps, tous ses détenus étaient coupables. » La deuxième réponse est fournie par l’auteur dans son enquête exhaustive : 296 camps de concentration répartis dans tout l’Etat, avec l’Andalousie et la région de Valence en tête de ce classement de l’infamie. Le premier d’entre eux, en effet, s’est ouvert à peine quarante-huit heures après le coup d’État des 17 et 18 juillet à Zeluán, à 25 kilomètres au sud de Melilla, dans l’ancien protectorat du Maroc, d’où fut lancé le coup d’Etat. Le terrain de football du Vieux Chamartín, où jouait le Real Madrid, devint aussi un camp de concentration. Ainsi que le Stadium Metropolitano, où l’Atlético de Madrid a joué ses matches jusqu’en 1966. Les arènes de la plupart des localités du pays, comme Las Ventas (Madrid), Alicante, Manzanera à Logroño ou Baza, à Grenade, furent converties en camps de concentration. De nombreux édifices religieux furent également utilisés à cette fin. Des exemples ? Le monastère de San Salvador à Celorio (Asturies), le monastère de La Merced à Huete (province de Cuenca), le monastère de La Caridad, à Ciudad Rodrigo (province de Salamanque) ou le monastère de San Clodio, à Orense, transformé aujourd’hui en hôtel avec spa.

Prisonniers obligés de faire le salut fasciste dans le camp de concentration d’Irún (province de Guipúzcoa).
Le premier objectif de ces camps, en plus de semer la terreur parmi la population, était de classer les captifs. Pour ce faire, trois catégories furent créées : les « assassins et hors-la-loi ou ennemis de la patrie espagnole », qui devaient être fusillés ou condamnés à de longues peines ; les « vauriens fourvoyés », qui pouvaient être « rééduqués par la soumission, l’humiliation, la peur et les travaux forcés » ; et enfin, les « simples frères », considérés comme favorables au Mouvement national et qui furent libérés ou intégrés dans l’armée franquiste.
Les exécutions, de fait, se déroulèrent sans aucun contrôle au cours des premiers mois. Par la suite, des procès sommaires furent organisés au cours desquels on condamnait à mort vingt ou trente prisonniers à la fois. Mais en plus d’être le théâtre d’une « sélection idéologique » et un « lieu d’extermination », les camps ont aussi servi de lieu de « rééducation ». « Franco avait parié sur l’élimination des irrécupérables et sur la guérison du reste par la soumission, l’humiliation, la propagande et le lavage de cerveau. » Comment cette rééducation a-t-elle fonctionné ? « Les captifs étaient soumis à un processus de déshumanisation. Dépouillés de leurs biens les plus personnels, ils étaient complètement tondus la plupart du temps et incorporés dans une masse impersonnelle qui ne bougeait qu’au son du clairon et des coups de matraque. Les conditions infrahumaines dans les camps les ont dégradés psychologiquement dès les premiers instants », écrit Carlos Hernández. Dans ces conditions, les prisonniers étaient obligés, au moins trois fois par jour, de chanter Cara al sol et autres hymnes franquistes et de rendre les honneurs au drapeau rouge et jaune en faisant le salut fasciste romain. De même, la ICCP ordonna que deux heures de conférences d’endoctrinement soient consacrées quotidiennement dans les camps à des sujets tels que « Les erreurs du marxisme », « Les buts du judaïsme, de la franc-maçonnerie et du marxisme » ou « Le concept d’Espagne impériale ».
« L’Église a joué un rôle fondamental dans cette tâche “rééducative”. Dans les camps de concentration, l’identification absolue des méthodes et des objectifs entre cette institution, les putschistes et la dictature qui a suivi était clairement reflétée. Contrairement à la figure du médecin, celle du prêtre ne manquait jamais dans ces enceintes. Généralement avec la plus grande ardeur, les prêtres lançaient des sermons agressifs et menaçants aux prisonniers et servaient d’enseignants dans les classes patriotiques », dit Carlos Hernandez.
Le 1er avril 1939, il y a près de quatre-vingts ans aujourd’hui, Franco mettait fin à la guerre civile avec ce message radiophonique : « Avec l’armée rouge captive et désarmée, les troupes nationales ont atteint leurs derniers objectifs militaires. » Cependant, la paix n’est pas revenue. A ce moment précis, le nombre d’Espagnols dans les camps de concentration dépassait « largement » le demi-million, selon les calculs de Hernandez. Beaucoup d’autres restaient emprisonnés, mais désormais dans des bataillons de travailleurs. En novembre 1939, de fait, Franco ordonna la fermeture de la quasi-totalité des camps de concentration. Du jour au lendemain, de nombreux camps passèrent sous la dépendance de la Direction générale des prisons ou d’autres institutions. Dans certains d’entre eux, les prisonniers qui n’avaient pas été jugés furent évacués et seuls restèrent les détenus qui purgeaient leur peine. Dans d’autres établissements, au contraire, seule leur dénomination officielle fut changée. Les citoyens qui purent quitter le camp de concentration n’ont pas pour autant obtenu une liberté définitive et réelle. Des centaines de milliers d’hommes et de femmes sont restés prisonniers pendant des décennies dans les localités où ils vivaient.
« Un fort pourcentage d’entre eux furent de nouveau arrêtés, emprisonnés ou fusillés après avoir été soumis à de nouvelles procédures judiciaires. Les plus jeunes durent accomplir leurs obligations militaires, une nouvelle période de captivité et d’esclavage. Tous, presque sans exception, restèrent à jamais surveillés et marginalisés socialement et économiquement : les emplois nouveaux étaient réservés à ceux qui avaient combattu dans les rangs de l’armée victorieuse », conclut Carlos Hernández. La guerre était finie. Une vie de pauvreté et de misère commençait.
Alejandro Torrús










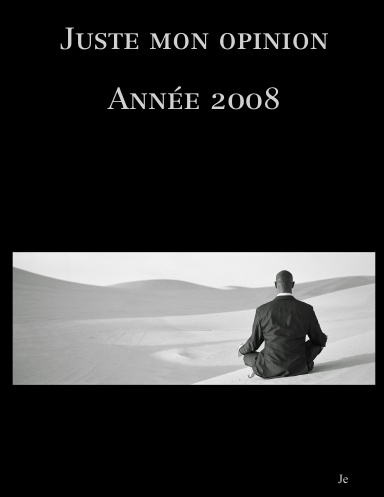
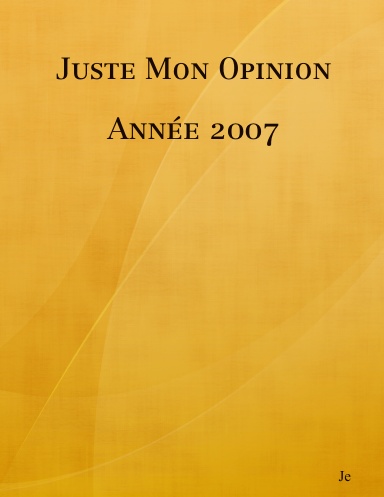

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire