*Anacharsis Cloots (1793)
Texte issu d’une intervention le 16 mars 2019 à Fertans (Doubs) dans le cadre de l’Atelier de philosophie plébéienne consacré aux Gilets jaunes.
Alors que le pouvoir en place et l’État
attendent toujours plus ou moins une petite révolte paysanne encadrée
par la FNSEA, un mouvement de cheminots ou d’enseignants encadrés par
les syndicats de salariés qui savent ne pas dépasser la ligne jaune ou
même un mouvement lycéen ou une révolte des banlieues qu’ils savent plus
difficile à contrôler, c’est du côté d’une population majoritairement
rendue invisible qu’est venue la surprise en des temps qui sont ceux où
les différentes forces de pouvoir cherchent à faire une place aux
« minorités visibles ».
L’événement, au sens fort, c’est ce qui
marque une rupture avec ce qui est attendu, que ce soit du point de vue
de sa composante (ce n’est pas une classe ni même une catégorie ou une
corporation), de ses objectifs (ils peuvent être aussi bien globaux que
paraître dérisoires aux personnes extérieures) de son organisation (les
médiations habituelles, syndicales ou politiques sont ignorées,
l’attaque contre l’État est frontale) ou encore de ses moyens de lutte
(action directe, occupation et blocages de lieux inhabituels comme les
ronds-points, manifestations urbaines non déclarées, détermination à la
mobilité non entravée dans les centres-villes au cours des
manifestations).
L’événement, c’est aussi ce qui marque
une rupture entre l’avant et l’après. L’avant parce que pas grand-chose
ne le laissait présager (les Gilets jaunes sont une caricature de
majorité silencieuse pour le pouvoir) et l’après parce que rien ne
préfigure ce qui va suivre le soulèvement. Par rapport à la simple
émeute, il perdure (trois mois maintenant), c’est en cela qu’il fait
événement, mais la dynamique qui l’anime pendant ce temps n’est pas gage
de transcendance ou de dépassement. Pour prendre un exemple, il y a des
points communs entre l’événement Mai-68 et l’événement Gilets jaunes
parce que dans les deux cas il y a bouleversement des comportements
pratiques dans un déroulement qui n’est pas linéaire et qui peut très
bien connaître son acmé au début, au milieu ou à la fin du mouvement qui
fait événement. Dans tous les cas, il fait qu’on ne peut faire de la
question : « Quelle perspective ? » ou « Comme cela va-t-il finir ? » la
question essentielle. L’événement se suffit à lui-même et ne préjuge
pas de son devenir et des risques encourus, de ses dérives, de son
résultat (Mai-68 n’est pas réductible à Grenelle, le mouvement des
fourches au parti Cinq étoiles, les Gilets jaunes au RIC, etc.).
Il est dans sa nature d’événement de se
poser les questions dans des termes nouveaux d’où son allure
« sauvage », de groupe en fusion, sa désinvolture par rapport à toutes
les règles sociales de bienséance envers les différents pouvoirs, qu’ils
soient politiques, économiques ou médiatiques et évidemment par rapport
aux forces de l’ordre une fois qu’il en a compris la fonction
répressive à son encontre en tant que corps particulier de l’État (cf.
infra). Le choix entre respect de la légalité ou passage à l’illégalité
n’est alors plus pour lui un principe défini à l’avance, comme dans
l’action syndicale et politique, mais un sujet à traiter de façon
pragmatique, au coup par coup et si passage à l’acte il y a il est
assumé sans crier au loup ! Ainsi des milliers de gardes à vue
signifiées aux Gilets jaunes, sans autre forme de procès, ne le pousse
pas à se poser de façon essentiellement victimaire.
Le mouvement ne se laisse pas saisir
aisément. Dans un premier temps sociologues, politiques et médias ont
entonné l’antienne des classes moyennes, celles qui se sentiraient
déclassées, qui jugeraient payer trop d’impôt, à la fois parce les
pauvres n’en paieraient pas et parce que les puissants y échappent aussi
par évasion fiscale. Et puis devant le peu de réalité de la chose, les
commentateurs sont passés à la notion de « classe moyenne inférieure »,
regroupant par là un vaste magma qui serait composé des 50 % de ménages
qui ne se situent pas dans les 25 % les plus riches ou les 25 % les plus
pauvres. Le peu de sérieux de ces tentatives a conduit ensuite à
privilégier finalement la notion de « classes populaires » qui
permettrait de mieux rendre compte de ce que ressentent les
protagonistes (« Nous sommes le peuple ») sans donner l’air de céder à
une lecture populiste du mouvement. Un analyste qui se prétend géographe
(C. Guilluy) s’est même saisi de ce dernier qualificatif pour désigner
un ensemble surdéterminé par la division spatiale du territoire entre
centre et périphérie, oublieux du fait que les « classes populaires »
peuplent aussi les HLM des banlieues des grandes métropoles. Quant aux
marxistes orthodoxes, ils ont campé sur leur lutte de classe éternelle,
la plupart pour refuser un mouvement au mieux interclassiste au pire
petit-bourgeois et réactionnaire comme si les événements
révolutionnaires du passé avaient été mis en jeu par des classes
« pures » (Canuts lyonnais mêlant salariés et artisans, paysans
anarchistes ukrainiens de 1917 et d’Andalousie de 1936 côtoyant les
conseils ouvriers). Pour rester au plus près de notre époque, dans les
années 1960-70, en France et en Italie c’est justement le mixage entre
souvenirs des révoltes paysannes de l’Ouest de la France ou du
Mezzogiorno italien qui a produit cette insoumission à l’usine et la
mise à feu et à sang d’une usine de la dimension de FIAT par les jeunes
ouvriers insoumis à la discipline d’usine.
Et là, avec les Gilets jaunes, au niveau
de « l’impureté », on est servi : 33 % se disent employés, 14 %
ouvriers, 10 % artisans, commerçants ou auto-entrepreneurs, 10 %
professions intermédiaires, 25 % inactifs ou retraités. Mais c’est quand
on leur demande, dans des sondages et enquêtes, qu’ils répondent en ce
sens, car l’une des caractéristiques premières du mouvement est de ne
jamais aborder une discussion par le biais du travail concret effectué,
mais par celui des conditions de vie. C’est d’ailleurs comme cela qu’il
constitue son unité. Celle d’une commune condition de vie, difficile ou
précaire. Par rapport à ces analyses en termes de classes nous pensons
justement que la caractéristique du mouvement des GJ est d’être
a-classiste, parce que ni l’analyse sociologique ou statistique en
termes de catégories socioprofessionnelles ni l’analyse marxiste en
termes de bourgeoisie et prolétariat ne sont pertinentes. Il n’y a plus
de classes antagonistes au sens de Marx parce que les éléments objectifs
(le nombre d’ouvriers et son enfermement dans les forteresses ouvrières
et ses quartiers), comme subjectifs (la conscience de classe et de
l’antagonisme capital/travail) se sont évanouies avec les
restructurations et ce que nous avons appelé la « révolution du
capital ».
S’il ya donc bien encore lutte, ce n’est
plus d’une lutte de classes dont il s’agit et qui avait sa ou ses
théories, ses perspectives inscrites de longue date et sur lesquelles se
jouaient diverses partitions, mais avec les mêmes instruments.
Une lutte sans classe donc, au sens
d’absence d’un sujet historique, même de rechange (l’étudiant,
l’immigré, le sans-papiers) plutôt qu’une lutte de classes.
Que le mouvement des GJ ne se rattache
pas au fil rouge historique des luttes de classes ne signifie pas qu’il
est dans un pur présentisme parce qu’il serait « mouvementiste » avant
tout. En effet, il a tendance à ressusciter les grandes révoltes
populaires du passé contre l’impôt et les taxes (cf. les Cahiers de
doléances de 1788-89). Paradoxalement, c’est l’affaiblissement des
États-nations (« à la française ») censés assurer l’égalité des
conditions (Tocqueville et les révolutions américaine et française) et
la fin des privilèges, qui, dans sa crise, produit à nouveau des
inégalités sociales et de nouveaux privilèges (relations sociales,
procédures de cooptation et clientélisme sous la forme du lobbysme, se
substituent au régime méritocratique). Ainsi, de la même façon que sous
l’Ancien Régime des charges étaient achetées aujourd’hui elles
redeviennent héréditaires de fait si ce n’est de droit. C’est donc une
remise en cause du pacte social en général auquel on aboutit et
finalement autour de ce qui symbolise son financement, condition d’une
reproduction plus ou moins satisfaisante du rapport social : l’impôt.
Que la goutte d’eau qui fait déborder le vase soit fiscale n’est pas
innocent dans un pays dont les pouvoirs publics refusent une réforme
fiscale jugée pourtant nécessaire par tous, mais considérée comme une
véritable usine à gaz. La grogne vis-à-vis de l’impôt déjà fort présente
ne pouvait donc pas rester lettre morte à partir du moment où des
mesures aussi provocatrices que la suppression de l’ISF sur la fortune
et la hausse des carburants pour les ménages étaient prises sans
justification légitime. Crispation contre l’impôt en général donc (c’est
ça qui a fait parler en termes de mouvement de classes moyennes ou
poujadisme à l’origine), mais révolte contre la spécificité française en
matière de fiscalité qui fait que l’impôt sur le revenu progressif
rapporte peu en France et que c’est par les taxes et la CSG non
progressives que l’État engrange la majorité de ses recettes, taxes qui
grèvent proportionnellement beaucoup plus les budgets modestes que les
autres vu la structure des dépenses dans les budgets de ces ménages (le
poids relatif des « dépenses contraintes » y est plus fort).
La Révolution française, la Marseillaise
comme chant révolutionnaire des citoyens, les cahiers de doléance, les
montées à Paris sur les lieux de pouvoir, le rappel au droit à
l’insurrection de l’article 35 de la Constitution de l’an III, le RIC
qui rappelle le droit de pétition de 1791, l’appel à une Constituante,
voilà donc aujourd’hui les références que le mouvement se réapproprie,
même s’il a parfois du mal à en saisir la dimension d’universalité dans
toute son ampleur, universelle justement et donc non nationale, sa
dimension citoyenne au sens de 1789-94, c’est-à-dire révolutionnaire et
non pas citoyenniste qui elle répond à l’appel de responsabilité que
l’État adresse à ses sujets quand il leur demande en fait d’obéir à ses
règles (cf. l’instruction civique).
Trouver ses propres références et ses
propres supports, c’est cela qui est difficile, car les regroupements de
ronds-points ne sont pas des conseils ouvriers, l’assemblée de Commercy
n’est pas l’assemblée ouvrière autonome de l’Alfa-Romeo de 1973, le RIC
n’est pas le programme d’un parti communiste prolétarien.
En effet, le mouvement naît et se
développe dans le procès de circulation plus que de production et pose
la question de la reproduction des rapports sociaux d’ensemble (d’où son
rapport conflictuel immédiat à l’État) plutôt que celle de la
production et du rapport au patronat. Cela s’explique, entre autres, par
la baisse de centralité du travail productif dans le procès de
valorisation du capital avec l’inessentialisation de la force de travail
qui en résulte et la tendance à la substitution capital/travail dans le
procès de production. Il en découle, au niveau de la structure même du
capital une importance accrue du procès de circulation et une tendance à
la totalisation du procès production/circulation qui rend l’action de
blocage des flux au moins aussi importante que la forme historique que
constituait le blocage de la production par la grève et l’occupation des
usines. Or, cela ne mobilise pas forcément les mêmes protagonistes
(retraités, chômeurs femmes au foyer, étudiants, auto-entrepreneurs) et
les GJ ont su se glisser dans cette configuration pour porter leur
action là où ça fait mal sans pourtant enclencher un processus de grève.
Enfin, ces changements entérinent l’idée
que tout se jouerait au niveau de l’hyper-capitalisme du sommet et ses
représentants visibles : État, GAFAM, banques, Commission européenne,
etc.
De la revendication particulière (la
lutte contre les taxes) à une révolte contre l’injustice fiscale puis,
plus généralement contre l’injustice sociale avec des revendications de
plus en plus proches de celles des salariés (augmentation des salaires
et du SMIG, halte à la précarité, retour de l’ISF, fin de la CSG), le
particulier tend vers l’universel.
Le mouvement n’est pas mû par une
critique des conditions de travail et du travail, mais par une référence
aux conditions de vie. Il est certain qu’auparavant, dans les luttes
ouvrières, les conditions de vie jouaient leur rôle, mais étaient comme
incluses dans les conditions de travail, car c’est la professionnalité
qui déterminait le reste (la fierté d’être mineur ou docker et non pas
la vie de misère qui leur était attenante). Alors qu’aujourd’hui, cette
professionnalité a été en grande partie détruite et elle n’est plus
qu’une composante (avec les conditions de travail) des conditions de vie
plus générales. D’ailleurs les GJ ne se présentent guère par leur
profession d’origine. C’est aussi cette caractéristique qui fait l’unité
au-delà des différentes conditions. En effet, préalablement, c’est le
collectif de travail qui faisait l’unité et l’idée d’une classe
particulière dans son opposition à la classe dominante ; or aujourd’hui,
cette unité n’est plus donnée directement par le capital qui a d’abord
corporatisé les segments de la force de travail salarié, puis atomisé
cette force de travail qui ne trouve plus guère son unité
qu’idéologiquement dans les grandes messes syndicales. L’unité, si unité
il peut y avoir ici ne peut donc qu’être reconstruite sur la base des
conditions de vie, ce à quoi les Gilets jaunes se sont attachés. « Tous
Gilets jaunes » en représente la formule la plus adéquate et récurrente
qui dit la façon de faire des Gilets jaunes : l’idéologie et le
politique ne sont pas les filtres qui guident le mouvement, malgré tous
les risques que cela comporte.
Plus concrètement et à l’origine, ces
conditions de vie sont marquées par les dépenses contraintes qui
absorbent une part grandissante du budget des ménages pauvres ou
modestes d’où l’accent mis sur les prix et les taxes jugées abusives, le
pouvoir d’achat, le « reste à vivre » au 15 du mois et le « pouvoir
vivre ».
Tous ces prix sont perçus comme un
arbitraire de l’État qui fixe des prix administrés ou des grands
monopoles/oligopoles qui fixent des prix mondiaux. Tous ces prix
apparaissent arbitraires car sans rapport avec une « valeur »
quelconque. Une chose facile à constater même pour des personnes peu
versées vers l’analyse économique quand on voit le peu de rapport entre
les variations de prix du baril de pétrole et celles du prix à la pompe à
essence.
Dans cette mesure et à l’opposé de ce
que l’on entend souvent, la conscience du mouvement des GJ n’est pas
forcément moins avancée que celle des ouvriers ou salariés s’attaquant à
des patrons précis. Les premiers s’attaquent directement à
l’hyper-capitalisme, via l’État, alors que les seconds en restent encore
à une conception de la domination reposant sur les mécanismes de
l’exploitation. De cela peut naître l’illusion qu’il n’y a que peu de
puissants (les fameux 1 %) et une immense majorité de dominés (les 99 %)
ce qui occulte complètement la complexité de la hiérarchisation sociale
des rapports sociaux capitalistes. Une des faiblesses du mouvement des
GJ, mais déjà présente dans des mouvements censément plus conscientisés
comme les « Occupy Wall Street ». Or, la plupart des Gilets jaunes n’ont
que trois mois au compteur !
Il n’est pas non plus directement
politique, mais il a une âme politique parce qu’il déconstruit
immédiatement l’évidence d’une soumission naturelle au pouvoir de la
part des dominés par rapport aux dominants. C’est dans ce soulèvement
qu’il produit sa propre violence, violence de détermination plus que
violence effective parce qu’il ne veut pas de cadre et surtout, plus
concrètement, qu’il déborde les cadres de la légalité républicaine. Le
refus de déclarer les manifestations et leur parcours, les occupations
de ronds-points et de plateforme sont les signes concrets de ce passage
en force par l’action qui délimite un nouveau rapport de force. Là aussi
nouvelle pratique par rapport aux mouvements sociaux habituels
encadrés : ce n’est pas le mouvement qui s’adapte à un rapport de force
établi qu’il prend en compte en phase statique, c’est lui qui produit le
rapport de force « qui fait mouvement ». Son refus de négocier et sa
critique de toute représentation, y compris en son sein, place alors la
barre très haut et rempli de désarroi les différentes formes de pouvoir
en place (gouvernements, médias, partis et syndicats), d’où la violence
de la répression par les forces de l’ordre et la virulence du discours
anti-mouvement dans les médias sérieux et la « pédagogie » par les
images de la part des télés poubelles.
Mais tout cela ne doit pas occulter le
fait que, malgré ses références récurrentes à la démocratie, le
mouvement s’affirme bien plus comme un mouvement d’action directe que
comme un mouvement pour la démocratie directe, même s’il n’y a pas
forcément de contradiction entre les deux tendances. L’auto-organisation
du mouvement, tant que les ronds-points en ont été l’axe majeur, est
restée une auto-organisation de proximité sans formalisme, loin, par
exemple, de l’assembléisme de Commercy qui, avec le RIC comme
revendication unitaire apparaissent plutôt comme des recettes pour une
porte de sortie par le haut d’un mouvement né par le bas, qu’une
véritable perspective de développement et d’approfondissement du
mouvement…
Pour passer du virtuel des réseaux
sociaux au réel du terrain de lutte, les GJ ont dû construire leur
propre corps collectif à partir, pourtant, de l’éclatement produit par
l’atomisation sociale et géographique. C’est de là que se sont dégagées
des subjectivités elles aussi collectives au-delà des fragmentations
objectives du corps social dans son entier. La communauté du travail,
comme à Lip, qui s’érigeait en communauté de lutte n’est plus possible
et s’y substitue la communauté de lutte directement comme seule
communauté immédiate, mais en tant qu’elle n’existe que par la lutte
(sinon, retour à l’atomisation et en conséquence à l’individualisme).
Une communauté de lutte dont la perspective est universaliste (celle de
la perspective d’une communauté humaine qu’anticipait déjà Anacharsis
Cloots, révolutionnaire allemand de la Révolution française en en
appelant en 1794, juste avant d’être guillotiné, à une « République du
genre humain »), au sens où elle n’est pas exclusive (« Tous gilets
jaunes »), même si elle peut parfois être tentée de se référer à une
communauté nationale des gens d’en bas (elle bute sur l’ambiguïté et la
polysémie de la référence citoyenne). Ce corps antagonique se fait
peuple, mais celui-ci n’est pas essentialisé, même si, là encore, la
référence à la communauté nationale et à la Révolution française ne sont
pas véritablement « pensées » et questionnées). Corps antagonique qui
s’oppose aux différents corps de l’État et à celui qui, tout à coup, lui
est apparu comme son auxiliaire, à savoir le corps des forces de
l’ordre, accusé, dès l’acte III de « collaboration » avec l’État. Il n’y
a donc pas, à proprement parler, de demande par rapport à l’État, comme
par exemple dans le cas des luttes dans la fonction publique, parce que
l’État apparaît ici comme l’ennemi… sans que soit produite une claire
critique de l’État en tant que pouvoir, que ce soit à la façon
anarchiste ou à la façon américaine conservatrice.
Le « Tous ensemble » que l’on entend
crier comme en 1995, n’est donc pas une demande de restauration de
l’État-providence de la période des Trente glorieuses, mais un « “Tous
ensemble” contre ce monde » qui peut effectivement s’ouvrir à toutes les
problématiques autour de la question du climat et de l’écologie, des
« grands travaux », etc.
Cette communauté de lutte est communauté
de pratiques collectives proche de celle des ZAD avec l’expérience des
cabanes de ronds-points. C’est fort, mais limité car le mouvement n’a
pas de pensée de l’émancipation à portée de main. C’est la solidarité
(fraternité) présente sur ses lieux d’action et les désirs d’égalité et
de liberté qui l’animent. La tension individu/communauté s’y dévoile.
Point.
Temps critiques, février 2019
Source : http://blog.tempscritiques.net/










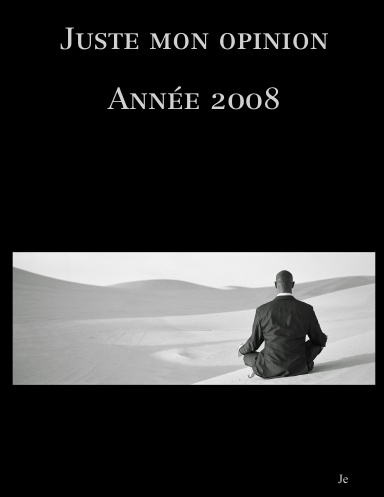
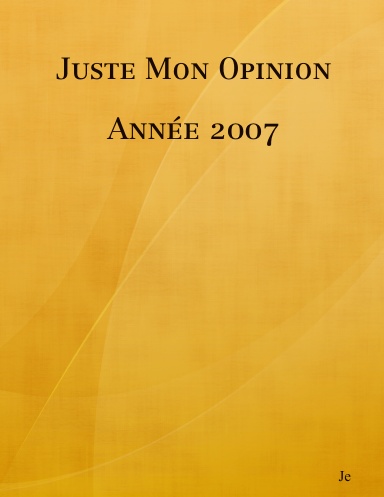
6 commentaires:
Dans le paragraphe “Une composition sociale diverse ...”, je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce qu’écrit l’auteur de l’article :
“Il n’y a plus de classes antagonistes au sens de Marx parce que les éléments objectifs (le nombre d’ouvriers et son enfermement dans les forteresses ouvrières et ses quartiers), comme subjectifs (la conscience de classe et de l’antagonisme capital/travail) se sont évanouies avec les restructurations et ce que nous avons appelé la « révolution du capital ».
Je trouve personnellement que la lutte de classe entre propriétaires du capital et travailleurs s’exprime de plus en plus, et qu’on glisse vers un retour au XIXème siècle. Alors, bien sûr, il y a des travailleurs salariés qui vivent confortablement (je dirais à partir de 3000€ [80-85ème percentile] et plus certainement à partir de 5000 € [95ème percentile]) et qui ne veulent pas du tout changer la société. Mais je retiens une donnée chiffrée très importante : en France, en 2017, 82% des richesses produites ont été captées par 1% des personnes les plus riches ! Et une autre : l’année qui a précédé l’élection de Donald Trump aux États-Unis, la croissance (le surplus de richesse produit par le pays) a été totalement capté par les 1% les plus riches. C’est même 120% qui a été capté. Ce qui signifie que, malgré une richesse totale en augmentation, les 99% qui doivent travailler ont vu leur part réduite (20% captés par les plus riches).
Deuxième passage sur lequel je tique, au milieu du chapitre “Un mouvement d’insubordination” :
“ De cela peut naître l’illusion qu’il n’y a que peu de puissants (les fameux 1 %) et une immense majorité de dominés (les 99 %) ce qui occulte complètement la complexité de la hiérarchisation sociale des rapports sociaux capitalistes. Une des faiblesses du mouvement des GJ, mais déjà présente dans des mouvements censément plus conscientisés comme les « Occupy Wall Street ». Or, la plupart des Gilets jaunes n’ont que trois mois au compteur !
Les courbes de revenus sont pourtant très claires. Répartis en percentiles, les revenus passent de 1 à 4 au 90ème percentile; et de 1 à 10 au 99ème percentile. Formulé autrement : si les plus pauvres (le premier percentile) gagnent 1, les 99ème (l’avant-dernier percentile, c’est-à-dire le 2ème plus riche) gagne 10. Les écarts de 1 à 10 sont relativement acceptables. Mais après, cela devient vertical ! Dans les grandes entreprises, par exemple, on est dans des rapports de 1 à 600 désormais. Et je ne parle pas des multimillionnaires ou milliardaires qui gagnent en une seconde (sans travailler) ce qu’un smicard met un mois à gagner (en travaillant).
Quelques courbes pour illustrer ceci :
- différences individuelles au sein de la société américaine (c’est en anglais) : https://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2018/11/wealth-inequality-in-america.html
- différences entre pays (en anglais encore) : https://justemonopinion-jeronimo.blogspot.com/2018/11/global-wealth-inequality.html
Juste après, j’adhère complètement à ce qui est décrit :
“ Le mouvement des Gilets jaunes n’est pas « social » au sens des mouvements sociaux traditionnels, mais il a une nature sociale. Il n’est pas non plus directement politique, mais il a une âme politique parce qu’il déconstruit immédiatement l’évidence d’une soumission naturelle au pouvoir de la part des dominés par rapport aux dominants. C’est dans ce soulèvement qu’il produit sa propre violence, violence de détermination plus que violence effective parce qu’il ne veut pas de cadre et surtout, plus concrètement, qu’il déborde les cadres de la légalité républicaine. “
La raison c’est que ce mouvement n’est pas syndicaliste (comme dans les années 1880), ni partisan / parti politique (comme dans les années 1930) : il est anarchiste ! Sans chef ! C’est pour cela qu’il déborde du cadre de la république, avec son assemblée de “représentants” issus des divers partis politiques.
Pas d’accord avec un troisième passage :
“le mouvement s’affirme bien plus comme un mouvement d’action directe que comme un mouvement pour la démocratie directe, même s’il n’y a pas forcément de contradiction entre les deux tendances.”
Le mouvement est anarchiste (étymologiquement sans chef, sans “représentant” au sens actuel de chef, seulement avec des porte-parole sans pouvoir de prise de décision) et donc de démocratie directe ! Il n’y a pas contradiction mais cohérence ! Dans une société anarchiste, l’assemblée du plus bas échelon décide. Tous les membres de la société y contribuent. Les actions découlent de ces décisions collectives mais chacun reste libre d’y participer ou pas. C’est comme dans les sociétés premières, sans État.
Nouveau passage que je dois commenter :
“Commercy qui, avec le RIC comme revendication unitaire apparaissent plutôt comme des recettes pour une porte de sortie par le haut d’un mouvement né par le bas, qu’une véritable perspective de développement et d’approfondissement du mouvement…”
Le RIC en toutes matières est un outil de démocratie directe. Mais ce n’est pas la société entièrement mue par la démocratie directe. Pour cela, il faudrait une confédération de communes où des assemblées de citoyen-ne-s prendraient directement toutes les décisions. Non, le RIC n’est qu’un intrus dans le régime représentatif; mais un intrus minimum à obtenir parce que nous devons absolument conquérir une partie du pouvoir de décision, par la démocratie directe. Sinon, nous resterons totalement impuissants politiquement.
Bien vu de la part de l’auteur :
“l’État apparaît ici comme l’ennemi… sans que soit produite une claire critique de l’État en tant que pouvoir”
Les Gilets Jaunes sont anarchistes sans encore en avoir conscience.
Enregistrer un commentaire