L’individu privatisé
Décédé le 26 décembre
1997, Cornelius Castoriadis, philosophe et analyste, était l’une des
figures les plus fortes de la vie intellectuelle française. Grec de
naissance, il est arrivé en 1945 à Paris, où il a animé la revue « Socialisme ou Barbarie ». En 1968, il publie, avec Edgar Morin et Claude Lefort, « Mai 68, la brèche ». A la fin des années 1970, il participe à la revue « Libre ». A côté de son maître ouvrage, « L’Institution imaginaire de la société » (1975), il est l’auteur d’autres livres fondamentaux, regroupés en une série commencée en 1978 : « Les Carrefours du Labyrinthe » (1).
La philosophie n’est pas philosophie si elle n’exprime pas une pensée autonome. Que signifie « autonome » ? Cela veut dire autosnomos, « qui se donne à soi -même sa loi ». En philosophie, c’est clair : se donner à soi -même sa loi, cela veut dire qu’on pose des questions et qu’on n’accepte aucune autorité. Pas même l’autorité de sa propre pensée antérieure.
C’est là d’ailleurs que le bât blesse un peu, parce que les philosophes, presque toujours, construisent des systèmes fermés comme des oeufs (voir Spinoza, voir surtout Hegel, et même quelque peu Aristote), ou restent attachés à certaines formes qu’ils ont créées et n’arrivent pas à les remettre en question. Il y a peu d’exemples du contraire. Platon en est un. Freud en est un autre dans le domaine de la psychanalyse, bien qu’il n’ait pas été philosophe.
L’autonomie, dans le domaine de la pensée, c’est l’interrogation illimitée ; qui ne s’arrête devant rien et qui se remet elle -même constamment en cause. Cette interrogation n’est pas une interrogation vide ; une interrogation vide ne signifie rien. Pour avoir une interrogation qui fait sens, il faut déjà qu’on ait posé comme provisoirement incontestables un certain nombre de termes. Autrement il reste un simple point d’interrogation, et pas une interrogation philosophique. L’interrogation philosophique est articulée, quitte à revenir sur les termes à partir desquels elle a été articulée.
Qu’est-ce que l’autonomie en politique ? Presque toutes les sociétés humaines sont instituées dans l’hétéronomie, c’est-à-dire dans l’absence d’autonomie. Cela veut dire que, bien qu’elles créent toutes, elles -mêmes, leurs institutions, elles incorporent dans ces institutions l’idée incontestable pour les membres de la société que cette institution n’est pas œuvre humaine, qu’elle n’a pas été créée par les humains, en tout cas pas par les humains qui sont là en ce moment. Elle a été créée par les esprits, par les ancêtres, par les héros, par les Dieux ; mais elle n’est pas œuvre humaine.
Avantage considérable de cette clause tacite et même pas tacite : dans la religion hébraïque, le don de la Loi par Dieu à Moïse est écrit, explicité. Il y a des pages et des pages dans l’Ancien Testament qui décrivent par le détail la réglementation que Dieu a fournie à Moïse. Cela ne concerne pas seulement les Dix Commandements mais tous les détails de la Loi. Et toutes ces dispositions, il ne peut être question de les contester : les contester signifierait contester soit l’existence de Dieu, soit sa véracité, soit sa bonté, soit sa justice. Or ce sont là des attributs consubstantiels de Dieu. Il en va de même pour d’autres sociétés hétéronomes. L’exemple hébraïque est ici cité à cause de sa pureté classique.
Or, quelle est la grande rupture qu’introduisent, sous une première forme, la démocratie grecque, puis, sous une autre forme, plus ample, plus généralisée, les révolutions des temps modernes et les mouvements démocratiques révolutionnaires qui ont suivi ? C’est précisément la conscience explicite que nous créons nos lois, et donc que nous pouvons aussi les changer.
Les lois grecques anciennes commencent toutes par la clause édoxè tè boulè kai to démo, « il a semblé bon au conseil et au peuple ». « Il a semblé bon », et non pas « il est bon ». C’est ce qui a semblé bon à ce moment -là. Et dans les temps modernes, on a, dans les Constitutions, l’idée de la souveraineté des peuples. Par exemple , la Déclaration des droits de l’homme française dit en préambule : « La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, soit directement, soit par le moyen de ses représentants. » Le « soit directement » a disparu par la suite, et nous sommes restés avec les seuls « représentants ».
Quatre millions de dollars pour être élu
Il y a donc une autonomie politique ; et cette autonomie politique suppose de savoir que les hommes créent leurs propres institutions. Cela exige que l’on essaye de poser ces institutions en connaissance de cause, dans la lucidité, après délibération collective. C’est ce que j’appelle l’autonomie collective, qui a comme pendant absolument inéliminable l’autonomie individuelle.Une société autonome ne peut être formée que par des individus autonomes. Et des individus autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome.
Pourquoi cela ? Il est assez facile de le comprendre. Un individu autonome, c’est un individu qui n’agit, autant que c’est possible, qu’après réflexion et délibération. S’il n’agit pas comme cela, il ne peut pas être un individu démocratique, appartenant à une société démocratique.
En quel sens un individu autonome, dans une société comme je la décris, est-il libre ? En quel sens sommes-nous libres aujourd’hui ? Nous avons un certain nombre de libertés, qui ont été établies comme des produits ou des sous -produits des luttes révolutionnaires du passé. Ces libertés ne sont pas seulement formelles, comme le disait à tort Karl Marx ; que nous puissions nous réunir, dire ce que nous voulons, ce n’est pas formel. Mais c’est partiel, c’est défensif, c’est, pour ainsi dire, passif.
Comment puis-je être libre si je vis dans une société qui est gouvernée par une loi qui s’impose à tous ? Cela apparaît comme une contradiction insoluble et cela en a conduit beaucoup, comme Max Stirner (2) par exemple, à dire que cela ne pouvait pas exister ; et d’autres à sa suite, comme les anarchistes, prétendront que la société libre signifie l’abolition complète de tout pouvoir, de toute loi, avec le sous -entendu qu’il y a une bonne nature humaine qui surgira à ce moment-là et qui pourra se passer de toute règle extérieure. Cela est, à mon avis, une utopie incohérente.
Je peux dire que je suis libre dans une société où il y a des lois, si j’ai eu la possibilité effective (et non simplement sur le papier) de participer à la discussion, à la délibération et à la formation de ces lois. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit appartenir effectivement à la collectivité, au peuple.
Enfin, cet individu autonome est aussi l’objectif essentiel d’une psychanalyse bien comprise. Là, nous avons une problématique relativement différente, parce qu’un être humain est, en apparence, un être conscient ; mais, aux yeux d’un psychanalyste, il est surtout son inconscient. Et cet inconscient, généralement, il ne le connaît pas. Non pas parce qu’il est paresseux, mais parce qu’il y a une barrière qui l’empêche de le connaître. C’est la barrière du refoulement.
Nous naissons, par exemple, comme monades psychiques, qui se vivent dans la toute-puissance, qui ne connaissent pas de limites, ou ne reconnaissent pas de limites à la satisfaction de leurs désirs, devant lesquels tout obstacle doit disparaître. Et nous terminons par être des individus qui acceptent tant bien que mal l’existence des autres, très souvent formulant des vœux de mort à leur égard (qui ne se réalisent pas la plupart du temps), et acceptent que le désir des autres ait le même droit à être satisfait que le leur. Cela se produit en fonction d’un refoulement fondamental qui renvoie dans l’inconscient toutes ces tendances profondes de la psyché et y maintient une bonne partie des créations de l’imagination radicale.
Une psychanalyse implique que l’individu, moyennant les mécanismes psychanalytiques, est amené à pénétrer cette barrière de l’inconscient, à explorer autant que possible cet inconscient, à filtrer ses pulsions inconscientes et à ne pas agir sans réflexion et délibération. C’est cet individu autonome qui est la fin (au sens de la finalité, de la terminaison) du processus psychanalytique.
Or, si nous faisons la liaison avec le politique, il est évident que nous avons besoin d’un tel individu, mais il est évident aussi que nous ne pouvons pas soumettre la totalité des individus de la société à une psychanalyse. D’où le rôle énorme de l’éducation et la nécessité d’une réforme radicale de l’éducation, pour en faire une véritable païdaïa comme disaient les Grecs, une païdaïa de l’autonomie, une éducation pour l’autonomie et vers l’autonomie, qui amène ceux qui sont éduqués - et pas seulement les enfants - à s’interroger constamment pour savoir s’ils agissent en connaissance de cause plutôt qu’emportés par une passion ou par un préjugé.
Pas seulement les enfants, parce que l’éducation d’un individu, au sens démocratique, est une entreprise qui commence avec la naissance de cet individu et qui ne s’achève qu’avec sa mort. Tout ce qui se passe pendant la vie de l’individu continue à le former et à le déformer. L’éducation essentielle que la société contemporaine fournit à ses membres, dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, est une éducation instrumentale, organisée essentiellement pour apprendre une occupation professionnelle. Et à côté de celle-ci, il y a l’autre éducation, à savoir les âneries que diffuse la télévision.
Sur la question de la représentation politique, Jean-Jacques Rousseau disait que les Anglais, au XVIIIe siècle, croient qu’ils sont libres parce qu’ils élisent leurs représentants tous les cinq ans. Effectivement, ils sont libres, mais un jour sur cinq ans. En disant cela, Rousseau sous- estimait indûment son cas. Parce qu’il est évident que même ce jour sur cinq ans on n’est pas libre. Pourquoi ? Parce qu’on a à voter pour des candidats présentés par des partis. On ne peut pas voter pour n’importe qui. Et on a à voter à partir de toute une situation réelle fabriquée par le Parlement précédent et qui pose les problèmes dans les termes dans lesquels ces problèmes peuvent être discutés et qui, par là même, impose des solutions, du moins des alternatives de solution, qui ne correspondent presque jamais aux vrais problèmes.
Généralement, la représentation signifie l’aliénation de la souveraineté des représentés vers les représentants. Le Parlement n’est pas contrôlé. Il est contrôlé au bout de cinq ans avec une élection, mais la grande majorité du personnel politique est pratiquement inamovible. En France un peu moins. Ailleurs beaucoup plus. Aux États-Unis, par exemple, les sénateurs sont en fait des sénateurs à vie. Et cela viendra aussi en France. Pour être élu aux États-Unis il faut à peu près 4 millions de dollars. Qui vous donne ces 4 millions ? Ce ne sont pas les chômeurs. Ce sont les entreprises. Et pourquoi les donnent-elles ? Pour qu’ensuite le sénateur soit d’accord avec le lobby qu’elles forment à Washington, pour voter les lois qui les avantagent et ne pas voter les lois qui les désavantagent. Il y a là la voie fatale des sociétés modernes.
On le voit se faire en France, malgré toutes les prétendues dispositions prises pour contrôler la corruption. La corruption des responsables politiques, dans les sociétés contemporaines, est devenue un trait systémique, un trait structurel. Ce n’est pas anecdotique. C’est incorporé dans le fonctionnement du système, qui ne peut pas tourner autrement.
Quel est l’avenir de ce projet de l’autonomie ? Cet avenir dépend de l’activité de l’énorme majorité des êtres humains. On ne peut plus parler en termes d’une classe privilégiée, qui serait par exemple le prolétariat industriel, devenu, depuis longtemps, très minoritaire dans la population. On peut dire, en revanche, et c’est ce que je dis, que toute la population, sauf 3 % de privilégiés au sommet, aurait un intérêt personnel à la transformation radicale de la société dans laquelle elle vit.
Mais ce que nous observons depuis une cinquantaine d’années, c’est le triomphe de la signification imaginaire capitaliste, c’est-à-dire d’une expansion illimitée d’une prétendue maîtrise prétendument rationnelle ; et l’atrophie, l’évanescence de l’autre grande signification imaginaire des temps modernes, c’est-à-dire de l’autonomie.
Est-ce que cette situation sera durable ? Est-ce qu’elle sera passagère ? Nul ne peut le dire. Il n’y a pas de prophétie dans ce genre d’affaire. La société actuelle n’est certainement pas une société morte. On ne vit pas dans Byzance ou dans la Rome du Ve siècle (après J.-C.). Il y a toujours quelques mouvements. Il y a des idées qui sortent, qui circulent, des réactions. Elles restent très minoritaires et très fragmentées par rapport à l’énormité des tâches qui sont devant nous. Mais je tiens pour certain que le dilemme que, en reprenant des termes de Léon Trotski, de Rosa Luxemburg et de Karl Marx, nous formulions dans le temps de Socialisme ou Barbarie, continue d’être valide, à condition évidemment de ne pas confondre le socialisme avec les monstruosités totalitaires qui ont transformé la Russie en un champ de ruines, ni avec l’ « organisation » absurde de l’économie, ni avec l’exploitation effrénée de la population, ni avec l’asservissement total de la vie intellectuelle et culturelle qui y avaient été réalisés.
Voter pour le moindre mal
Pourquoi la situation contemporaine est-elle tellement incertaine ? Parce que, de plus en plus, on voit se développer, dans le monde occidental, un type d’individu qui n’est plus le type d’individu d’une société démocratique ou d’une société où on peut lutter pour plus de liberté, mais un type d’individu qui est privatisé, qui est enfermé dans son petit milieu personnel et qui est devenu cynique par rapport à la politique.Quand les gens votent, ils votent cyniquement. Ils ne croient pas au programme qu’on leur présente, mais ils considèrent que X ou Y est un moindre mal par rapport à ce qu’était Z dans la période précédente. Un tas de gens voteront Lionel Jospin sans doute (3) aux prochaines élections, non pas parce qu’ils l’adorent ou qu’ils sont éblouis par ses idées, ce serait étonnant, mais simplement parce qu’ils sont dégoûtés par la situation actuelle. La même chose d’ailleurs s’est passée en 1995, lorsque les gens ont été écœurés par quatorze ans de prétendu socialisme dont le principal exploit a été d’introduire le libéralisme le plus effréné en France et de commencer à démanteler ce qu’il y avait eu comme conquêtes sociales dans la période précédente.
Du point de vue de l’organisation politique, une société s’articule toujours, explicitement ou implicitement, en trois parties.
1) Ce que les Grecs auraient appelé oïkos, c’est-à-dire la « maison », la famille, la vie privée.
2) L’ agora, l’endroit public-privé où les individus se rencontrent, où ils discutent, où ils échangent, où ils forment des associations ou des entreprises, où l’on donne des représentations de théâtre, privées ou subventionnées, peu importe. C’est ce qu’on appelle, depuis le XVIIIe siècle, d’un terme qui prête à confusion, la société civile, confusion qui s’est encore accrue ces derniers temps.
3) L’ ecclesia, le lieu public-public, le pouvoir, le lieu où s’exerce, où existe, où est déposé le pouvoir politique.
La relation entre ces trois sphères ne doit pas être établie de façon fixe et rigide, elle doit être souple, articulée. D’un autre côté, ces trois sphères ne peuvent pas être radicalement séparées.
Le libéralisme actuel prétend qu’on peut séparer entièrement le domaine public du domaine privé. Or c’est impossible, et prétendre qu’on le réalise est un mensonge démagogique. Il n’y a pas de budget qui n’intervienne pas dans la vie privée publique, et même dans la vie privée. Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres. De même, il n’y a pas de pouvoir qui ne soit pas obligé d’établir un minimum de lois restrictives ; posant par exemple que le meurtre est interdit ou, dans le monde moderne, qu’il faut subventionner la santé ou l’éducation. Il doit y avoir dans ce domaine une espèce de jeu entre le pouvoir public et l’agora, c’est-à-dire la communauté.
Ce n’est que dans un régime vraiment démocratique qu’on peut essayer d’établir une articulation correcte entre ces trois sphères, préservant au maximum la liberté privée, préservant aussi au maximum la liberté de l’agora, c’est-à-dire des activités publiques communes des individus, et qui fasse participer tout le monde au pouvoir public. Alors que ce pouvoir public appartient à une oligarchie et que son activité est clandestine en fait, puisque que les décisions essentielles sont toujours prises dans la coulisse.










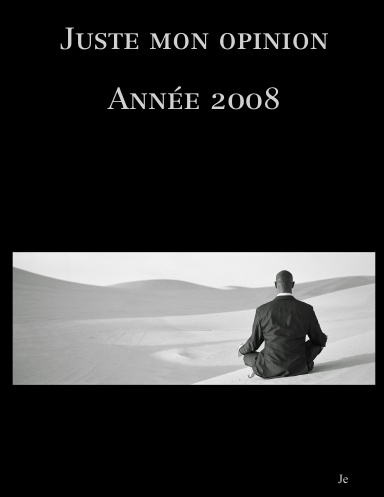
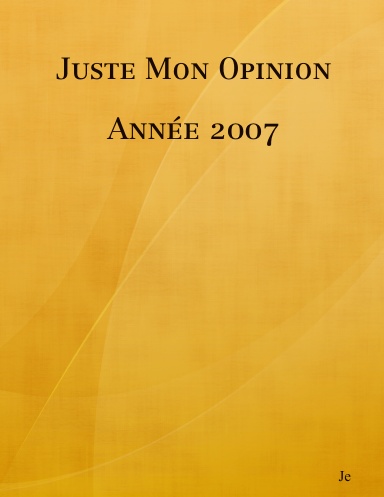

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire