Une insurrection, nous ne voyons même plus par
où ça commence. Soixante ans de pacification, de
suspension des bouleversements historiques,
soixante ans d’anesthésie démocratique et de gestion
des événements ont affaibli en nous une certaine
perception abrupte du réel, le sens partisan
de la guerre en cours. C’est cette perception qu’il
faut recouvrer, pour commencer.
Il n’y a pas à s’indigner du fait que s’applique depuis
cinq ans une loi aussi notoirement anticonstitutionnelle
que la loi sur la Sécurité quotidienne. Il
est vain de protester légalement contre l’implosion
achevée du cadre légal. Il faut s’organiser en
conséquence.
Il n’y a pas à s’engager dans tel ou tel collectif
citoyen, dans telle ou telle impasse d’extrême
gauche, dans la dernière imposture associative.
Toutes les organisations qui prétendent contester
l’ordre présent ont elles-mêmes, en plus fantoche,
la forme, les moeurs et le langage d’États
miniatures. Toutes les velléités de «faire de la politique autrement» n’ont jamais contribué, à ce jour,
qu’à l’extension indéfinie des pseudopodes
étatiques.
Il n’y a plus à réagir aux nouvelles du jour, mais à
comprendre chaque information comme une opération
dans un champ hostile de stratégies à déchiffrer,
opération visant justement à susciter chez
tel ou tel, tel ou tel type de réaction; et à tenir cette
opération pour la véritable information contenue
dans l’information apparente.
Il n’y a plus à attendre – une éclaircie, la révolution,
l’apocalypse nucléaire ou un mouvement social.
Attendre encore est une folie. La catastrophe n’est
pas ce qui vient, mais ce qui est là. Nous nous
situons d’ores et déjà dans le mouvement d’effondrement
d’une civilisation. C’est là qu’il faut
prendre parti.
Ne plus attendre, c’est d’une manière ou d’une
autre entrer dans la logique insurrectionnelle. C’est
entendre à nouveau, dans la voix de nos gouvernants,
le léger tremblement de terreur qui ne les
quitte jamais. Car gouverner n’a jamais été autre
chose que repousser par mille subterfuges le
moment où la foule vous pendra, et tout acte de
gouvernement rien qu’une façon de ne pas perdre
le contrôle de la population.
Nous partons d’un point d’extrême isolement,
d’extrême impuissance. Tout est à bâtir d’un processus
insurrectionnel. Rien ne paraît moins probable
qu’une insurrection, mais rien n’est plus
nécessaire.
SETROUVER
S’attacher à ce que l’on éprouve comme vrai.
Partir de là
Une rencontre, une découverte, un vaste mouvement
de grève, un tremblement de terre: tout événement
produit de la vérité, en altérant notre façon
d’être au monde. Inversement, un constat qui nous
est indifférent, qui nous laisse inchangés, qui n’engage
à rien, ne mérite pas encore le nom de vérité.
Il y a une vérité sous-jacente à chaque geste, à
chaque pratique, à chaque relation, à chaque situation.
L’habitude est de l’éluder, de gérer, ce qui produit
l’égarement caractéristique du plus grand
nombre dans cette époque. En fait, tout engage à
tout. Le sentiment de vivre dans le mensonge est
encore une vérité. Il s’agit de ne pas le lâcher, de
partir de là, même. Une vérité n’est pas une vue
sur le monde mais ce qui nous tient liés à lui de
façon irréductible. Une vérité n’est pas quelque
chose que l’on détient mais quelque chose qui nous
porte. Elle me fait et me défait, elle me constitue
et me destitue comme individu, elle m’éloigne de
beaucoup et m’apparente à ceux qui l’éprouvent.
L’être isolé qui s’y attache rencontre fatalement
quelques-uns de ses semblables. En fait, tout processus
insurrectionnel part d’une vérité sur laquelle
on ne cède pas. Il s’est vu à Hambourg, dans le
cours des années 1980, qu’une poignée d’habitants
d’une maison occupée décide que dorénavant il
faudrait leur passer sur le corps pour les expulser.
Il y eut un quartier assiégé de tanks et d’hélicoptères,
des journées de bataille de rue, des manifestations
monstres – et une mairie qui, finalement,
capitula. Georges Guingouin, le «premier maquisard
de France », n’eut en 1940 pour point de
départ que la certitude de son refus de l’occupation.
Il n’était alors, pour le Parti communiste,
qu’un « fou qui vit dans les bois»; jusqu’à ce qu’ils
soient 20000, de fous à vivre dans les bois, et à libérer
Limoges.
Ne pas reculer devant ce que toute amitié
amène de politique
On nous a fait à une idée neutre de l’amitié, comme
pure affection sans conséquence. Mais toute affinité
est affinité dans une commune vérité. Toute
rencontre est rencontre dans une commune affirmation,
fût-ce celle de la destruction. On ne se
lie pas innocemment dans une époque où tenir à
quelque chose et n’en pas démordre conduit régulièrement
au chômage, où il faut mentir pour travailler,
et travailler, ensuite, pour conserver lesmoyens du mensonge. Des êtres qui, partant de
la physique quantique, se jureraient d’en tirer en
tous domaines toutes les conséquences ne se lieraient
pas d’une façon moins politique que des
camarades qui mènent une lutte contre une multinationale
de l’agroalimentaire. Ils seraient amenés,
tôt ou tard, à la défection, et au combat.
Les initiateurs du mouvement ouvrier avaient
l’atelier puis l’usine pour se trouver. Ils avaient la
grève pour se compter et démasquer les jaunes. Ils
avaient le rapport salarial, qui met aux prises le
parti du Capital et le parti du Travail, pour tracer
des solidarités et des fronts à l’échelle mondiale.
Nous avons la totalité de l’espace social pour nous
trouver. Nous avons les conduites quotidiennes
d’insoumission pour nous compter et démasquer
les jaunes. Nous avons l’hostilité à cette civilisation
pour tracer des solidarités et des fronts à
l’échelle mondiale.
Ne rien attendre des organisations.
Se défier de tous les milieux existants,
et d’abord d’en devenir un
Il n’est pas rare que l’on croise, dans le cours d’une
désaffiliation conséquente, les organisations – politiques,
syndicales, humanitaires, associatives, etc.
Il arrive même que l’on y croise quelques êtres sincères
mais désespérés, ou enthousiastes mais roublards.
L’attrait des organisations tient dans leur consistance apparente – elles ont une histoire, un
siège, un nom, des moyens, un chef, une stratégie
et un discours. Elles n’en restent pas moins des
architectures vides, que peine à peupler le respect
dû à leurs origines héroïques. En toute chose
comme en chacun de leurs échelons, c’est d’abord
de leur survie en tant qu’organisations qu’elles s’occupent,
et de rien d’autre. Leurs trahisons répétées
leur ont donc le plus souvent aliéné
l’attachement de leur propre base. Et c’est pourquoi
l’on y rencontre parfois quelques êtres estimables.
Mais la promesse que contient la rencontre
ne pourra se réaliser qu’au dehors de l’organisation
et, nécessairement, contre elle.
Bien plus redoutables sont les milieux, avec leur
texture souple, leurs ragots et leurs hiérarchies
informelles. Tous les milieux sont à fuir. Chacun
d’entre eux est comme préposé à la neutralisation
d’une vérité. Les milieux littéraires sont là
pour étouffer l’évidence des écrits. Les milieux
libertaires celle de l’action directe. Les milieux
scientifiques pour retenir ce que leurs recherches
impliquent dès aujourd’hui pour le plus grand
nombre. Les milieux sportifs pour contenir dans
leurs gymnases les différentes formes de vie que
devraient engendrer les différentes formes de sport.
Sont tout particulièrement à fuir les milieux culturels
et les milieux militants. Ils sont les deux mouroirs
où viennent traditionnellement s’échouer
tous les désirs de révolution. La tâche des milieux culturels est de repérer les intensités naissantes
et de vous soustraire, en l’exposant, le sens de ce
que vous faites ; la tâche des milieux militants, de
vous ôter l’énergie de le faire. Les milieux militants
étendent leur maillage diffus sur la totalité
du territoire français, se trouvent sur le chemin de
tout devenir révolutionnaire. Ils ne sont porteurs
que du nombre de leurs échecs, et de l’amertume
qu’ils en conçoivent. Leur usure, comme l’excès
de leur impuissance, les ont rendus inaptes à saisir
les possibilités du présent. On y parle bien trop,
au reste, afin de meubler une passivité malheureuse
; et cela les rend peu sûrs policièrement.
Comme il est vain d’espérer d’eux quelque chose,
il est stupide d’être déçu de leur sclérose. Il suffit
de les laisser à leur crevaison.
Tous les milieux sont contre-révolutionnaires,
parce que leur unique affaire est de préserver leur
mauvais confort.
Se constituer en communes
La commune, c’est ce qui se passe quand des êtres
se trouvent, s’entendent et décident de cheminer
ensemble. La commune, c’est peut-être ce qui se
décide au moment où il serait d’usage de se séparer.
C’est la joie de la rencontre qui survit à son
étouffement de rigueur. C’est ce qui fait qu’on se
dit « nous », et que c’est un événement. Ce qui
est étrange n’est pas que des êtres qui s’accordent forment une commune, mais qu’ils restent séparés.
Pourquoi les communes ne se multiplieraient
pas à l’infini? Dans chaque usine, dans chaque rue,
dans chaque village, dans chaque école. Enfin le
règne des comités de base ! Mais des communes
qui accepteraient d’être ce qu’elles sont là où elles
sont. Et si possible, une multiplicité de communes
qui se substitueraient aux institutions de la société:
la famille, l’école, le syndicat, le club sportif, etc.
Des communes qui ne craindraient pas, outre leurs
activités proprement politiques, de s’organiser pour
la survie matérielle et morale de chacun de leurs
membres et de tous les paumés qui les entourent.
Des communes qui ne se définiraient pas – comme
le font généralement les collectifs – par un dedans
et un dehors, mais par la densité des liens en leur
sein. Non par les personnes qui les composent,
mais par l’esprit qui les anime.
Une commune se forme chaque fois que
quelques-uns, affranchis de la camisole individuelle,
se prennent à ne compter que sur eux-mêmes et
à mesurer leur force à la réalité. Toute grève sauvage
est une commune, toute maison occupée collectivement
sur des bases nettes est une commune,
les comités d’action de 68 étaient des communes
comme l’étaient les villages d’esclaves marrons aux
États-Unis, ou bien encore radio Alice, à Bologne,
en 1977. Toute commune veut être à elle-même
sa propre base. Elle veut dissoudre la question des
besoins. Elle veut briser, en même temps que toute dépendance économique, toute sujétion politique,
et dégénère en milieu dès qu’elle perd le contact
avec les vérités qui la fondent. Il y a toutes sortes
de communes, qui n’attendent ni le nombre, ni les
moyens, encore moins le «bon moment» qui ne
vient jamais, pour s’organiser.
S’ORGANISER
S’organiser pour ne plus devoir travailler
Les planques se font rares, et à vrai dire, c’est bien
souvent perdre trop de temps encore que de continuer
à s’y ennuyer. Elles se signalent en outre par
de piètres conditions de sieste et de lecture.
On sait que l’individu existe si peu qu’il doit
gagner sa vie, qu’il doit échanger son temps contre
un peu d’existence sociale. Du temps personnel,
pour de l’existence sociale : voilà le travail, voilà
le marché. Le temps de la commune échappe d’emblée
au travail, il ne marche pas dans la combine,
il lui en préférera d’autres. Des groupes de piqueteros
argentins soutirent collectivement une sorte
de RMI local conditionné par quelques heures
de travail ; ils ne font pas les heures, mettent en
commun leurs gains et se dotent d’ateliers de
confection, d’une boulangerie, mettent en place
les jardins dont ils ont besoin.
Il y a de l’argent à aller chercher pour la commune,
aucunement à devoir gagner sa vie. Toutes
les communes ont leurs caisses noires. Les combines
sont multiples. Outre le RMI, il y a les allocations, les arrêts maladie, les bourses d’études
cumulées, les primes soutirées pour des accouchements
fictifs, tous les trafics, et tant d’autres
moyens qui naissent à chaque mutation du
contrôle. Il ne tient pas à nous de les défendre, ni
de nous installer dans ces abris de fortune ou de
les préserver comme un privilège d’initié. Ce qu’il
est important de cultiver, de diffuser, c’est cette
nécessaire disposition à la fraude, et d’en partager
les innovations. Pour les communes, la question
du travail ne se pose qu’en fonction des autres
revenus existants. Il ne faut pas négliger tout ce
qu’au passage certains métiers, formations ou
postes bien placés procurent de connaissances
utiles.
L’exigence de la commune, c’est de libérer pour
tous le plus de temps possible. Exigence qui ne
se compte pas seulement, pas essentiellement, en
nombre d’heures vierges de toute exploitation salariale.
Le temps libéré ne nous met pas en vacance.
Le temps vacant, le temps mort, le temps du vide
et de la peur du vide, c’est le temps du travail. Il
n’y a plus désormais un temps à remplir, mais une
libération d’énergie qu’aucun « temps » ne
contient ; des lignes qui se dessinent, qui s’accusent,
que nous pouvons suivre à loisir, jusqu’au
bout, jusqu’à les voir en croiser d’autres.
Piller, cultiver, fabriquer
Des anciens de Metaleurop se font braqueurs plutôt
que matons. Des employés d’EDF font passer
à leurs proches de quoi truquer les compteurs.
Le matériel «tombé du camion» se revend à tout
va. Un monde qui se proclame si ouvertement
cynique ne pouvait s’attendre de la part des prolétaires
à beaucoup de loyauté.
D’un côté, une commune ne peut tabler sur
l’éternité de l’« État providence », de l’autre elle
ne peut compter vivre longtemps du vol à l’étalage,
de la récup’ dans les poubelles des supermarchés
ou nuitamment dans les entrepôts des
zones industrielles, du détournement de subventions,
des arnaques aux assurances et autres fraudes,
bref : du pillage. Elle doit donc se soucier d’accroître
en permanence le niveau et l’étendue de
son auto-organisation. Que les tours, les fraiseuses,
les photocopieuses vendus au rabais à la fermeture
d’une usine servent en retour à appuyer quelque
conspiration contre la société marchande, rien
ne serait plus logique.
Le sentiment de l’imminence de l’effondrement
est partout si vif de nos jours que l’on peine à
dénombrer toutes les expérimentations en cours
en fait de construction, d’énergie, de matériaux,
d’illégalisme ou d’agriculture. Il y a là tout un
ensemble de savoirs et de techniques qui n’attend
que d’être pillé et arraché à son emballage moraliste, caillera ou écolo. Mais cet ensemble n’est
encore qu’une partie de toutes les intuitions, de
tous les savoir-faire, de cette ingéniosité propre aux
bidonvilles qu’il nous faudra bien déployer si nous
comptons repeupler le désert métropolitain et assurer
la viabilité à moyen terme d’une insurrection.
Comment communiquer et se mouvoir dans une
interruption totale des flux ? Comment restaurer
les cultures vivrières des zones rurales jusqu’à ce
qu’elles puissent à nouveau supporter les densités
de peuplement qu’elles avaient encore il y a
soixante ans ? Comment transformer des espaces
bétonnés en potagers urbains, comme Cuba l’a fait
pour pouvoir soutenir l’embargo américain et la
liquidation de l’URSS ?
Former et se former
Nous qui avons tant usé des loisirs autorisés par
la démocratie marchande, que nous en est-il resté?
Qu’est-ce qui a bien pu un jour nous pousser à aller
jogger le dimanche matin? Qu’est-ce qui tient tous
ces fanatiques de karaté, ces fondus de bricolage,
de pêche ou de mycologie? Quoi, sinon la nécessité
de remplir un complet désoeuvrement, de
reconstituer sa force de travail ou son « capital
santé»? La plupart des loisirs pourraient aisément
se dépouiller de leur caractère d’absurdité, et devenir
autre chose que des loisirs. La boxe n’a pas toujours
été réservée à faire des démonstrations pour le Téléthon ou à donner des matchs à grand spectacle.
La Chine du début du XXe siècle, dépecée par
des hordes de colons et affamée par de trop longues
sécheresses, a vu des centaines de milliers de paysans
pauvres s’organiser autour d’innombrables
clubs de boxe à ciel ouvert pour reprendre aux
riches et aux colons ce dont ils avaient été spoliés.
Ce fut la révolte des boxers. Il ne sera jamais
trop tôt pour apprendre et pratiquer ce que des
temps moins pacifiés, moins prévisibles vont requérir
de nous. Notre dépendance à la métropole – à
sa médecine, à son agriculture, à sa police – est
telle, à présent, que nous ne pouvons l’attaquer
sans nous mettre en péril nous-mêmes. C’est la
conscience informulée de cette vulnérabilité qui
fait l’autolimitation spontanée des mouvements
sociaux actuels, qui fait redouter les crises et désirer
la « sécurité ». C’est par elle que les grèves
ont troqué l’horizon de la révolution pour celui du
retour à la normale. Se dégager de cette fatalité
appelle un long et consistant processus d’apprentissage,
des expérimentations multiples, massives.
Il s’agit de savoir se battre, crocheter des serrures,
soigner des fractures aussi bien que des angines,
construire un émetteur radio pirate, monter des
cantines de rue, viser juste, mais aussi rassembler
les savoirs épars et constituer une agronomie de
guerre, comprendre la biologie du plancton, la
composition des sols, étudier les associations de
plantes et ainsi retrouver les intuitions perdues, tous les usages, tous les liens possibles avec notre
milieu immédiat et les limites au-delà desquelles
nous l’épuisons ; cela dès aujourd’hui, et pour les
jours où il nous faudra en obtenir plus qu’une part
symbolique de notre nourriture et de nos soins.
Créer des territoires. Multiplier les zones d’opacité
De plus en plus de réformistes conviennent aujourd’hui
qu’« à l’approche du peak oil », et « pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre », il
va bien falloir « relocaliser l’économie », favoriser
l’approvisionnement régional, les circuits courts
de distribution, renoncer à la facilité des importations
lointaines, etc. Ce qu’ils oublient, c’est que
le propre de tout ce qui se fait localement en fait
d’économie est de se faire au noir, de manière
«informelle»; que cette simple mesure écologique
de relocalisation de l’économie implique rien
moins que de s’affranchir du contrôle étatique, ou
de s’y soumettre sans réserve.
Le territoire actuel est le produit de plusieurs
siècles d’opérations de police. On a refoulé le
peuple hors de ses campagnes, puis hors de ses rues,
puis hors de ses quartiers et finalement hors de ses
halls d’immeuble, dans l’espoir dément de contenir
toute vie entre les quatre murs suintants du
privé. La question du territoire ne se pose pas pour
nous comme pour l’État. Il ne s’agit pas de le tenir.
Ce dont il s’agit, c’est de densifier localement les communes, les circulations et les solidarités à tel
point que le territoire devienne illisible, opaque
à toute autorité. Il n’est pas question d’occuper,
mais d’être le territoire.
Chaque pratique fait exister un territoire –
territoire du deal ou de la chasse, territoire des jeux
d’enfants, des amoureux ou de l’émeute, territoire
du paysan, de l’ornithologue ou du flâneur. La règle
est simple: plus il y a de territoires qui se superposent
sur une zone donnée, plus il y a de circulation
entre eux, et moins le pouvoir trouve de prise.
Bistrots, imprimeries, salles de sport, terrains vagues,
échoppes de bouquinistes, toits d’immeubles, marchés
improvisés, kebabs, garages, peuvent aisément
échapper à leur vocation officielle pour peu qu’il s’y
trouve suffisamment de complicités. L’auto-organisation
locale, en surimposant sa propre géographie
à la cartographie étatique, la brouille, l’annule;
elle produit sa propre sécession.
Voyager. Tracer nos propres voies de communication
Le principe des communes n’est pas d’opposer à la
métropole et sa mobilité l’enracinement local et
la lenteur. Le mouvement expansif de constitution
de communes doit doubler souterrainement celui
de la métropole. Nous n’avons pas à rejeter les possibilités
de déplacement et de communication
offertes par les infrastructures marchandes, juste
à en connaître les limites. Il suffit d’y être assez pru-dents, assez anodins. Se rendre visite est autrement
plus sûr, ne laisse pas de trace et forge des liens bien
plus consistants que toute liste de contacts sur
Internet. Le privilège concédé à nombre d’entre
nous de pouvoir « circuler librement » d’un bout
à l’autre du continent et sans trop de problème dans
le monde entier, est un atout non négligeable pour
faire communiquer les foyers de conspiration. C’est
l’une des grâces de la métropole que de permettre
à des Américains, des Grecs, des Mexicains et des
Allemands de se retrouver furtivement à Paris le
temps d’une discussion stratégique.
Le mouvement permanent entre les communes
amies est de ces choses qui les gardent du desséchement
comme de la fatalité du renoncement.
Accueillir des camarades, se tenir au courant de
leurs initiatives, méditer leur expérience, s’ajouter
les techniques qu’ils maîtrisent font plus pour une
commune que de stériles examens de conscience
à huis-clos. On aurait tort de sous-estimer ce qui
peut s’élaborer de décisif dans ces soirées passées
à confronter nos vues sur la guerre en cours.
Renverser, de proche en proche, tous les obstacles
Comme on sait, les rues débordent d’incivilités.
Entre ce qu’elles sont réellement et ce qu’elles
devraient être, il y a la force centripète de toute
police, qui s’évertue à ramener l’ordre ; et en face,
il y a nous, c’est-à-dire le mouvement inverse, cen-trifuge. Nous ne pouvons que nous réjouir, partout
où ils surgissent, de l’emportement et du
désordre. Rien d’étonnant à ce que ces fêtes nationales
qui ne fêtent plus rien tournent systématiquement
mal, désormais. Rutilant ou déglingué,
le mobilier urbain – mais où commence-t-il ? où
finit-il ? – matérialise notre commune dépossession.
Persévérant dans son néant, il ne demande
qu’à y retourner pour de bon. Contemplons ce qui
nous entoure: tout cela attend son heure, la métropole
prend d’un coup des airs de nostalgie, comme
seuls en ont les champs de ruines.
Qu’elles deviennent méthodiques, qu’elles se
systématisent, et les incivilités confluent dans une
guérilla diffuse, efficace, qui nous rend à notre
ingouvernabilité, à notre indiscipline primordiales.
Il est troublant qu’au nombre des vertus militaires
reconnues au partisan figure justement l’indiscipline.
En fait, on n’aurait jamais dû délier rage et
politique. Sans la première, la seconde se perd en
discours ; et sans la seconde, la première s’épuise
en hurlements. Ce n’est jamais sans coups de
semonce que des mots comme « enragés » ou
«exaltés » refont surface en politique.
Pour la méthode, retenons du sabotage le principe
suivant : un minimum de risque dans l’action, un
minimum de temps, un maximum de dommages.
Pour la stratégie, on se souviendra qu’un obstacle
renversé mais non submergé – un espace libéré mais non habité – est aisément remplacé par un
autre obstacle, plus résistant et moins attaquable.
Inutile de s’appesantir sur les trois types de sabotage
ouvrier : ralentir le travail, du « va-y mollo»
à la grève du zèle; casser les machines, ou en entraver
la marche ; ébruiter les secrets de l’entreprise.
Élargis aux dimensions de l’usine sociale, les principes
du sabotage se généralisent de la production
à la circulation. L’infrastructure technique de la
métropole est vulnérable : ses flux ne sont pas seulement
transports de personnes et de marchandises,
informations et énergie circulent à travers
des réseaux de fils, de fibres et de canalisations,
qu’il est possible d’attaquer. Saboter avec quelque
conséquence la machine sociale implique aujourd’hui
de reconquérir et réinventer les moyens d’interrompre
ses réseaux. Comment rendre
inutilisable une ligne de TGV, un réseau électrique
? Comment trouver les points faibles des
réseaux informatiques, comment brouiller des
ondes radios et rendre à la neige le petit écran ?
Quant aux obstacles sérieux, il est faux de réputer
impossible toute destruction. Ce qu’il y a de
prométhéen là-dedans tient et se résume à une certaine
appropriation du feu, hors tout volontarisme
aveugle. En 356 av. J.C., Erostrate brûle le temple
d’Artémis, l’une des sept merveilles du monde. En
nos temps de décadence achevée, les temples n’ont
d’imposant que cette vérité funèbre qu’ils sont déjà
des ruines.
Anéantir ce néant n’a rien d’une triste besogne.
L’agir y retrouve une nouvelle jeunesse. Tout prend
sens, tout s’ordonne soudain, espace, temps, amitié.
On y fait flèche de tout bois, on y retrouve
l’usage – on n’est que flèche. Dans la misère des
temps, « tout niquer » fait peut-être office – non
sans raison, il faut bien l’avouer – de dernière
séduction collective.
Fuir la visibilité. Tourner l’anonymat
en position offensive
Dans une manifestation, une syndicaliste arrache
le masque d’un anonyme, qui vient de casser une
vitrine : «Assume ce que tu fais, plutôt que de te
cacher. » Être visible, c’est être à découvert, c’està-
dire avant tout vulnérable. Quand les gauchistes
de tous pays ne cessent de « visibiliser » leur cause
– qui celle des clochards, qui celle des femmes, qui
celle des sans-papiers – dans l’espoir qu’elle soit
prise en charge, ils font l’exact contraire de ce qu’il
faudrait faire. Non pas se rendre visible, mais tourner
à notre avantage l’anonymat où nous avons été
relégués et, par la conspiration, l’action nocturne
ou cagoulée, en faire une inattaquable position
d’attaque. L’incendie de novembre 2005 en offre
le modèle. Pas de leader, pas de revendication, pas
d’organisation, mais des paroles, des gestes, des
complicités. N’être socialement rien n’est pas une
condition humiliante, la source d’un tragique manque de reconnaissance – être reconnu : par
qui? –, mais au contraire la condition d’une liberté
d’action maximale. Ne pas signer ses méfaits, n’afficher
que des sigles fantoches – on se souvient
encore de l’éphémère BAFT (Brigade Anti-Flic
des Tarterêts) – est une façon de préserver cette
liberté. De toute évidence, constituer un sujet
« banlieue » qui serait l’auteur des « émeutes de
novembre 2005 » aura été l’une des premières
manoeuvres défensives du régime. Voir la gueule
de ceux qui sont quelqu’un dans cette société peut
aider à comprendre la joie de n’y être personne.
La visibilité est à fuir. Mais une force qui s’agrège
dans l’ombre ne peut l’esquiver à jamais. Il s’agit
de repousser notre apparition en tant que force
jusqu’au moment opportun. Car plus tard la visibilité
nous trouve, plus forts elle nous trouve. Et
une fois entré dans la visibilité, notre temps est
compté. Soit nous sommes en état de pulvériser
son règne à brève échéance, soit c’est lui qui sans
tarder nous écrase.
Organiser l’autodéfense
Nous vivons sous occupation, sous occupation policière.
Les rafles de sans-papiers en pleine rue, les
voitures banalisées sillonnant les boulevards, la
pacification des quartiers de la métropole par des
techniques forgées dans les colonies, les déclamations
du ministre de l’Intérieur contre les « bandes » dignes de la guerre d’Algérie nous le
rappellent quotidiennement. C’est assez de motifs
pour ne plus se laisser écraser, pour s’engager dans
l’autodéfense.
À mesure qu’elle grandit et rayonne, une commune
voit peu à peu les opérations du pouvoir
prendre pour cible ce qui la constitue. Ces contreattaques
prennent la forme de la séduction, de la
récupération et, en dernier recours, celle de la force
brute. L’autodéfense doit être pour les communes
une évidence collective, tant pratique que théorique.
Parer à une arrestation, se réunir prestement
en nombre contre des tentatives d’expulsion,
mettre à l’abri l’un des nôtres, ne seront pas des
réflexes superflus dans les temps qui viennent.
Nous ne pouvons sans cesse reconstruire nos bases.
Qu’on cesse de dénoncer la répression, qu’on s’y
prépare.
L’affaire n’est pas simple, car à mesure que l’on
attend de la population un surcroît de travail policier
– de la délation à l’engagement occasionnel dans
les milices citoyennes –, les forces de police se fondent
dans la foule. Le modèle passepartout
de l’intervention policière, même en situation
émeutière, c’est désormais le flic en civil.
L’efficacité de la police lors des dernières manifs
contre le CPE venait de ces civils qui se mêlaient à
la cohue, attendant l’incident pour se dévoiler :
gazeuse, matraque, flashball, interpellation; le tout
en coordination avec les services d’ordre des syn-dicats. La simple possibilité de leur présence suffit
à jeter le soupçon parmi les manifestants : qui est
qui?, et à paralyser l’action. Étant admis qu’une manifestation
n’est pas un moyen de se compter mais bien
un moyen d’agir, nous avons à nous doter des moyens
de démasquer les civils, les chasser et le cas échéant
leur arracher ceux qu’ils tentent d’arrêter.
La police n’est pas invincible dans la rue, elle a
simplement des moyens pour s’organiser, s’entraîner
et tester sans cesse de nouvelles armes.
En comparaison, nos armes à nous seront toujours
rudimentaires, bricolées et bien souvent improvisées
sur place. Elles ne prétendent en aucun cas
rivaliser en puissance de feu, mais visent à tenir à
distance, à détourner l’attention, à exercer une
pression psychologique ou forcer par surprise un
passage et gagner du terrain. Toute l’innovation
déployée dans les centres de préparation à la guérilla
urbaine de la gendarmerie française ne suffit
manifestement pas, et ne suffira sans doute jamais
à répondre assez promptement à une multiplicité
mouvante pouvant frapper à plusieurs endroits à
la fois et qui surtout s’efforce de toujours garder
l’initiative.
Les communes sont évidemment vulnérables à
la surveillance et aux enquêtes policières, à la police
scientifique et au renseignement. Les vagues d’arrestations
d’anarchistes en Italie et d’ecowarriors
aux États-Unis ont été permises par des écoutes.
Toute garde à vue donne maintenant lieu à une prise d’ADN et nourrit un fichier toujours plus
complet. Un squatteur barcelonais a été retrouvé
parce qu’il avait laissé des empreintes sur les tracts
qu’il distribuait. Les méthodes de fichage s’améliorent
sans cesse, notamment par la biométrie. Et
si la carte d’identité électronique venait à être mise
en place, notre tâche n’en serait que plus difficile.
La Commune de Paris avait en partie réglé
le problème du fichage: en brûlant l’Hôtel de Ville,
les incendiaires détruisaient les registres de l’état
civil. Reste à trouver les moyens de détruire à
jamais des données informatisées.
INSURRECTION
La commune est l’unité élémentaire de la réalité
partisane. Une montée insurrectionnelle n’est
peut-être rien d’autre qu’une multiplication de
communes, leur liaison et leur articulation. Selon
le cours des événements, les communes se fondent
dans des entités de plus grande envergure, ou bien
encore se fractionnent. Entre une bande de frères
et de soeurs liés « à la vie à la mort » et la réunion
d’une multiplicité de groupes, de comités, de bandes
pour organiser l’approvisionnement et l’autodéfense
d’un quartier, voire d’une région en soulèvement,
il n’y a qu’une différence d’échelle, elles
sont indistinctement des communes.
Toute commune ne peut que tendre vers l’autosubsistance
et éprouver en son sein l’argent comme
une chose dérisoire et, pour tout dire, déplacée.
La puissance de l’argent est de former un lien entre
ceux qui sont sans lien, de lier des étrangers en tant
qu’étrangers et par là, en mettant toute chose en
équivalence, de tout mettre en circulation. La capacité
de l’argent à tout lier se paye de la superficialité
de ce lien, où le mensonge est la règle. La
défiance est le fond de la relation de crédit. Le règne de l’argent doit toujours être, de ce fait, le
règne du contrôle. L’abolition pratique de l’argent
ne peut se faire que par l’extension des communes.
L’extension des communes doit pour chacune obéir
au souci de ne pas dépasser une certaine taille audelà
de quoi elle perd contact avec elle-même, et
suscite presque immanquablement une caste dominante.
La commune préférera alors se scinder et
de la sorte s’étendre, en même temps qu’elle prévient
une issue malheureuse.
Le soulèvement de la jeunesse algérienne, qui
a embrasé toute la Kabylie au printemps 2001,
est parvenu à une reprise quasi totale du territoire,
attaquant les gendarmeries, les tribunaux et toutes
les représentations de l’État, généralisant l’émeute,
jusqu’au retrait unilatéral des forces de l’ordre, jusqu’à
empêcher physiquement les élections de se
tenir. La force du mouvement aura été dans la complémentarité
diffuse entre des composantes multiples
– qui ne furent que très partiellement
représentées dans les interminables et désespérément
masculines assemblées des comités de village
et autres comités populaires. Les «communes» de
la toujours frémissante insurrection algérienne ont
tantôt le visage de ces jeunes «cramés» à casquette
balançant des bouteilles de gaz sur les CNS (CRS)
depuis le toit d’un immeuble de Tizi Ouzou, tantôt
le sourire narquois d’un vieux maquisard drapé
dans son burnous, tantôt encore l’énergie des
femmes d’un village de montagne faisant tour-ner, envers et contre tout, les cultures et l’élevage
traditionnels, sans lesquels les blocages de l’économie
de la région n’auraient jamais pu être si répétés
ni si systématiques.
Faire feu de toute crise
«Il faut en outre ajouter que l’on ne pourrait pas
traiter l’ensemble de la population française. Il faudra
donc faire des choix. » C’est ainsi qu’un expert
en virologie résume au Monde ce qui adviendrait
en cas de pandémie de grippe aviaire, le 7 septembre
2005. «Menaces terroristes», «catastrophes naturelles
», « alertes virales », «mouvements sociaux»
et «violences urbaines» sont pour les gestionnaires
de la société autant de moments d’instabilité où ils
assoient leur pouvoir par la sélection de ce qui leur
complaît et l’anéantissement de ce qui les embarrasse.
C’est donc donc aussi, logiquement, l’occasion
pour toute autre force de s’agréger ou de se
renforcer, en prenant le parti inverse.
L’interruption des flux de marchandises, la suspension
de la normalité – il suffit de voir ce qui fait
retour de vie sociale dans un immeuble soudainement
privé d’électricité pour imaginer ce que
pourrait devenir la vie dans une ville privée de tout
– et du contrôle policier libèrent des potentialités
d’auto-organisation impensables en d’autres
circonstances. Cela n’échappe à personne. Le mouvement
ouvrier révolutionnaire l’avait bien com-pris, qui a fait des crises de l’économie bourgeoise
les points d’orgue de sa montée en puissance.
Aujourd’hui, les partis islamiques ne sont jamais
aussi forts que là où ils ont su intelligemment suppléer
à la faiblesse de l’État, par exemple : lors de
la mise en place des secours après le tremblement
de terre de Boumerdès en Algérie, ou encore dans
l’assistance quotidienne à la population du Liban-
Sud détruit par l’armée israélienne.
Comme nous le mentionnions plus haut, la dévastation
de la Nouvelle-Orléans par l’ouragan Katrina
a donné l’occasion à toute une frange du mouvement
anarchiste nord-américain de prendre une
consistance inconnue en ralliant tous ceux qui, sur
place, résistent au déplacement forcé. Les cantines
de rue supposent d’avoir pensé au préalable l’approvisionnement;
l’aide médicale d’urgence exige
que l’on ait acquis le savoir et le matériel nécessaires,
tout comme l’installation de radios libres.
Ce qu’elles contiennent de joie, de dépassement de
la débrouille individuelle, de réalité tangible insoumise
au quotidien de l’ordre et du travail garantit
la fécondité politique de pareilles expériences.
Dans un pays comme la France, où les nuages
radioactifs s’arrêtent à la frontière et où l’on ne
craint pas de construire un cancéropole sur l’ancien
site classé Seveso de l’usine AZF, c’est moins
sur les crises « naturelles » qu’il faut compter que
sur les crises sociales. C’est aux mouvements
sociaux qu’il revient ici le plus souvent d’inter-rompre le cours normal du désastre. Certes, ces
dernières années, les diverses grèves furent principalement
des occasions pour le pouvoir et les
directions d’entreprises de tester leur capacité à
maintenir un « service minimum » toujours plus
large, jusqu’à rendre l’arrêt de travail à sa pure
dimension symbolique – à peine plus dommageable
qu’une chute de neige ou un suicide sur la voie.
Mais en bouleversant les pratiques militantes installées
par l’occupation systématique des établissements
et le blocage obstiné, les luttes lycéennes
de 2005 et contre le CPE ont rappelé la capacité
de nuisance et d’offensive diffuse des grands mouvements.
Par toutes les bandes qu’elles ont suscitées
dans leur sillage, elles ont laissé entrevoir à
quelles conditions des mouvements peuvent devenir
le lieu d’émergence de nouvelles communes.
Saboter toute instance de représentation.
Généraliser la palabre.
Abolir les assemblées générales
Tout mouvement social rencontre comme premier
obstacle, bien avant la police proprement dite,
les forces syndicales et toute cette microbureaucratie
dont la vocation est d’encadrer les luttes. Les
communes, les groupes de base, les bandes se
défient spontanément d’elles. C’est pourquoi les ont l’air plus innocentes, mais n’en demeurent pas
moins le terrain idéal de leurs manoeuvres. Qu’un
collectif égaré s’essaie à l’autonomie et ils n’ont
alors de cesse de le vider de tout contenu en en
écartant résolument les bonnes questions. Ils sont
farouches, ils s’échauffent ; non par passion du
débat, mais dans leur vocation à le conjurer. Et
quand leur défense acharnée de l’apathie a enfin
raison du collectif, ils en expliquent l’échec par
le manque de conscience politique. Il faut dire
qu’en France, grâce notamment à l’activité forcenée
des différentes chapelles trotskistes, ce n’est
pas l’art de la manipulation politique qui fait défaut
dans la jeunesse militante. De l’incendie de
novembre 2005, ce n’est pas elle qui aura su tirer
cette leçon : toute coordination est superflue là où
il y a de la coordination, les organisations sont toujours
de trop là où l’on s’organise.
Un autre réflexe est, au moindre mouvement, de
faire une assemblée générale et de voter. C’est une
erreur. Le simple enjeu du vote, de la décision à
remporter, suffit à changer l’assemblée en cauchemar,
à en faire le théâtre où s’affrontent toutes
les prétentions au pouvoir. Nous subissons là le
mauvais exemple des parlements bourgeois.
L’assemblée n’est pas faite pour la décision mais
pour la palabre, pour la parole libre s’exerçant sans
but.
Le besoin de se rassembler est aussi constant,
chez les humains, qu’est rare la nécessité de déci-der. Se rassembler répond à la joie d’éprouver une
puissance commune. Décider n’est vital que dans
les situations d’urgence, où l’exercice de la démocratie
est de toute façon compromis. Pour le reste
du temps, le problème n’est celui du « caractère
démocratique du processus de prise de décision»
que pour les fanatiques de la procédure. Il n’y a pas
à critiquer les assemblées ou à les déserter, mais à
y libérer la parole, les gestes et les jeux entre les
êtres. Il suffit de voir que chacun n’y vient pas seulement
avec un point de vue, une motion, mais
avec des désirs, des attachements, des capacités,
des forces, des tristesses et une certaine disponibilité.
Si l’on parvient ainsi à déchirer ce fantasme
de l’Assemblée Générale au profit d’une telle assemblée
des présences, si l’on parvient à déjouer la toujours
renaissante tentation de l’hégémonie, si l’on
cesse de se fixer la décision comme finalité, il y a
quelques chances que se produise une de ces prises
en masse, l’un de ces phénomènes de cristallisation
collective où une décision prend les êtres, dans leur
totalité ou seulement pour partie.
Il en va de même pour décider d’actions. Partir
du principe que « l’action doit ordonner le déroulement
d’une assemblée », c’est rendre impossible
tant le bouillonnement du débat que l’action efficace.
Une assemblée nombreuse de gens étrangers
les uns aux autres se condamne à commettre des
spécialistes de l’action, c’est-à-dire à délaisser l’action
pour son contrôle. D’un côté, les mandatés sont par définition entravés dans leur action, de
l’autre, rien ne les empêche de berner tout le
monde.
Il n’y a pas à poser une forme idéale à l’action.
L’essentiel est que l’action se donne une forme,
qu’elle la suscite et ne la subisse pas. Cela suppose
le partage d’une même position politique, géographique
– comme les sections de la Commune
de Paris pendant la Révolution française –, ainsi
que le partage d’un même savoir circulant. Quant
à décider d’actions, tel pourrait être le principe :
que chacun aille en reconnaissance, qu’on recoupe
les renseignements, et la décision viendra d’ellemême,
elle nous prendra plus que nous ne la prendrons.
La circulation du savoir annule la hiérarchie,
elle égalise par le haut. Communication horizontale,
proliférante, c’est aussi la meilleure forme de
coordination des différentes communes, pour en
finir avec l’hégémonie.
Bloquer l’économie, mais mesurer notre puissance
de blocage à notre niveau d’auto-organisation
Fin juin 2006, dans tout l’État de Oaxaca, les occupations
de mairies se multiplient, les insurgés occupent
des édifices publics. Dans certaines communes,
ils expulsent les maires et réquisitionnent les véhicules
officiels. Un mois plus tard, les accès à certains
hôtels et complexes touristiques sont bloqués.
Le ministre du Tourisme parle de catastrophe
parabureaucrates ont inventé depuis vingt ans les
coordinations qui, dans leur absence d’étiquette, « comparable à l’ouragan Wilma ». Quelques
années plus tôt, le blocage était devenu l’une des
principales formes d’action du mouvement de
révolte argentin, les différents groupes locaux se
portant mutuellement secours en bloquant tel ou
tel axe, menaçant en permanence, par leur action
conjointe, de paralyser tout le pays si leurs revendications
n’étaient pas satisfaites. Une telle menace
fut longtemps un puissant levier aux mains des cheminots,
électriciens-gaziers, chauffeurs routiers.
Le mouvement contre le CPE n’a pas hésité à bloquer
gares, périphériques, usines, autoroutes,
supermarchés et même aéroports. Il ne fallait pas
plus de trois cents personnes, à Rennes, pour
immobiliser la rocade pendant des heures et provoquer
quarante kilomètres de bouchons.
Tout bloquer, voilà désormais le premier réflexe
de tout ce qui se dresse contre l’ordre présent. Dans
une économie délocalisée, où les entreprises fonctionnent
à flux tendu, où la valeur dérive de la
connexion au réseau, où les autoroutes sont des
maillons de la chaîne de production dématérialisée
qui va de sous-traitant en sous-traitant et de
là à l’usine de montage, bloquer la production, c’est
aussi bien bloquer la circulation.
Mais il ne peut s’agir de bloquer plus que ne l’autorise
la capacité de ravitaillement et de communication
des insurgés, l’auto-organisation effective
des différentes communes. Comment se nourrir
une fois que tout est paralysé ? Piller les com-merces, comme cela s’est fait en Argentine, a ses
limites ; aussi immenses que soient les temples de
la consommation, ils ne sont pas d’infinis gardemanger.
Acquérir dans la durée l’aptitude à se procurer
la subsistance élémentaire implique donc de
s’approprier les moyens de leur production. Et sur
ce point, il paraît bien inutile d’attendre plus longtemps.
Laisser comme aujourd’hui à deux pour
cent de la population le soin de produire l’alimentation
de tous les autres est une ineptie historique
autant que stratégique.
Libérer le territoire de l’occupation policière.
Éviter autant que possible l’affrontement direct
«Cette affaire met en lumière que nous n’avons
pas à faire à des jeunes qui réclament davantage de
social mais à des individus qui déclarent la guerre
à la République », notait un flic lucide à propos
de récentes embuscades. L’offensive visant à libérer
le territoire de son occupation policière est déjà
engagée, et peut compter sur les inépuisables
réserves de ressentiment que ces forces ont réunies
contre elles. Les « mouvements sociaux » euxmêmes
sont peu à peu gagnés par l’émeute, non
moins que les fêtards de Rennes qui pendant l’année
2005 ont affronté les CRS tous les jeudis soir
ou ceux de Barcelone qui ont récemment, lors d’un
botellion, dévasté une artère commerciale de la ville.
Le mouvement contre le CPE a vu le retour régu- lier du cocktail molotov. Mais sur ce point, certaines
banlieues restent indépassées. Notamment
dans cette technique qui se perpétue depuis longtemps
déjà: le guet-apens. Ainsi celui du 13 octobre
2006 à Épinay : des équipes de la BAC tournaient
vers 23 heures à la suite d’un appel signalant un
vol à la roulotte ; à leur arrivée, une des équipes
«s’est trouvée bloquée par deux véhicules placés
en travers de la route et par plus d’une trentaine
d’individus, porteurs de barres de fer et d’armes
de poing qui ont jeté des pierres sur le véhicule
et utilisé à l’encontre des policiers du gaz lacrymogène
». À plus petite échelle, on pense aux commissariats
de quartiers attaqués pendant les heures
de fermeture : vitres cassées, voitures incendiées.
C’est un des acquis des derniers mouvements
qu’une véritable manifestation est dorénavant
« sauvage », non déclarée à la préfecture. Ayant
le choix du terrain, on aura soin, comme le Black
Bloc à Gênes en 2001, de contourner les zones
rouges, de fuir l’affrontement direct et, décidant
du trajet, de promener les flics au lieu d’être promenés
par la police, notamment syndicale, notamment
pacifiste. Il s’est vu alors qu’un millier de
personnes déterminées fasse reculer des cars entiers
de carabinieri pour finalement les incendier.
L’important n’est pas tant d’être le mieux armé que
d’avoir l’initiative. Le courage n’est rien, la
confiance dans son propre courage est tout. Avoir
l’initiative y contribue.
Tout incite, cependant, à envisager les confrontations
directes comme des points de fixation des
forces adverses permettant de temporiser et d’attaquer
ailleurs – même tout près. Qu’on ne puisse
pas empêcher qu’une confrontation ait lieu n’interdit
pas d’en faire une simple diversion. Plus
encore qu’aux actions, il faut s’attacher à leur coordination.
Harceler la police, c’est faire qu’étant
partout, elle ne soit nulle part efficace.
Chaque acte de harcèlement ranime cette vérité,
énoncée en 1842 : « La vie de l’agent de police
est pénible; sa position au milieu de la société aussi
humiliante et méprisée que le crime même [...] La
honte et l’infamie l’enserrent de toutes parts, la
société le chasse de son sein, l’isole comme un paria,
lui crache son mépris avec sa paie, sans remords,
sans regrets, sans pitié [...] la carte de police qu’il
porte dans sa poche est un brevet d’ignominie.»
Le 21 novembre 2006, les pompiers en manifestation
à Paris ont attaqué les CRS à coups de marteau
et en ont blessé quinze. Cela pour rappeler
qu’« avoir la vocation d’aider » ne pourra jamais
être une excuse valable pour intégrer la police.
Être en armes. Tout faire pour en rendre l’usage
superflu. Face à l’armée, la victoire est politique
Il n’y a pas d’insurrection pacifique. Les armes sont
nécessaires : il s’agit de tout faire pour en rendre
l’usage superflu. Une insurrection est davantage une prise d’armes, une « permanence armée», qu’un
passage à la lutte armée. On a tout intérêt à distinguer
l’armement de l’usage des armes. Les armes
sont une constante révolutionnaire, bien que leur
utilisation soit peu fréquente, ou peu décisive, dans
les moments de grand retournement: 10 août 1792,
18 mars 1871, octobre 1917. Quand le pouvoir est
dans le caniveau, il suffit de le piétiner.
Dans la distance qui nous en sépare, les armes
ont acquis ce double caractère de fascination et de
dégoût, que seul leur maniement permet de surmonter.
Un authentique pacifisme ne peut pas être
refus des armes, seulement de leur usage. Être pacifiste
sans pouvoir faire feu n’est que la théorisation
d’une impuissance. Ce pacifisme a priori
correspond à une sorte de désarmement préventif,
c’est une pure opération policière. En vérité,
la question pacifiste ne se pose sérieusement que
pour qui a le pouvoir de faire feu. Et dans ce cas,
le pacifisme sera au contraire un signe de puissance,
car c’est seulement depuis une extrême position
de force que l’on est délivré de la nécessité de faire
feu.
D’un point de vue stratégique, l’action indirecte,
asymétrique, semble la plus payante, la plus adaptée
à l’époque : on n’attaque pas frontalement une
armée d’occupation. Pour autant, la perspective
d’une guérilla urbaine à l’irakienne, qui s’enliserait
sans possibilité d’offensive, est plus à craindre
qu’à désirer. La militarisation de la guerre civile, c’est l’échec de l’insurrection. Les Rouges peuvent
bien triompher en 1921, la Révolution russe est
déjà perdue.
Il faut envisager deux types de réactions étatiques.
L’une d’hostilité franche, l’autre plus sournoise,
démocratique. La première appelant la destruction
sans phrase, la seconde, une hostilité subtile
mais implacable : elle n’attend que de nous enrôler.
On peut être défait par la dictature comme par
le fait d’être réduit à ne plus s’opposer qu’à la dictature.
La défaite consiste autant à perdre une
guerre qu’à perdre le choix de la guerre à mener.
Les deux sont du reste possibles, comme le prouve
l’Espagne de 1936 : par le fascisme, par la république,
les révolutionnaires y furent doublement
défaits.
Dès que les choses deviennent sérieuses, c’est
l’armée qui occupe le terrain. Son entrée en action
paraît moins évidente. Il faudrait pour cela un État
décidé à faire un carnage, ce qui n’est d’actualité
qu’à titre de menace, un peu comme l’emploi de
l’arme nucléaire depuis un demi-siècle. Il reste que,
blessée depuis longtemps, la bête étatique est dangereuse.
Il reste que face à l’armée, il faut une foule
nombreuse, envahissant les rangs, et fraternisant.
Il faut le 18 mars 1871. L’armée dans les rues, c’est
une situation insurrectionnelle. L’armée entrée
en action, c’est l’issue qui se précipite. Chacun se
voit sommé de prendre position, de choisir entre
l’anarchie et la peur de l’anarchie. C’est comme force politique qu’une insurrection triomphe.
Politiquement, il n’est pas impossible d’avoir raison
d’une armée.
Déposer localement les autorités
La question, pour une insurrection, est de se rendre
irréversible. L’irréversibilité est atteinte lorsque
l’on a vaincu, en même temps que les autorités le
besoin d’autorité, en même temps que la propriété
le goût de s’approprier, en même temps que toute
hégémonie le désir d’hégémonie. C’est pourquoi
le processus insurrectionnel contient en lui-même
la forme de sa victoire, ou celle de son échec. En
fait d’irréversibilité, la destruction n’a jamais suffi.
Tout est dans la manière. Il y a des façons de
détruire qui provoquent immanquablement le
retour de ce que l’on a anéanti. Qui s’acharne sur
le cadavre d’un ordre s’assure de susciter la vocation
de le venger. Aussi, partout où l’économie est
bloquée, où la police est neutralisée, il importe
de mettre le moins de pathos possible dans le renversement
des autorités. Elles sont à déposer avec
une désinvolture et une dérision scrupuleuses.
À la décentralisation du pouvoir répond, dans cette
époque, la fin des centralités révolutionnaires. Il y
a bien encore des Palais d’Hiver, mais qui sont plus
désignés à l’assaut des touristes qu’à celui des insurgés.
On peut prendre Paris, ou Rome, ou Buenos Aires, de nos jours, sans remporter la décision. La
prise de Rungis aurait certainement plus d’effets
que celle de l’Élysée. Le pouvoir ne se concentre
plus en un point du monde, il est ce monde même,
ses flux et ses avenues, ses hommes et ses normes,
ses codes et ses technologies. Le pouvoir est l’organisation
même de la métropole. Il est la totalité
impeccable du monde de la marchandise en chacun
de ses points. Aussi, qui le défait localement produit
au travers des réseaux une onde de choc planétaire.
Les assaillants de Clichy-sous-Bois ont réjoui plus
d’un foyer américain, tandis que les insurgés de
Oaxaca ont trouvé des complices en plein coeur
de Paris. Pour la France, la perte de centralité du
pouvoir signifie la fin de la centralité révolutionnaire
parisienne. Chaque nouveau mouvement
depuis les grèves de 1995 le confirme. Ce n’est plus
là que surgissent les menées les plus osées, les plus
consistantes. Pour finir, c’est comme simple cible
de razzia, comme pur terrain de pillage et de ravage
que Paris se distingue encore. Ce sont de brèves
et brutales incursions venues d’ailleurs qui s’attaquent
au point de densité maximale des flux métropolitains.
Ce sont des traînées de rage qui sillonnent
le désert de cette abondance factice, et s’évanouissent.
Un jour viendra où sera grandement ruinée
cette effroyable concrétion du pouvoir qu’est la capitale,
mais ce sera au terme d’un processus qui sera
partout plus avancé que là.
Tout le pouvoir aux communes !
Dans le métro, on ne trouve plus trace de l’écran de
gêne qui entrave habituellement les gestes des passagers.
Les inconnus se parlent, ils ne s’abordent plus. Une bande
en conciliabule à l’angle d’une rue. Des rassemblements
plus vastes sur les boulevards qui discutent gravement.
Les assauts se répondent d’une ville à l’autre, d’un jour
à l’autre. Une nouvelle caserne a été pillée puis brûlée.
Les habitants d’un foyer expulsé ont cessé de tracter
avec la mairie : ils l’habitent. Dans un accès de
lucidité, un manager vient de refroidir, en pleine
réunion, une poignée de collègues. Des fichiers contenant
l’adresse personnelle de tous les policiers et gendarmes
ainsi que des employés de l’administration
pénitentiaire viennent de fuiter, entraînant une vague
sans précédent de déménagements précipités. Dans l’ancienne
épicerie-bar du village, on apporte l’excédent que
l’on produit et l’on se procure ce qui nous manque. On
s’y réunit aussi pour discuter de la situation générale
et du matériel nécessaire pour l’atelier mécanique. La
radio tient les insurgés informés du recul des forces gouvernementales.
Une roquette vient d’éventrer l’enceinte
de la prison de Clairvaux. Impossible de dire si c’est
un mois ou des années qui se sont écoulés depuis que les «événements » ont commencé. Le Premier ministre a
l’air bien seul avec ses appels au calme.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)










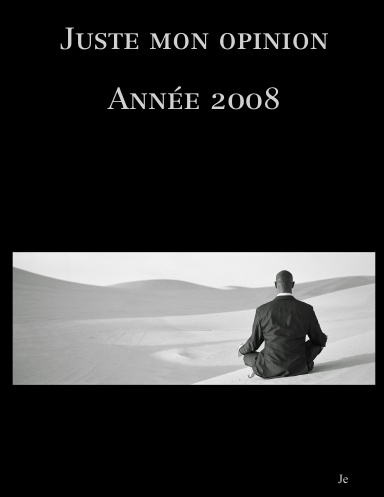
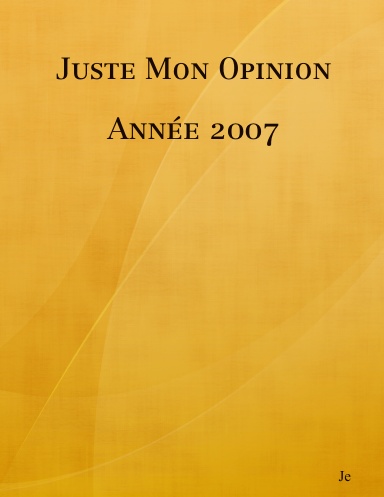
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire