Sur l’école (pages 89 à 91) :
Thomas Déri : Pour ma part, de la maternelle au lycée, j’ai toujours reçu une éducation laïque où la parole du maître était considérée comme la vérité absolue, ce qui ne m’a pas empêché de la remettre en question. Ce n’est évidemment pas la forme d’éducation que les anarchistes préconisent. Considérant que l’école traditionnelle est un instrument de reproduction des structures sociales de domination et d’exploitation, ils essayent d’implanter des systèmes d’éducation libertaire. À ce propos, je te citerai une anecdote personnelle. Je suis passé par le système d’éducation laïque français traditionnel, et le seul moment où on s’interroge sur le système en question, c’est quand on fait appel, comme sujet du baccalauréat, à Rabelais et Voltaire pour disserter sur l’affirmation de Montaigne :
«Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine.» Le paradoxe, c’est que ces dissertations sont corrigées par des professeurs qui sont passés par un système où l’on tient pour acquis qu’une tête bien faite est nécessairement une tête bien pleine. Allez donc ensuite prétendre le contraire.
Mais si l’on revient aux anarchistes qui ont voulu favoriser au maximum l’autonomie de l’élève, on peut citer Paul Robin et l’orphelinat de Cempuis, puis Sébastien Faure et La Ruche en France, Francisco Ferrer et l’Escuela moderna en Espagne, les écoles libertaires de Hambourg en Allemagne et A.S. Neill et l’école de Summerhill en Grande-Bretagne,
entre autres.
Francis Dupuis-Déri : En effet, les anarchistes ont aussi mis sur pied un peu partout des écoles offrant une éducation progressiste aux filles et aux garçons. Ils proposaient dès le XIXe siècle une réorganisation radicale de l’école et de l’éducation : des classes mixtes, où se retrouvaient filles et garçons, et une «éducation intégrale» qui permettait de développer à la fois les compétences manuelles, techniques, intellectuelles et culturelles. On peut presque dire que les anarchistes considéraient que la révolution allait naître autant à l’école qu’à l’usine ou dans la rue. À une époque ou une majorité d’adultes étaient encore illettrés, la formation continue était une priorité, et des anarchistes ont ouvert un peu partout des «universités populaires», en Argentine, à Cuba, au Pérou, en Égypte, et des cercles de
lecture où on lisait à haute voix les journaux et les livres pour les camarades qui ne savaient pas lire. Les anarchistes insistent dès le XIXe siècle sur l’importance de réduire
le pouvoir du maître en abolissant par exemple les punitions corporelles, en limitant la discipline et en offrant des choix aux élèves. Un siècle plus tard, la majorité de la société trouve que plusieurs des idées anarchistes au sujet de l’éducation semblent relever du simple bon sens, sans savoir qu’elles ont été développées et souvent testées par les anarchistes. James Guillaume, un anarchiste proche de Bakounine, considérait que les enfants devaient pouvoir choisir leur enseignant, qui alors «ne ser[ait] plus pour
eux un tyran détesté, mais un ami qu’ils écouter[aient] avec plaisir». Fernand Pelloutier, un syndicaliste révolutionnaire français du début du XXe siècle, pensait aussi qu’il fallait éveiller les enfants aux injustices de la société libérale, former les enfants des pauvres et des exploités à la «science de leur malheur», et les «instruire pour [qu’ils se] révolt[ent]».
Et puis, pourquoi ne pas favoriser l’autogestion chez les enfants ? James Guillaume prévoyait qu’à l’école, «dans leurs réunions, les enfants seront complètement libres : ils organiseront eux-mêmes leurs jeux, leurs conférences, établiront un bureau pour diriger leurs travaux, des arbitres pour juger leurs différends, etc.» Lors d’un campement temporaire autonome et autogéré à Strasbourg en 2002, dans le cadre de la campagne No Border, un espace était réservé aux enfants, qui déléguaient même des mandataires à l’assemblée générale. Ils s’y plaignaient que des adultes ne respectaient pas la propreté des lieux, ou encore que des adultes avaient planté leur tente dans l’espace des enfants. Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler, disant que la police procéderait à l’expulsion des campeurs, les enfants ont déclaré qu’ils voulaient rester, car c’était aussi
leur camp. Leurs parents sont intervenus et les ont emmenés…
Sur la police (pages 104 à 106) :
Thomas : Après l’armée, examinons maintenant le rôle de la police, qui est chargée de faire respecter les lois, et à qui l’État délègue son autorité.
Francis : Selon toi, qu’en pensent les anarchistes ?
Thomas : La police est l’organe de l’État le plus visible et le plus présent dans la vie de tous les jours pour faire appliquer certains règlements et lois. C’est donc le symbole de l’autorité le plus contraignant aux yeux des anarchistes, et quand celle-ci outrepasse ses droits, elle représente une cible de choix pour la critique.
Francis : Eh oui. Les anarchistes sont d’autant plus critiques de la police qu’elle les harcèle et les brutalise depuis toujours. Michel Bakounine, Louise Michel, Pierre Kropotkine et Emma Goldman ont connu la prison et, dans certains cas, l’exil forcé. Certaines situations sont tragiques : les anarchistes italiens, qui ont été parmi les premiers à être jetés en prison par les fascistes de Mussolini, n’ont pas été libérés tout de suite des pénitenciers par le nouveau gouvernement italien après la chute du dictateur ; on les a transférés dans des camps pour les empêcher de nuire. De nos jours, avec le mouvement altermondialiste, qui compte dans ses rangs bien des anarchistes, la répression policière les vise plus spécifiquement, et des milliers d’entre eux sont arrêtés, individuellement
ou lors de manifestations. Outre ce problème, la police, tout comme l’armée, est un corps de métier incompatible avec l’idéal anarchiste de liberté, d’égalité, de solidarité et d’entraide. Il s’agit d’organisations très autoritaires et hiérarchisées qui refusent par principe l’autonomie de leurs membres, exigeant une obéissance aveugle, y compris lorsqu’il s’agit parfois de se faire tuer et d’accepter de tuer de parfaits inconnus, ce qui peut même être récompensé par des médailles et de l’avancement. Et après, on pense encore que l’État assure la paix et la sécurité et que les anarchistes sont violents !
La police comme nous la connaissons est une invention plutôt récente, qui est apparue en France et en Grande-Bretagne vers le XIXe siècle, avant tout pour protéger les riches des pauvres. C’est l’un des penseurs du libéralisme économique, l’Anglais Adam Smith, qui disait : «le gouvernement civil, en tant qu’il a pour objet la sécurité des propriétés,
est, dans la réalité, institué pour défendre les riches contre les pauvres». Il ajoutait que l’État et la police existent pour «permettre aux riches de dormir tranquillement dans leur lit». Les anarchistes sont bien d’accord, ici, avec les libéraux : «sans le gendarme, le propriétaire ne pourrait pas exister», disait l’anarchiste italien Errico Malatesta.
À la question, qui se veut déstabilisante, si souvent posée aux anarchistes, à savoir comment imaginer une société sans police, voici leur réponse : si vous voulez préserver les distinctions entre les dominants et les dominés et entre les riches et les pauvres, alors vous ne pouvez pas vous passer d’une police publique ou privée pour protéger les riches et
mettre les pauvres hors d’état de nuire (en prison, par exemple). Mais le besoin d’une police serait bien moins grand dans une société anarchiste, où il y aurait sans doute peu de crimes à prévenir et à punir puisqu’il n’y aurait plus d’État, ni de propriété privée, ni de dominants et de dominés, ni de riches et de pauvres. Qui désobéira à qui, alors, et qui volera qui ? Bref, les anarchistes ne sont pas convaincus par l’idéologie dominante
qui voit dans le premier venu un meurtrier, un violeur ou un voleur potentiel. Cette peur est d’ailleurs entretenue par la philosophie politique inspirée de Thomas Hobbes et du darwinisme social, entre autres, et surtout par les médias de masse et les films à suspens, les films policiers et même les films d’horreur. En situation de justice, de liberté et d’égalité, il devrait y avoir beaucoup moins de violence dans la société.
Mais que faire si un maniaque armé d’une tronçonneuse attaque ses voisins ? Alors, la communauté se réunira probablement pour trouver, ensemble, une solution : il serait possible de le forcer à l’exil, de le forcer à suivre une thérapie, de proposer un rituel collectif de réconciliation et de réhabilitation, etc. À titre préventif, on peut aussi imaginer un service bénévole de volontaires qui accourraient quand une personne appellerait à
l’aide. Ce ne sont pas de bonnes solutions ? Si vous avez d’autres idées, vous aurez l’occasion d’en discuter dans votre assemblée et de participer à la décision collective pour que soit gérée ensemble cette délicate situation plutôt que de laisser des policiers et des juges faire régner un ordre et une loi qui vous seraient imposés.
Mais la justice populaire est dangereuse, et le peuple assoiffé de lynchage, dira-t-on. Ah ! Bon ? Que dire alors des interventions policières qui s’effectuent souvent de manière brutale et discriminatoire ? Et des juges qui sont de mèche avec la classe dominante, à laquelle ils appartiennent, d’ailleurs ? Les anarchistes savent surtout que «notre»
système actuel de traitement de la criminalité par la police, les tribunaux et les prisons représente une catastrophe humaine. La prison est «une école du crime», comme le veut l’expression populaire. Et avouons-le : quel manque d’imagination que d’enfermer un individu indésirable entre quatre murs et de verrouiller la porte !
Sur les communs (pages 109 et 110) :
Francis : […] Au sujet de la dichotomie entre le public et le privé, des anarchistes proposent, dès le XIXe siècle, une troisième option, le «commun». Marianne Enckell, qui s’occupe du CIRA à Lausanne, rappelle que des anarchistes participant au congrès de l’Internationale fédéraliste, à Bruxelles en 1874, proposent que les «services publics»
soient la responsabilité des communes autonomes et fédérées, fonctionnant selon le principe de l’entraide et non pas d’un «État omnipotent». Or le drame, en Occident aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pratiquement plus de ressources économiques communes, il n’y a plus de commun : tout a été soit privatisé, soit «nationalisé», accaparé par l’État
sous le nom de «biens publics».










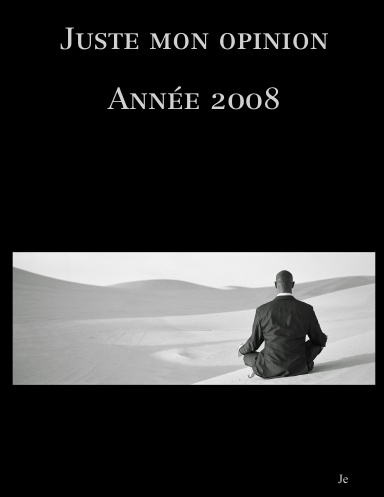
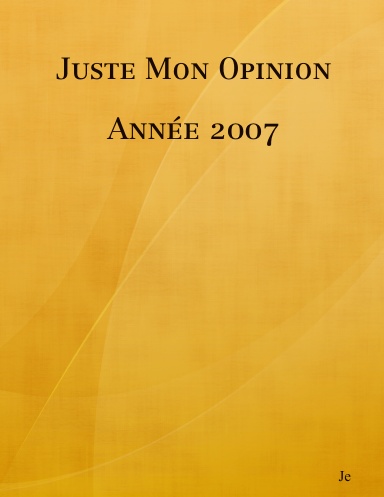
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire