“La révolte est, dans l’homme, le refus d’être traité en chose et
d’être réduit à la simple histoire. Elle est l’affirmation d’une nature
commune à tous les hommes, qui échappe au monde, la puissance.”
« Résister, c’est d’abord ne pas consentir au mensonge. »
~ Albert Camus ~

Albert Camus et les anarchistes
Nick Heath
2007
Né en Algérie française en 1913 dans une famille pauvre, Camus perdit
son père lors de la bataille de la Marne en 1916. Il fut élevé par sa
mère, analphabète, qui travailla comme femme de ménage. Ayant obtenu une
bourse d’études, Camus entama finalement une carrière de journaliste.
Dans sa jeunesse, il pratiqua le football et fit partie d’une troupe de
théâtre.
Depuis l’époque où il était gardien de but, Albert Camus a toujours
eu l’esprit d’équipe. De nature généreuse et sensible, il chercha
toujours la cohésion, en évitant ou en dépassant les rancœurs. Beaucoup d’intellectuels qui écrivirent sur Camus occultèrent son soutien à l’anarchisme.
Il fut toujours là pour soutenir le mouvement anarchiste dans les
moments les plus difficiles, même s’il estimait ne pas pouvoir s’y
engager totalement
Camus lui-même n’a jamais caché son attrait pour l’anarchisme. Les idées anarchistes furent présentes dans ses pièces de théâtre et ses romans, comme par exemple La Peste, L’État de siège ou Les Justes. Il connaissait depuis 1945 l’anarchiste Gaston Leval, qui avait écrit sur la révolution espagnole.
Camus avait exprimé son admiration pour les syndicalistes
révolutionnaires, les anarchistes, les objecteurs de conscience et tous
les rebelles dès 1938, alors qu’il travaillait comme journaliste à
L’Alger Républicaine, selon son ami Pascal Pia.
L’anarchiste André Prudhommeaux le présenta lors d’une réunion du
Cercle des Étudiants Anarchistes en 1948 comme un sympathisant familier
de la pensée anarchiste.
Camus soutint également les Groupes de Liaison Internationale qui
cherchaient à aider les opposants au fascisme et au stalinisme et qui
refusèrent de prendre le parti du capitalisme américain. Créés en
1947-48, ces groupes avaient pour but d’apporter un soutien matériel aux
victimes des régimes autoritaires ainsi que d’échanger des
informations. Parmi les sympathisants, on trouve l’anarchiste russe
Nicolas Lazarevitch, exilé en France, ainsi que de nombreux
sympathisants du journal syndicaliste révolutionnaire La Révolution
Prolétarienne. Camus resta un ami et un soutien financier de la RP
jusqu’à sa mort.
Le livre d’Albert Camus, “L’Homme révolté”, publié en 1951,
marqua une rupture nette entre lui et la gauche du Parti communiste. Il
fut accueilli avec hostilité par les membres du Parti communiste et
autres compagnons de route. Son message fut cependant compris par les
anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires de France et
d’Espagne, car il mentionne ouvertement le syndicalisme révolutionnaire
et l’anarchisme et fait une distinction claire entre le socialisme
autoritaire et le socialisme libertaire. Le thème principal est de
savoir comment faire une révolution sans recourir à la terreur et aux
méthodes « césaristes ». Camus traita donc de Bakounine et de Nechaev,
entre autres. « La commune contre l’État, la société concrète contre
la société absolutiste, la liberté réfléchie contre la tyrannie
rationnelle, l’individualisme altruiste enfin contre la colonisation des
masses… »
Il termine par un appel à la résurrection de l’anarchisme.
La pensée autoritaire, après trois guerres et la destruction physique
d’une élite de rebelles, avait noyé cette tradition libertaire. Mais ce
fut une piètre victoire, une victoire provisoire, et la lutte continue.
Gaston Leval y répondit dans une série d’articles. Sur un ton
amical, évitant toute polémique virulente, il interpella Camus sur ce
qu’il considérait comme une caricature de Bakounine. Camus se
défendit dans les pages du Libertaire, le journal de la Fédération
anarchiste (le tirage de ce journal atteignait 100 000 exemplaires par
semaine à cette époque). Il affirma qu’il avait agi de bonne foi et
qu’il corrigerait l’un des passages critiqués par Leval dans les
prochaines éditions.
NdR71 : le bouquin lourdement annoté et
aux passages soulignés, passés au “stabylo” de l’un d’entre nous,
comporte cette note manuscrite de marge effectuée par ses soins pour la
postérité des futurs lecteurs, depuis une trentaine d’années ou plus
(p.201-203, édition Folio) : “Bakounine n’est pas un nihiliste !!”
Comment Camus a t’il pu faire un tel contresens sur ce sujet ?.. Camus
était un érudit sur Nietzsche, qui lui-même définissait le nihilisme
comme la négation, la dépréciation (volontaire) de l’existence. Quel
anarchiste entre dans cette catégorie ? Même les adeptes de la
“propagande par le fait” n’avait pas cette vision du monde pour
l’essentiel. Ceci dit, nous considérons ici, « L’homme révolté » de
Camus comme une des plus puissantes œuvres écrites de l’histoire de
l’humanité.
Le secrétaire général de la Fédération anarchiste, Georges Fontenis,
avait également critiqué le livre de Camus dans Le Libertaire. À la
question titrée « La révolte de Camus est-elle la même que la nôtre ? »,
Fontenis avait répondu par l’affirmative. Il lui avait cependant
reproché de ne pas accorder une place suffisante aux révolutions en
Ukraine et en Espagne, d’avoir présenté Bakounine comme un nihiliste
endurci et de ne pas avoir accordé plus de mérite à ses positions
anarchistes spécifiques. Il avait terminé en admettant que le livre
contenait quelques pages admirables. La semaine suivante, Jean Vita
avait publié dans Le Libertaire une critique plus chaleureuse et plus positive.
Ces critiques mesurées provenant des anarchistes contrastaient avec
celles provenant du parti communiste, telles que celles de Sartre et du
groupe du magazine Les Temps Modernes. Celles-ci marquèrent le
début de la rupture entre Camus et cet autre grand défenseur de
l’existentialisme. Les critiques du groupe furent sauvages,
particulièrement celles de Francis Jeanson. Camus répliqua que la
critique de Jeanson était marxiste orthodoxe et qu’il avait ignoré tout
passage sur l’anarchisme et le syndicalisme. « La première
internationale, le mouvement de Bakounine, qui vit encore dans les
masses de la CNT espagnole et française, est ignorée », écrivit
Camus. Pour ses peines, Camus fut « excommunié » par Jeanson des rangs
existentialistes. Ces méthodes démoralisèrent Camus. Il reçut également
une sévère critique des surréalistes sur les conceptions artistiques du
livre. Il semblait alors que le mouvement anarchiste était son meilleur
soutien.
Camus marqua cette rupture de différentes manières. Il s’engagea à se
tenir à l’écart des intellectuels prêts à soutenir le stalinisme. Cela
ne l’empêcha pas de s’engager sans réserve dans des causes qu’il jugeait
justes et utiles. En Espagne, un groupe d’ouvriers anarchistes avait
été condamné à mort par Franco. À Paris, la Ligue des droits de l’Homme
convoqua une réunion le 22 février 1952. Camus accepta d’y prendre la
parole. Il pensait qu’il serait utile que le chef des surréalistes,
André Breton, montât sur le podium. Et ce, malgré l’attaque de Breton
dans la revue Arts, à propos des critiques de Camus sur le poète Lautréamont, admiré par les surréalistes comme l’un de leurs précurseurs.

Camus rencontra les organisateurs de l’événement, Fernando Gómez Peláez, du journal Solidaridad Obrera,
organe du syndicat anarcho-syndicaliste espagnol CNT, et José Ester
Borrás, secrétaire de la fédération espagnole des prisonniers politiques
FEDIP, et leur demanda d’approcher Breton sans lui dire que Camus
l’avait suggéré. Breton accepta de prendre la parole lors de la réunion,
même si Camus était présent. Gómez dit alors à Breton que c’était Camus
qui lui avait suggéré de prendre la parole, ce qui émut Breton aux
larmes. Plus tard, Camus dit aux anarchistes espagnols que, parce qu’il
n’avait pas répondu à la colère de Breton en nature, une
quasi-réconciliation était possible. Camus et Breton partagèrent le
podium et furent même vus en train de discuter (pour les liens entre
Breton et les surréalistes et le mouvement anarchiste, voir libcom.org).
Camus adopta une position d’intellectuel engagé, signant des pétitions et écrivant pour les magazines Le Libertaire, La Révolution Prolétarienne et Solidaridad Obrera. Il fit également partie du comité de rédaction d’une petite revue libertaire, Témoins 1956,
et fit la connaissance de son rédacteur en chef, Robert Proix,
correcteur d’imprimerie de métier. Camus, par l’intermédiaire de Proix,
rencontra Giovanna Berneri (Caleffi), la compagne de l’anarchiste
italien surdoué Camillo Berneri, assassiné par les staliniens en Espagne
en 1937. Camus rencontra également Rirette Maitrejean, ancienne
compagne de Victor Serge, impliquée dans l’affaire et le procès de la
bande à Bonnot. Rirette avait longtemps travaillé comme correctrice pour
le journal Paris-Soir. Camus devint également l’ami du
vétéran anarchiste Maurice Joyeux, qui dira plus tard que, de toutes les
œuvres littéraires contemporaines, L’Homme révolté était le livre qui avait le mieux défini les aspirations des étudiants et des travailleurs de mai 1968.
En 1954, Camus vint à nouveau en aide aux anarchistes. Maurice
Laisant, secrétaire à la propagande des Forces Libres de la Paix et
rédacteur du Monde Libertaire, journal de la Fédération
anarchiste, avait réalisé une affiche antimilitariste sur le modèle de
la propagande officielle de l’armée. Il fut inculpé de subversion.
Camus, témoin de caractère à son procès, rappela comment il l’avait
rencontré pour la première fois lors de la réunion publique espagnole.
Camus déclara au tribunal : « Depuis, je l’ai parfois revu et j’ai
pu admirer sa volonté de lutter contre le fléau qui menace le genre
humain. Il me semble impossible que l’on puisse condamner un homme dont
l’action s’identifie si complètement avec l’intérêt de tous les autres
hommes. Trop rares sont ceux qui se lèvent contre un danger chaque jour
plus terrible pour l’humanité« . On rapporta qu’après sa
déclaration, Camus prit place dans une salle d’audience composée
principalement de militants ouvriers, qui l’entourèrent d’affection.
Malheureusement, Laisant fut condamné à une lourde amende.
Camus se rangea également aux côtés des anarchistes lorsqu’ils
exprimèrent leur soutien à la révolte des travailleurs contre les
Soviétiques en Allemagne de l’Est en 1953. Il se rangea à
nouveau aux côtés des anarchistes en 1956, d’abord lors du soulèvement
ouvrier de Poznan, en Pologne, puis, plus tard dans l’année, lors de la
révolution hongroise. Plus tard, en 1955, Camus apporta son soutien à
Pierre Morain, membre de la Fédération communiste libertaire (la
Fédération anarchiste avait changé de nom en 1954 à la suite de luttes
rancunières au sein de l’organisation). Morain fut le tout premier
Français à être emprisonné pour ses positions anticolonialistes sur
l’Algérie. Camus lui apporta son soutien dans les pages du quotidien
national L’Express du 8 novembre 1955.
Camus utilisa à maintes reprises sa célébrité ou sa notoriété
pour intervenir dans la presse afin d’arrêter la persécution de
militants anarchistes ou d’alerter l’opinion publique. La
dernière année de sa vie, Camus s’installa dans le village provençal de
Lourmarin. C’est là qu’il fit la connaissance de Franck Creac’h. Breton,
né à Paris, autodidacte et anarchiste convaincu, il était venu au
village pendant la guerre pour se « démobiliser ». Camus l’employa comme
jardinier et eut l’avantage de pouvoir discuter avec quelqu’un qui
était sur la même longueur d’onde. L’une des dernières campagnes
auxquelles Camus participa fut celle de l’anarchiste Louis Lecoin qui se
battait pour le statut des objecteurs de conscience en 1958. Camus ne
vit jamais l’aboutissement de cette campagne, puisqu’il mourut dans un
accident de voiture en 1960, à l’âge de quarante-six ans.
Source : https://resistance71.wordpress.com/2025/01/22/albert-camus-les-anarchistes-et-lantidote-a-labsurdite-etatico-marchande/

 C'est
en 589 qu'ils apparaissent pour la première fois comme un ensemble
constitué, lorsqu’ils sont intégrés à l’armée turque pour attaquer les
Perses. À cette date, il s’agit encore d’une tribu sans grande
importance, basée dans le Daghestan actuel, situé dans le Caucase.
C'est
en 589 qu'ils apparaissent pour la première fois comme un ensemble
constitué, lorsqu’ils sont intégrés à l’armée turque pour attaquer les
Perses. À cette date, il s’agit encore d’une tribu sans grande
importance, basée dans le Daghestan actuel, situé dans le Caucase. Pris
en tenaille, les Perses sont enfin vaincus. La catastrophe annoncée
s’est transformée en victoire miraculeuse, propulsant les Khazars sur
les devants de la scène de l’Histoire. Vers 670, ils dominent un immense
territoire, allant de l’embouchure du Danube jusqu’à la mer Caspienne,
avec un centre de gravité situé sur la basse-Volga, dont Atil est la
capitale. La Crimée passe
alors progressivement sous leur domination, à l’exception de
l’important port grec de Chersonèse (la Sébastopol actuelle). Ce
vaste empire Khazar va jouer un rôle fondamental aux VIIIe et IXe
siècles...
Pris
en tenaille, les Perses sont enfin vaincus. La catastrophe annoncée
s’est transformée en victoire miraculeuse, propulsant les Khazars sur
les devants de la scène de l’Histoire. Vers 670, ils dominent un immense
territoire, allant de l’embouchure du Danube jusqu’à la mer Caspienne,
avec un centre de gravité situé sur la basse-Volga, dont Atil est la
capitale. La Crimée passe
alors progressivement sous leur domination, à l’exception de
l’important port grec de Chersonèse (la Sébastopol actuelle). Ce
vaste empire Khazar va jouer un rôle fondamental aux VIIIe et IXe
siècles...









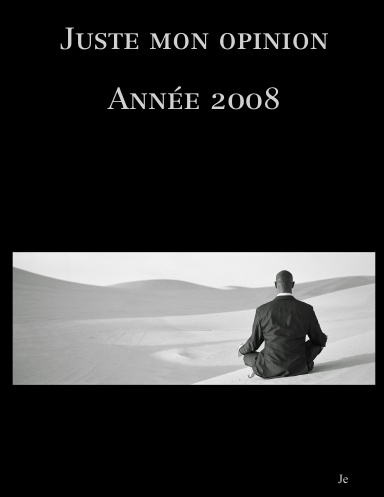
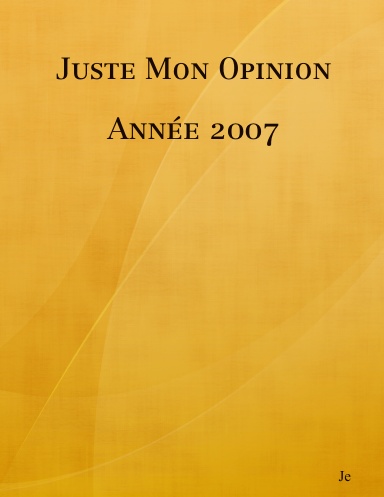

%20EPSTEIN%20WUHAN%20EFFETS%20SECONDAIRES%20ETC.%20%F0%9F%94%B4%20Complot%20mais...%20%F0%9F%A4%94%20-%20YouTube.png)


%20%E2%9A%A0%EF%B8%8F%20LA%20BOMBE%20DU%20SI%C3%88CLE%20Ils%20savaient%20pour%20le%20labo%20les%20vaccins%20et%20les%20milliards%20vol%C3%A9s.%20%23pfizergate%20-%20YouTube.png)





%20Facebook.png)





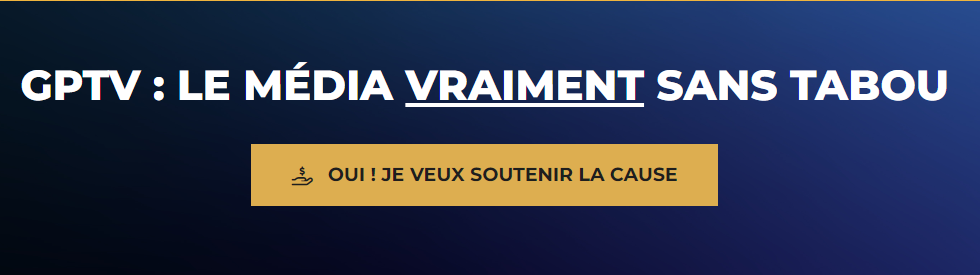

%20Free%20America%20from%20A.I.P.A.C!%20%F0%9F%94%A5%20%23palestine%20%23israel%20%23politics%20%23usa%20%23uk%20%23congress%20%23news%20%23canada%20%23europe%20-%20YouTube.png)

%20ALAIN%20SORAL%20LE%20PEN%20TRUMP%20HOLLYWOOD%20CANDACE%20OWENS%20G%C3%89OPOLITIQUE...%20-%20YouTube.png)


