De l’ethnocide
Pierre Clastres
1974
II y a quelques années, le terme d’ethnocide n’existait pas*.
Bénéficiant des faveurs passagères de la mode et, plus sûrement, de son
aptitude à répondre à une demande, à satisfaire un besoin certain de
précision terminologique, l’utilisation du mot a largement et rapidement
dépassé son lieu d’origine, l’ethnologie, pour tomber en quelque sorte
dans le domaine public. Mais la diffusion accélérée d’un mot
assure-t-elle à l’idée qu’il a mission de véhiculer le maintien de la
cohérence et de la rigueur souhaitables ? Il n’est pas évident que la
compréhension profite de l’extension et qu’en fin de compte, on sache de
manière parfaitement claire de quoi l’on parle lorsqu’on se réfère à
l’ethnocide. Dans l’esprit de ses inventeurs, le mot était assurément
destiné à traduire une réalité qu’aucun autre terme n’exprimait. Si l’on
a ressenti la nécessité de créer un mot nouveau, c’est qu’il y avait à
penser quelque chose de nouveau, ou bien quelque chose d’ancien mais non
encore pensé. En d’autres termes, on estimait inadéquat, ou impropre à
remplir cette exigence nouvelle, un autre mot, d’usage depuis plus
longtemps répandu, celui de génocide. On ne peut par conséquent
inaugurer une réflexion sérieuse sur l’idée d’ethnocide sans tenter au
préalable de déterminer ce qui distingue le phénomène ainsi désigné de
la réalité que nomme le génocide.
Créé en 1946 au procès de Nuremberg, le concept juridique de génocide
est la prise en compte au plan légal d’un type de criminalité jusque-là
inconnu. Plus précisément, il renvoie à la première manifestation,
dûment enregistrée par la loi, de cette criminalité : l’extermination
systématique des Juifs européens par les Nazis allemands. Le délit
juridiquement défini de génocide s’enracine donc dans le racisme, il en
est le produit logique et, à la limite, nécessaire : un racisme qui se
développe librement, comme ce fut le cas dans l’Allemagne nazie, ne peut
conduire qu’au génocide. Les guerres coloniales qui se sont succédé
depuis 1945 à travers le Tiers-Monde et qui, pour certaines, durent
encore, ont d’autre part donné lieu à des accusations précises de
génocide contre les puissances coloniales. Mais le jeu des relations
internationales et l’indifférence relative de l’opinion publique ont
empêché l’institution d’un consensus analogue à celui de Nuremberg : il
n’y eut jamais de poursuites.
Si le génocide antisémite des Nazis fut le premier à être jugé
au nom de la loi, il n’était pas en revanche le premier à être perpétré. L’histoire de l’expansion occidentale au xixe siècle, l’histoire
de la constitution d’empires coloniaux par les grandes puissances
européennes est ponctuée de massacres méthodiques de populations
autochtones. Néanmoins, par son extension continentale, par
l’ampleur de la chute démographique qu’il a provoquée, c’est le génocide
dont furent victimes les indigènes américains qui retient le plus
l’attention. Dès la découverte de l’Amérique en 1492, se mit en
place une machine de destruction des Indiens. Cette machine continue à
fonctionner, là où subsistent, au long de la grande forêt amazonienne,
les dernières tribus « sauvages ». Au cours de ces dernières
années, des massacres d’Indiens ont été dénoncés au Brésil, en Colombie,
au Paraguay. Toujours en vain.
Or, c’est principalement à partir de leur expérience américaine
que les ethnologues, et tout particulièrement Robert Jaulin, ont été
amenés à formuler le concept d’ethnocide. C’est d’abord à la
réalité indienne d’Amérique du Sud que se réfère cette idée. On dispose
donc là d’un terrain favorable, si l’on peut dire, à la recherche de la
distinction entre génocide et ethnocide, puisque les dernières
populations indigènes du continent sont simultanément victimes de ces
deux types de criminalité. Si le terme de génocide renvoie à l’idée de «
race » et à la volonté d’extermination d’une minorité raciale, celui
d’ethnocide fait signe non pas vers la destruction physique des hommes
(auquel cas on demeurerait dans la situation génocidaire), mais vers la
destruction de leur culture. L’ethnocide, c’est donc la
destruction systématique des modes de vie et de pensée de gens
différents de ceux qui mènent cette entreprise de destruction. En somme,
le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue
dans leur esprit. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit bien
toujours de la mort, mais d’une mort différente : la suppression
physique et immédiate, ce n’est pas l’oppression culturelle aux effets
longtemps différés, selon la capacité de résistance de la minorité
opprimée. Il n’est pas ici question de choisir entre deux maux le
moindre : la réponse est trop évidente, mieux vaut moins de barbarie que
plus de barbarie. Ceci dit, c’est à la vraie signification de
l’ethnocide qu’il s’agit de réfléchir.
Il partage avec le génocide une vision identique de l’Autre :
l’Autre, c’est la différence, certes, mais c’est surtout la mauvaise
différence. Ces deux attitudes se séparent sur la nature du traitement
qu’il faut réserver à la différence. L’esprit, si l’on peut dire,
génocidaire veut purement et simplement la nier. On extermine les
autres parce qu’ils sont absolument mauvais. L’ethnocide, en revanche,
admet la relativité du mal dans la différence : les autres sont mauvais,
mais on peut les améliorer, en les obligeant à se transformer jusqu’à
se rendre, si possible, identiques entreprise de destruction. En somme,
le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue
dans leur esprit. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit bien
toujours de la mort, mais d’une mort différente : la suppression
physique et immédiate, ce n’est pas l’oppression culturelle aux effets
longtemps différés, selon la capacité de résistance de la minorité
opprimée. Il n’est pas ici question de choisir entre deux maux le
moindre : la réponse est trop évidente, mieux vaut moins de barbarie que
plus de barbarie. Ceci dit, c’est à la vraie signification de
l’ethnocide qu’il s’agit de réfléchir.
Il partage avec le génocide une vision identique de l’Autre : l’Autre, c’est la différence, certes, mais c’est surtout la mauvaise différence. Ces
deux attitudes se séparent sur la nature du traitement qu’il faut
réserver à la différence. L’esprit, si l’on peut dire, génocidaire veut
purement et simplement la nier. On extermine les autres parce
qu’ils sont absolument mauvais. L’ethnocide, en revanche, admet la
relativité du mal dans la différence : les autres sont mauvais, mais on
peut les améliorer, en les obligeant à se transformer jusqu’à se rendre,
si possible, identiques au modèle qu’on leur propose, qu’on leur impose. La négation ethnocidaire de l’Autre conduit à une identification à soi. On pourrait opposer le génocide et l’ethnocide comme deux formes perverses du pessimisme et de l’optimisme. En
Amérique du Sud, les tueurs d’Indiens poussent à son comble la position
de l’Autre comme différence : l’Indien sauvage n’est pas un être
humain, mais un simple animal. Le meurtre d’un Indien n’est pas un acte
criminel, le racisme en est même totalement évacué, puisqu’il implique
en effet, pour s’exercer, la reconnaissance d’un minimum d’humanité en
l’Autre. Monotone répétition d’une très ancienne infamie :
traitant, avant la lettre, de l’ethnocide, Claude Lévi- Strauss rappelle
dans Race et histoire comment les Indiens des Isles se demandaient si
les Espagnols nouveau venus étaient des dieux ou des hommes, tandis que
les Blancs s’interrogeaient sur la nature humaine ou animale des
indigènes.
Qui sont, d’autre part, les praticiens de l’ethnocide ? Qui s’attaque à l’âme des peuples ? Apparaissent au premier rang, en Amérique du Sud mais aussi en bien d’autres régions, les missionnaires.
Propagateurs militants de la foi chrétienne, ils s’efforcent de
substituer aux croyances barbares des païens la religion de l’Occident. La
démarche évangélisatrice implique deux certitudes : d’abord que la
différence — le paganisme — est inacceptable et doit être refusée ;
ensuite que le mal de cette mauvaise différence peut être atténué, voire
aboli. C’est en cela que l’attitude ethnocidaire est plutôt
optimiste : l’Autre, mauvais au départ, y est supposé perfectible, on
lui reconnaît les moyens de se hausser, par identification, à la
perfection que représente le christianisme. Briser la force de la
croyance païenne, c’est détruire la substance même de la société. Aussi
bien s’agit-il du résultat recherché : conduire l’indigène, par le
chemin de la vraie foi, de la sauvagerie à la civilisation. L’ethnocide s’exerce pour le bien du Sauvage. Le discours laïque ne dit pas autre chose lorsqu’il énonce, par exemple, la doctrine officielle du gouvernement brésilien quant à la politique indigéniste. « Nos
Indiens, proclament les responsables, sont des êtres humains comme les
autres. Mais la vie sauvage qu’ils mènent dans les forêts les condamne à
la misère et au malheur. C’est notre devoir que de les aider à
s’affranchir de la servitude. Ils ont le droit de s’élever à la dignité
de citoyens brésiliens, afin de participer pleinement au développement
de la société nationale et de jouir de ses bienfaits. » La spiritualité de l’ethnocide, c’est l’éthique de l’humanisme.
L’horizon sur lequel prennent figure l’esprit et la pratique
ethnocidaires se détermine selon deux axiomes. Le premier proclame la
hiérarchie des cultures : il en est d’inférieures, il en est de
supérieures. Quant au second, il affirme la supériorité absolue de la
culture occidentale. Celle-ci ne peut donc entretenir avec les autres,
et singulièrement les cultures primitives, qu’une relation de négation.
Mais il s’agit d’une négation positive, en ce qu’elle veut supprimer
l’inférieur en tant qu’inférieur pour le hisser au niveau du supérieur.
On supprime l’indianité de l’Indien pour en faire un citoyen brésilien.
Dans la perspective de ses agents, l’ethnocide ne saurait être par suite
une entreprise de destruction : il est au contraire une tâche
nécessaire, exigée par l’humanisme inscrit au cœur de la culture
occidentale.
On nomme ethnocentrisme cette vocation à mesurer les différences à l’aune de sa propre culture. L’Occident serait ethnocidaire parce qu’il est ethnocentriste, parce qu’il se pense et se veut la civilisation. Une
question néanmoins se pose : notre culture détient-elle le monopole de
l’ ethnocentrisme ? L’expérience ethnologique permet d’y répondre.
Considérons la manière dont les sociétés primitives se nomment
elles-mêmes. On s’aperçoit qu’en réalité il n’y a pas
d’auto-dénomination, dans la mesure où, en mode récurrent, les sociétés
s’attribuent presque toujours un seul et même nom : les Hommes.
Illustrant de quelques exemples ce trait culturel, on rappellera que les
Indiens Guarani se nomment Ava, qui signifie les hommes ; que les
Guayaki disent d’eux-mêmes qu’ils sont Aché, les « Personnes » ; que les
Waika du Venezuela se proclament Yanomami, les « Gens » ; que les
Eskimos sont des Innuit, des « Hommes ». On pourrait indéfiniment
allonger la liste de ces noms propres qui composent un dictionnaire où
tous les mots ont le même sens : hommes. Inversement, chaque société
désigne systématiquement ses voisins de noms péjoratifs, méprisants,
injurieux.
Toute culture opère ainsi un partage de l’humanité entre d’une part
elle-même, qui s’affirme comme représentation par excellence de
l’humain, et les autres, qui ne participent qu’à un moindre titre à
l’humanité. Le discours que tiennent sur elles-mêmes les sociétés
primitives, discours condensé dans les noms qu’elles se confèrent, est
donc ethnocentriste de part en part : affirmation de la supériorité de
son soi culturel, refus de reconnaître les autres comme des égaux. L’
ethnocentrisme apparaît alors la chose du monde la mieux partagée et,
de ce point de vue au moins, la culture de l’Occident ne se distingue
pas des autres. Il convient même, poussant un peu plus loin
l’analyse, de penser l’ ethnocentrisme comme une propriété formelle de
toute formation culturelle, comme immanent à la culture elle-même. Il
appartient à l’essence de la culture d’être ethnocentriste, dans la
mesure exacte où toute culture se considère comme la culture par
excellence. En d’autres termes, l’altérité culturelle n’est jamais
appréhendée comme différence positive, mais toujours comme infériorité
sur un axe hiérarchique.
Il n’en reste pas moins que si toute culture est
ethnocentriste, seule l’occidentale est ethnocidaire. Il s’ensuit donc
que la pratique ethnocidaire ne s’articule pas nécessairement à la
conviction ethnocentriste. Sinon, toute culture devrait être
ethnocidaire : or, ce n’est pas le cas. C’est à ce niveau, nous
semble-t-il, que se laisse repérer une certaine insuffisance de la
réflexion que mènent, depuis un certain temps, les chercheurs que
préoccupe à juste titre le problème de l’ethno- cide. Il ne suffit pas
en effet de reconnaître et d’affirmer la nature et la fonction
ethnocidaires de la civilisation occidentale. Tant que l’on se contente
de déterminer le monde blanc comme monde ethnocidaire, on reste à la
surface des choses, on demeure en la répétition, légitime certes car
rien n’a changé, d’un discours déjà prononcé puisqu’ aussi bien l’évêque
Las Casas par exemple, dès l’aube du xvie siècle, dénonçait en termes
fort précis le génocide et l’ethnocide que les Espagnols faisaient subir
aux Indiens des Isles et du Mexique. De la lecture des travaux
consacrés à l’ethnocide, on retire l’impression que pour leurs auteurs
la civilisation occidentale est une sorte d’abstraction, sans racines
socio-historiques, une vague essence qui, de tout temps, enveloppa en
soi l’esprit ethnocidaire. Or, notre culture n’est en rien une
abstraction, elle est le produit lentement constitué d’une histoire,
elle relève d’une recherche généalogique. Qu’est-ce qui fait que la civilisation occidentale est ethnocidaire ? Telle est la vraie question.
L’analyse de l’ethnocide implique, au delà de la dénonciation des
faits, une interrogation sur la nature, historiquement déterminée, de
notre monde culturel. C’est donc vers l’histoire qu’il s’agit de se
tourner.
Pas plus qu’abstraction extra-temporelle, la civilisation de
l’Occident n’est une réalité homogène, un bloc indifférencié identique
en toutes ses parties. C’est pourtant l’image que paraissent en donner
les auteurs cités plus haut. Mais si l’Occident est ethnocidaire comme
le soleil est lumineux, alors ce fatalisme rend inutile, et même
absurde, la dénonciation des crimes et l’appel à la protection des
victimes. Ne serait-ce point au contraire parce que la civilisation
occidentale est ethnocidaire d’abord à l’intérieur d’elle-même qu’elle
peut l’être ensuite à l’extérieur, c’est-à-dire contre les autres
formations culturelles ? On ne peut pas penser la vocation ethnocidaire
de la société occidentale sans l’articuler à cette particularité de
notre propre monde, particularité qui est même le critère classique de
distinction entre les Sauvages et les Civilisés, entre le monde primitif
et le monde occidental : le premier regroupe l’ensemble des sociétés
sans État, le second se compose de sociétés à État. Et c’est à cela
qu’il faut tenter de réfléchir : peut-on légitimement mettre en
perspective ces deux propriétés de l’Occident, comme culture
ethnocidaire, comme société à État ? S’il en était ainsi, on
comprendrait pourquoi les sociétés primitives peuvent être
ethnocentristes sans être pour autant ethnocidaires, puisqu’elles sont
précisément des sociétés sans État.
L’ethnocide, est-il admis, c’est la suppression des différences
culturelles jugées inférieures et mauvaises, c’est la mise en œuvre d’un
principe d’identification, d’un projet de réduction de l’autre au même
(l’Indien amazonien supprimé comme autre et réduit au même comme citoyen
brésilien). En d’autres termes, l’ethnocide aboutit à la dissolution du
multiple dans l’Un. Qu’en est-il maintenant de l’État ? Il est, par
essence, la mise en jeu d’une force centripète, laquelle tend, lorsque
les circonstances l’exigent, à écraser les forces centrifuges inverses. L’État
se veut et se proclame le centre de la société, le tout du corps
social, le maître absolu des divers organes de ce corps. On découvre
ainsi, au cœur même de la substance de l’État, la puissance agissante de
l’Un, la vocation de refus du multiple, la crainte et l’horreur de la
différence. A ce niveau formel où nous nous situons
actuellement, on constate que la pratique ethnocidaire et la machine
étatique fonctionnent de la même manière et produisent les mêmes effets :
sous les espèces de la civilisation occidentale ou de l’État, se
décèlent toujours la volonté de réduction de la différence et de
l’altérité, le sens et le goût de l’identique et de l’Un.
Quittant cet axe formel et en quelque sorte structuraliste pour
aborder celui de la diachronie, de l’histoire concrète, considérons la
culture française comme cas particulier de la culture occidentale, comme
illustration exemplaire de l’esprit et du destin de l’Occident. Sa
formation, enracinée dans un passé séculaire, apparaît strictement
coextensible à l’expansion et au renforcement de l’appareil d’État,
d’abord sous sa forme monarchique, ensuite sous sa forme républicaine. A
chaque développement du pouvoir central correspond un déploiement accru
du monde culturel. La culture française est une culture nationale, une
culture du français. L’extension de l’autorité de l’État se traduit dans
l’expansionnisme de la langue de l’État, le français. La nation peut se
dire constituée, l’État se proclamer détenteur exclusif du pouvoir
lorsque les gens sur qui s’exerce l’autorité de l’État parlent la même
langue que lui. Ce processus d’intégration passe évidemment par la
suppression des différences. C’est ainsi qu’à l’aurore de la nation
française, lorsque la France n’était que la Franchimanie et son roi un
pâle seigneur du nord de la Loire, la croisade des Albigeois s’abattit
sur le Sud pour en abolir la civilisation. L’extirpation de l’hérésie
cathare, prétexte et moyen d’expansion pour la monarchie capétienne,
traçant les limites presque définitives de la France, apparaît comme un
cas pur d’ethnocide : la culture du Midi — religion, littérature, poésie
— était irréversiblement condamnée et les Languedociens devinrent
sujets loyaux du roi de France.
La révolution de 1789, en permettant le triomphe de l’esprit
centraliste des jacobins sur les tendances fédéralistes des girondins,
mena à son terme l’emprise politique de l’administration parisienne. Les
Provinces, comme unités territoriales, s’appuyaient chacune sur une
ancienne réalité, homogène du point de vue culturel : langue, traditions
politiques, etc. On leur substitua le découpage abstrait en
départements, propre à briser toute référence aux particularismes
locaux, et donc à faciliter partout la pénétration de l’autorité
étatique. Ultime étape de ce mouvement par lequel les différences
s’évanouissent l’une après l’autre devant la puissance de l’État : la
IIIe République transforma définitivement les habitants de l’hexagone en
citoyens grâce à l’institution de l’école laïque, gratuite et
obligatoire, puis du service militaire obligatoire. Ce qui subsistait
d’existence autonome dans le monde provincial et rural y succomba. La
francisation était accomplie, l’ethnocide consommé : langues
traditionnelles traquées en tant que patois d’arriérés, vie villageoise
ravalée au rang de spectacle folklorique destiné à la consommation des
touristes, etc.
Pour bref qu’il soit, ce coup d’œil jeté sur l’histoire de notre pays
suffit à montrer que l’ethnocide, comme suppression plus ou moins
autoritaire des différences socio-culturelles, est inscrit d’avance dans
la nature et dans le fonctionnement de la machine étatique, laquelle
procède par uniformisation du rapport qui la lie aux individus : l’État
ne connaît que des citoyens égaux devant la Loi.
Affirmer, à partir de l’exemple français, que l’ethnocide
appartient à l’essence unificatrice de l’État, conduit logiquement à
dire que toute formation étatique est ethnocidaire.
Examinons rapidement le cas d’un type d’État fort différent des États
européens. Les Incas étaient parvenus à édifier dans les Andes une
machine de gouvernement qui fit l’admiration des Espagnols, tant par
l’ampleur de son extension territoriale que par la précision et la
minutie des techniques administratives qui permettaient à l’Empereur et à
ses nombreux fonctionnaires d’exercer un contrôle presque total et
permanent sur les habitants de l’Empire. L’aspect proprement
ethnocidaire de cette machine étatique apparaît dans sa tendance à
incaïser les populations nouvellement conquises : non seulement les
obligeant à payer tribut aux nouveaux maîtres, mais surtout les
contraignant à célébrer en priorité le culte des conquérants, le culte
du Soleil, c’est-à-dire de l’Inca lui-même. Religion d’État, imposée par
la force, fût-ce au détriment des cultes locaux. Il est vrai également
que la pression exercée par les Incas sur les tribus soumises
n’atteignit jamais la violence du zèle maniaque avec lequel les
Espagnols anéantirent plus tard l’idolâtrie indigène. Pour habiles
diplomates qu’ils fussent, les Incas savaient néanmoins utiliser la
force lorsqu’il le fallait et leur organisation réagissait avec la plus
grande brutalité, comme tout appareil d’État lorsque son pouvoir est mis
en question. Les fréquents soulèvements contre l’autorité centrale du
Cuzco, impitoyablement réprimés d’abord, étaient ensuite châtiés par la
déportation massive des vaincus en des régions très éloignées de leur
territoire natal, c’est-à-dire marqué par le réseau des lieux de culte
(sources, collines, grottes, etc.) : déracinement, déterritorialisation,
ethnocide…
La violence ethnocidaire, comme négation de la différence,
appartient bien à l’essence de l’État, aussi bien dans les empires
barbares que dans les sociétés civilisées d’Occident : toute organisation étatique est ethnocidaire, l’ethnocide est le mode normal d’existence de l’État.
Il y a donc une certaine universalité de l’ethnocide, en ce qu’il est
le propre non pas seulement d’un vague « monde blanc » indéterminé, mais
de tout un ensemble de sociétés qui sont les sociétés à État. La réflexion sur l’ethnocide passe par une analyse de l’État. Mais
doit-elle s’arrêter là, s’en tenir au constat que l’ethnocide c’est
l’État et que, de ce point de vue, tous les États se valent ? Ce serait
là retomber dans le péché d’abstraction que nous avons précisément
reproché à « l’école de l’ethnocide », ce serait encore une fois
méconnaître l’histoire concrète de notre propre monde culturel.
Où se situe la différence qui interdit de placer sur le même plan, ou
de mettre dans le même sac, les États barbares (Incas, Pharaons,
despotismes orientaux, etc.) et les États civilisés (le monde
occidental) ? On décèle d’abord cette différence au niveau de la
capacité ethnocidaire des appareils étatiques. Dans le premier cas,
cette capacité est limitée non pas par la faiblesse de l’État mais, au
contraire, par sa force : la pratique ethnocidaire — abolir la
différence lorsqu’elle devient opposition — cesse dès lors que la force
de l’État ne court plus aucun risque. Les Incas toléraient une relative
autonomie des communautés andines lorsque celles-ci reconnaissaient
l’autorité politique et religieuse de l’Empereur. On s’aperçoit en
revanche que dans le second cas — États occidentaux — la capacité
ethnocidaire est sans limites, elle est effrénée. C’est bien pour cela
qu’elle peut conduire au génocide, que l’on peut en effet parler du
monde occidental comme absolument ethnocidaire. Mais d’où cela
provient-il ? Que contient la civilisation occidentale qui la rend infiniment plus ethnocidaire que toute autre forme de société ? C’est
son régime de production économique, espace justement de l’illimité,
espace sans lieux en ce qu’il est recul constant de la limite, espace
infini de la fuite en avant permanente. Ce qui différencie l’Occident,
c’est le capitalisme, en tant qu’impossibilité de demeurer dans
i’en-deçà d’une frontière, en tant que passage au delà de toute
frontière ; c’est le capitalisme, comme système de production
pour qui rien n’est impossible, sinon de ne pas être à soi-même sa
propre fin : qu’il soit d’ailleurs libéral, privé, comme en Europe de l’Ouest, ou planifié, d’État, comme en Europe de l’Est.
La société industrielle, la plus formidable machine à produire, est
pour cela même la plus effrayante machine à détruire. Races, sociétés,
individus ; espace, nature, mers, forêts, sous-sol : tout est utile,
tout doit être utilisé, tout doit être productif, d’une productivité
poussée à son régime maximum d’intensité.
Voilà pourquoi aucun répit ne pouvait être laissé aux
sociétés qui abandonnaient le monde à sa tranquille improductivité
originaire ; voilà pourquoi était intolérable, aux yeux de l’Occident,
le gaspillage représenté par l’inexploitation d’immenses ressources. Le
choix laissé à ces sociétés était un dilemme : ou bien céder à la
production, ou bien disparaître ; ou bien l’ethnocide, ou bien le
génocide. A la fin du siècle dernier, les Indiens de la
pampa argentine furent totalement exterminés afin de permettre l’élevage
extensif des moutons et des vaches, qui fonda la richesse du
capitalisme argentin. Au début de ce siècle, des centaines de milliers
d’Indiens amazoniens périrent sous les coups des chercheurs de
caoutchouc. Actuellement, dans toute l’Amérique du Sud, les derniers
Indiens libres succombent sous l’énorme poussée de la croissance
économique, brésilienne en particulier. Les routes transcontinentales
dont la construction s’accélère constituent des axes de colonisation des
territoires traversés : malheur aux Indiens que la route rencontre ! De
quel poids peuvent peser quelques milliers de Sauvages improductifs au
regard de la richesse en or, minerais rares, pétrole, en élevage de
bovins, en plantations de café, etc. ? Produire ou mourir, c’est la devise de l’Occident.
Les Indiens d’Amérique du Nord l’apprirent dans leur chair, tués presque jusqu’au dernier afin de permettre la production.
Un de leurs bourreaux, le général Sherman, le déclarait ingénument dans
une lettre adressée à un fameux tueur d’Indiens, Buffalo Bill : «
Autant que je peux l’estimer, il y avait, en 1862, environ 9 millions et
demi de bisons dans les plaines entre le Missouri et les Montagnes
Rocheuses. Tous ont disparu, tués pour leur viande, leur peau et leurs
os […] A cette même date, il y avait environ 165 000 Pawnees, Sioux,
Cheyennes, Kiowas et Apaches, dont l’alimentation annuelle dépendait de
ces bisons. Eux aussi sont partis et ont été remplacés par le double ou
le triple d’hommes et de femmes de race blanche, qui ont fait de cette
terre un jardin et qui peuvent être recensés, taxés et gouvernés selon
les lois de la nature et de la civilisation. Ce changement a été
salutaire et s’accomplira jusqu’à la fin. »x Le général avait raison. Le
changement s’accomplira jusqu’à la fin, il prendra fin lorsqu’il n’y
aura plus rien du tout à changer.
1. Cité in R. Thévenin et P. Coze, Mœurs et histoire des Indiens Peaux-Rouges, Paris, Payot, 1952.
(*) Note de R71: la notion d’ethnocide a été définit par l’anthropologue français Robert Jaulin dans son livre couvrant ses recherches “La paix blanche” en 1970, soit 4 ans avec cet écrit de Clastres.
= = =
Source : https://resistance71.wordpress.com/2019/06/26/anthropologie-politique-etat-capitalisme-occident-colonialisme-ethnocide-et-genocide-pierre-clastres/
Lectures complémentaires:
notre page « Anthropologie politique »
Manifeste pour la Société des Sociétés
Paulo_Freire_La_pedagogie_des_opprimes
Marshall-Sahlins-La-nature-humaine-une-illusion-occidentale-2008
James_C_Scott_L’art_de_ne_pas_être_gouverné
James-C-Scott-Contre-le-Grain-une-histoire-profonde-des-premiers-etats
David Graber Fragments Anthropologiques pour Changer l’histoire de l’humanité
40ans_Hommage_Pierre_Clastres
mardi 2 juillet 2019
Anthropologie politique: État, capitalisme, occident, colonialisme, ethnocide et génocide (Pierre Clastres)
Libellés :
anthropologie,
ethnologie,
Pierre Clastres,
politique internationale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)










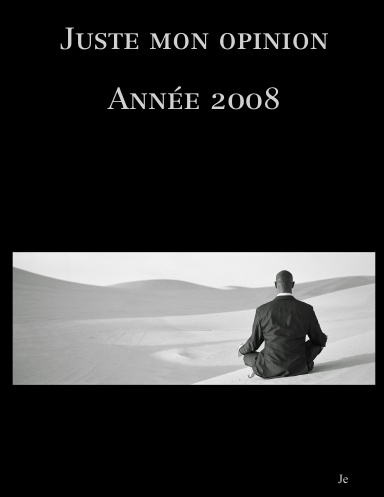
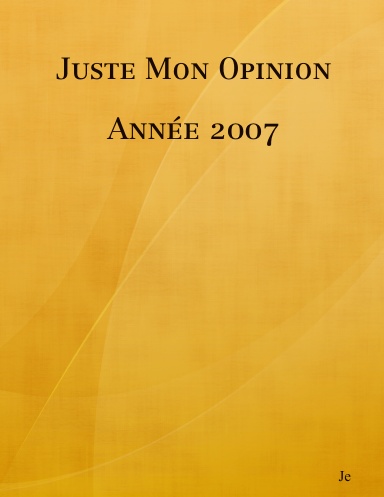


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire