Bibliographie
* Chronique des Indiens Guayaki , éd. Pocket, coll. Terre humaine, Paris, 2001 (1ère édition : 1972).
* Le Grand Parler : mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, éd. du Seuil, coll. Recherches anthropologiques, Paris, 1974.
* La Société contre l'État, éd. de Minuit, Paris, 1978 (1ère édition : 1974).
* Les marxistes et leur anthropologie, Libre, Paris, 1978.
* Recherches d'anthropologie politique, éd. du Seuil, Paris, 1980.
* Mythologie des Indiens Chulupi, Peeters, coll. Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, Paris-Louvain, 1992.
* Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés primitives, éd. de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 2005 (1ère édition : 1997).
"La société contre l’État"
Dans son oeuvre la plus reconnue, La Société contre l'État, Pierre Clastres critique à la fois les notions évolutionniste, qui voudrait que l'État organisé soit la finalité de toute société, et rousseauiste, de l'innocence naturelle de l'homme.
On retiendra sa thèse principale : les sociétés dites « primitives » ne sont pas des sociétés qui n'auraient pas encore découvert le pouvoir et l'État, mais au contraire des sociétés construites pour éviter que l'État n'apparaisse.
Morceaux choisis
page 6 Introduction
[Ces] sociétés, disparues pour la plupart mais encore intactes en certains endroits du globe, nous permettent de « décoloniser » notre imaginaire : la société occidentale, hiérarchisée et autoritaire, n'est pas le seul modèle. Il existe d'autres modes d'organisation possible : des sociétés sans États.
Trop souvent la société « moderne », la société industrielle et technicienne, est considérée comme l'aboutissement de l'organisation sociale ou, pour les plus modérés, un stade plus évolué par lesquelles devront passer les sociétés dite primitives. Il n'en est rien, et Pierre Clastres nous le démontre dans ce texte.
La société primitive n'est pas une société « sous évoluée », société qui n'aurait pas encore abouti à la forme étatique. Bien au contraire, la société primitive, sans État, est un autre choix de société, une société qui s'organise de façon à lutter contre l'émergence de l'État et de tout pouvoir coercitif.
page 7 Introduction (suite)
Société sans État, donc. Mais aussi société sans classe. Contrairement aux idées marxistes, Pierre Clastres démontre également que la division en classes sociales ne vient pas de l'économie mais de l'émergence de l'État : le politique prime sur l'économique.
Autre mythe trop souvent persistant : la société primitive serait une société du manque et de la survie. Cette croyance vient du fait que les sociétés primitives ont un niveau technologique peu développé (par rapport à celui des sociétés modernes, mais bien suffisant pour leur mode de vie) et une économie de subsistance.
Pourtant, rien n'est plus faux. Au contraire, les sociétés primitives sont des sociétés d'abondance, mais d'abondance dans la sobriété : pas de courses effrénées dans les rendements ou les innovations technologiques. La production, et donc le travail, sont remis à leur juste place : produire le nécessaire pour combler les besoins (ce qui inclus un stock pour prévenir les aléas climatiques).
Du coup le travail s'en trouve transformé : on ne perd plus sa vie à la gagner. D'une part il redevient une activité utile, « plaisante » et socialisante ; d'autre part sa durée journalière est drastiquement réduite : 4 heures de labeur sont suffisante à ces sociétés pour subvenir à leurs besoins.
Il en va de même pour la technique. On crée de nouveaux outils uniquement pour s'adapter aux conditions extérieures lorsque le besoin s'en fait sentir. Contrairement à nos sociétés occidentales, les outils s'adaptent aux modes et aux choix de vies et non l'inverse.
Ces sociétés primitives nous permettent donc d'imaginer et d'élaborer un autre mode d'organisation sociale : une société antiautoritaire et décroissante, où le progrès et le travail reprendrait leur juste place, nécessaire mais non primordiale.
Gijomo
pages 9 et 10
Les sociétés primitives sont des sociétés sans État : ce jugement de fait, en lui-même exact, dissimule en vérité une opinion, un jugement de valeur qui grève dès lors la possibilité de constituer une anthropologie politique comme science rigoureuse. Ce qui en fait est énoncé, c’est que les sociétés primitives sont privées de quelque chose – l’État – qui leur est, comme à toute autre société – la nôtre par exemple – nécessaire. Ces sociétés sont donc incomplètes, Elles ne sont pas tout à fait de vraies sociétés – elles ne sont pas policées – elles subsistent dans l’expérience peut-être douloureuse d’un manque – manque de l’État – qu’elles tenteraient, toujours en vain, de combler. Plus ou moins confusément, c’est bien cela que disent les chroniques des voyageurs ou les travaux des chercheurs : on ne peut pas penser la société sans l’État, l’État est le destin de toute société. On décèle en cette démarche un ancrage ethnocentriste
Derrière les formulations modernes, le vieil évolutionnisme demeure, en fait, intact.
Qu’en est-il en réalité ?
page 11
on ne peut mesurer un équipement technologique qu’à sa capacité de satisfaire, en un milieu donné, les besoins de la société.
page 12
La vraie question : l’économie de ces sociétés [premières] est-elle réellement une économie de subsistance ?
Alors, de deux choses l’une ou bien l’homme des sociétés primitives, américaines et autres, vit en économie de subsistance et passe le plus clair de son temps dans la recherche de la nourriture ; ou bien il ne vit pas en économie de subsistance et peut donc se permettre des loisirs prolongés en fumant dans son hamac.
Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès son aurore le premier pose que la vraie société se déploie à l’ombre protectrice de l’État; le second énonce un impératif catégorique : il faut travailler.
page 13
Qu’il s’agisse de chasseurs-nomades du désert du Kalahari ou d’agriculteurs sédentaires amérindiens, les chiffres obtenus révèlent une répartition moyenne du temps quotidien de travail inférieure à quatre heures par jour.
[...] chez les Indiens Yanomami d’Amazonie vénézuélienne, a chronométriquement établi que la durée moyenne du temps consacré chaque jour au travail par les adultes, toutes activités comprises, dépasse à peine trois heures.
les Indiens, hommes et femmes, passaient au moins la moitié de la journée dans une oisiveté presque complète,
page 14
Le bon sens alors questionne : pourquoi les hommes de ces sociétés voudraient-ils travailler et produire davantage, alors que trois ou quatre heures quotidiennes d’activité paisible suffisent à assurer les besoins du groupe ?A quoi cela leur servirait-il ? A quoi serviraient les surplus ainsi accumulés ? Quelle en serait la destination ? C’est toujours par force que les hommes travaillent au-delà de leurs besoins. Et précisément cette force-là est absente du monde primitif, l’absence de cette force externe définit même la nature des sociétés primitives.
[...] le refus d’un excès inutile, la volonté d’accorder l’activité productrice à la satisfaction des besoins [est inhérent à ce type de société].
page 15
Les sociétés primitives sont bien, comme l’écrit J. Lizot à propos des Yanomami, des sociétés de refus du travail :
Premières sociétés du loisir, premières sociétés d’abondance, selon la juste et gaie expression de M. Sahlins.
[...] cette force externe que nous évoquions plus haut, cette force sans laquelle les Sauvages ne renonceraient pas au loisir et qui détruit la société en tant que société primitive cette force, c’est la puissance de contraindre, c’est la capacité de coercition, c’est le pouvoir politique.
Pour l’homme des sociétés primitives, l’activité de production est exactement mesurée, délimitée par les besoins à satisfaire, étant entendu qu’il s’agit essentiellement des besoins énergétiques : la production est rabattue sur la reconstitution du stock d’énergie dépensée.
page 16
Rien ne saurait inciter la société primitive à désirer produire plus, c’est-à-dire à aliéner son temps en un travail sans destination, alors que ce temps est disponible pour l’oisiveté, le jeu, la guerre ou la fête.
Dans la société primitive, société par essence égalitaire, les hommes sont maîtres de leur activité, maîtres de la circulation des produits de cette activité
[...] l’on peut parler de travail quand la règle égalitaire d’échange cesse de constituer le « code civil » de la société, quand l’activité de production vise à satisfaire les besoins des autres, quand à la règle échangiste se substitue la terreur de la dette.
C’est bien là en effet qu’elle s’inscrit, la différence entre le Sauvage amazonien et l’Indien de l’empire inca. Le premier produit en somme pour vivre, tandis que le second travaille, en plus, pour faire vivre les autres, ceux qui ne travaillent pas, les maîtres qui lui disent il faut payer ce que tu nous dois, il faut éternellement rembourser ta dette à notre égard.
[...] quand l’activité de production devient travail aliéné, comptabilisé et imposé par ceux qui vont jouir des fruits de ce travail, c’est que la société n’est plus primitive, c’est qu’elle est devenue une société divisée en dominants et dominés, en maîtres et sujets, c’est qu’elle a cessé d’exorciser ce qui est destiné à la tuer : le pouvoir et le respect du pouvoir. La division majeure de la société, celle qui fonde toutes les autres, y compris sans doute la division du travail, c’est la nouvelle disposition verticale entre la base et le sommet, c’est la grande coupure politique entre détenteurs de la force, qu’elle soit guerrière ou religieuse, et assujettis à cette force.
page 17
La relation politique de pouvoir précède et fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être économique, l’aliénation est politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique, l’émergence de l’État détermine l’apparition des classes.
Tout cela se traduit, sur le plan de la vie économique, par le refus des sociétés primitives de laisser le travail et la production les engloutir, par la décision de limiter les stocks aux besoins socio-politiques, par l’impossibilité intrinsèque de la concurrence – à quoi servirait, dans une société primitive, d’être un riche parmi des pauvres ? – en un mot, par l’interdiction, non formulée mais dite cependant, de l’inégalité.
page 18
L’extrême diversité des types d’organisation sociale, le foisonnement, dans le temps et dans l’espace, de sociétés dissemblables, n’empêchent pas cependant la possibilité d’un ordre dans le discontinu, la possibilité d’une réduction de cette multiplicité infinie de différences. Réduction massive puisque l’histoire ne nous offre, en fait, que deux types de société absolument irréductibles l’un à l’autre, deux macro-classes dont chacune rassemble en soi des sociétés qui, au-delà de leurs différences, ont en commun quelque chose de fondamental. Il y a d’une part les sociétés primitives, ou sociétés sans État, il y a d’autre part les sociétés à État.
On a souvent, et avec raison décelé dans le mouvement de l’histoire mondiale deux accélérations décisives de son rythme. Le moteur de la première fut ce que l’on appelle la révolution néolithique (domestication des animaux, agriculture, découverte des arts du tissage et de la poterie, sédentarisation consécutive des groupes humains, etc.). Nous vivons encore, et de plus en plus (si l’on peut dire) dans le prolongement de la seconde accélération, la révolution industrielle du XIXème siècle.
page 19
[....] une économie de chasse, pêche et collecte n’exige pas obligatoirement un mode de vie nomadique. Plusieurs exemples, tant en Amérique qu’ailleurs, l’attestent : l’absence d’agriculture est compatible avec la sédentarité. Ce qui laisserait supposer au passage que si certains peuples n’ont pas acquis l’agriculture, alors qu’elle était écologiquement possible, ce n’est pas par incapacité, retard technologique, infériorité culturelle, mais, plus simplement, parce qu’ils n’en avaient pas besoin.
[...] la révolution néolithique, si elle a considérablement affecté, et sans doute facilité, la vie matérielle des groupes humains d’alors, n’entraîne pas mécaniquement un bouleversement de l’ordre social. En d’autres termes, et pour ce qui concerne les sociétés primitives, le changement au niveau de ce que le marxisme nomme l’infrastructure économique ne détermine pas du tout son reflet corollaire, la superstructure politique, puisque celle-ci apparaît indépendante de sa base matérielle. Le continent américain illustre clairement l’autonomie respective de l’économie et de la société.
page 20
Des groupes de chasseurs-pêcheurs-collecteurs, nomades ou non, présentent les mêmes propriétés socio-politiques que leurs voisins agriculteurs sédentaires « infrastructures » différentes, « superstructure » identique. Inversement, les sociétés mésoaméricaines – sociétés impériales, sociétés à État – étaient tributaires d’une agriculture qui, plus intensive qu’ailleurs, n’en demeurait pas moins, du point de vue de son niveau technique, très semblable à l’agriculture des tribus « sauvages » de la Forêt Tropicale : « infrastructure » identique, « superstructures » différentes, puisqu’en un cas il s’agit de sociétés sans État, dans l’autre d’États achevés.
C’est donc bien la coupure politique qui est décisive, et non le changement économique. La véritable révolution, dans la protohistoire de l’humanité, ce n’est pas celle du néolithique, puisqu’elle peut très bien laisser intacte l’ancienne organisation sociale, c’est la révolution politique, c’est cette apparition mystérieuse, irréversible, mortelle pour les sociétés primitives, ce que nous connaissons sous le nom d’État.
page 21
Si la société est organisée par des oppresseurs capables d’exploiter les opprimés, c’est que cette capacité d’imposer l’aliénation repose sur l’usage d’une force, c’est-à-dire sur ce qui fait la substance même de l’État, « monopole de la violence physique légitime »
il faut alors se demander pourquoi se produit, au sein d’une société primitive, c’est-à-dire d’une société non divisée, la nouvelle répartition des hommes en dominants et dominés. Quel est le moteur de cette transformation majeure qui culminerait dans l’installation de l’État ?
pages 21-22
Pourquoi quelques-uns désirèrent-ils proclamer un jour ceci est à moi, et comment les autres laissèrent-ils ainsi s’établir le germe de ce que la société primitive ignore, l’autorité, l’oppression, l’État ? Ce que l’on sait maintenant des sociétés primitives ne permet plus de rechercher au niveau de l’économique l’origine du politique.
page 22
La société primitive, première société d’abondance, ne laisse aucune place au désir de surabondance.
Les sociétés primitives sont des sociétés sans État parce que l’État y est impossible. Et pourtant tous les peuples civilisés ont d’abord été sauvages qu’est-ce qui a fait que l’État a cessé d’être impossible ? Pourquoi les peuples cessèrent-ils d’être sauvages ? Quel formidable événement, quelle révolution laissèrent surgir la figure du Despote, de celui qui commande à ceux qui obéissent ? D’où vient le pouvoir politique ?
[...] l’on peut regrouper en une seule classe les grands despotismes archaïques – rois, empereurs de Chine ou des Andes, pharaons –, les monarchies plus récentes – l’État c’est moi – ou les systèmes sociaux contemporains, que le capitalisme y soit libéral comme en Europe occidentale, ou d’État comme ailleurs...
page 23
Il n’y a donc pas de roi dans la tribu, mais un chef qui n’est pas un chef d’État. Qu’est-ce que cela signifie ? Simplement que le chef ne dispose d’aucune autorité, d’aucun pouvoir de coercition, d’aucun moyen de donner un ordre. Le chef n’est pas un commandant, les gens de la tribu n’ont aucun devoir d’obéissance. L’espace de la chefferie n’est pas le lieu du pouvoir, et la figure (bien mal nommée) du « chef » sauvage ne préfigure en rien celle d’un futur despote. Ce n’est certainement pas de la chefferie primitive que peut se déduire l’appareil étatique en général.
En quoi le chef de la tribu ne préfigure-t-il pas le chef d’État ? En quoi une telle anticipation de l’État est-elle impossible dans le monde des Sauvages ? Cette discontinuité radicale – qui rend impensable un passage progressif de la chefferie primitive à la machine étatique – se fonde naturellement sur cette relation d’exclusion qui place le pouvoir politique à l’extérieur de la chefferie.
Essentiellement chargé de résorber les conflits qui peuvent surgir entre individus, familles, lignages, etc., il ne dispose, pour rétablir l’ordre et la concorde, que du seul prestige que lui reconnaît la société. Mais prestige ne signifie pas pouvoir, bien entendu, et les moyens que détient le chef pour accomplir sa tâche de pacificateur se limitent à l’usage exclusif de la parole : non pas même pour arbitrer entre les parties opposées, car le chef n’est pas un juge, il ne peut se permettre de prendre parti pour l’un ou l’autre ; mais pour, armé de sa seule éloquence, tenter de persuader les gens qu’il faut s’apaiser, renoncer aux injures, imiter les ancêtres qui ont toujours vécu dans la bonne entente.
pages 23-24
A quoi la tribu estime-t-elle que tel homme est digne d’être un chef ? En fin de compte, à sa seule compétence « technique » : dons oratoires, savoir-faire comme chasseur, capacité de coordonner les activités guerrières, offensives ou défensives. Et, en aucune manière, la société ne laisse le chef passer au-delà de cette limite technique, elle ne laisse jamais une supériorité technique se transformer en autorité politique. Le chef est au service de la société, c’est la société en elle-même – lieu véritable du pouvoir – qui exerce comme telle son autorité sur le chef.
page 24
La loi primitive : tu n’es pas plus que les autres.
« Les Abipones, par une coutume reçue de leurs ancêtres, font tout à leur gré et non à celui de leur cacique. Moi, je les dirige, mais je ne pourrais porter préjudice à aucun des miens sans me porter préjudice à moi-même ; si j’utilisais les ordres ou la force avec mes compagnons, aussitôt ils me tourneraient le dos. Je préfère être aimé et non craint d’eux. »
page 25
Il y a cependant des exceptions, presque toujours liées à la guerre.
La source la plus apte à étancher la soif de prestige d’un guerrier, c’est la guerre. En même temps, un chef dont le prestige est lié à la guerre ne peut le conserver et le renforcer que dans la guerre : c’est une sorte de fuite obligée en avant qui le fait vouloir organiser sans cesse des expéditions guerrières dont il escompte retirer les bénéfices (symboliques) afférents à la victoire.
Mais le risque d’un dépassement du désir de la société par celui de son chef, le risque pour lui d’aller au-delà de ce qu’il doit, de sortir de la stricte limite assignée à sa fonction, ce risque est permanent. Le chef, parfois, accepte de le courir, il tente d’imposer à la tribu son projet individuel, il tente de substituer son intérêt personnel à l’intérêt collectif.
[...] la tribu au service du chef, et non plus le chef au service de la tribu. Si « ça marchait » alors on aurait là le lieu natal du pouvoir politique, comme contrainte et violence, on aurait la première incarnation, la figure minimale de l’État. Mais ça ne marche jamais.
page 26
Un guerrier n’a pas le choix il est condamné à désirer la guerre. Pour avoir voulu imposer aux siens une guerre qu’ils ne désiraient pas, [le guerrier sud-américain Fousiwe.]il se vit abandonné par sa tribu. Il ne lui restait plus qu’à mener seul cette guerre, et il mourut criblé de flèches.
page 27
[...] très semblable en son développement est l’histoire d’un autre leader indien, infiniment plus célèbre que l’obscur guerrier amazonien, puisqu’il s’agit du fameux chef apache Geronimo.
Le but de Geronimo est donc un objectif individuel pour la réalisation duquel il veut entraîner la tribu. Il veut faire de la tribu l’instrument de son désir, alors qu’il fut auparavant, en raison de sa compétence de guerrier, l’instrument de la tribu.
Les Apaches qui, en fonction des circonstances, acceptaient le leadership de Geronimo pour son habileté de combattant, lui tournaient systématiquement le dos lorsqu’il voulait mener sa guerre personnelle. Geronimo, dernier grand chef de guerre nord-américain, qui passa trente années de sa vie à vouloir « faire le chef », et n’y parvint pas...
pages 27-28
La propriété essentielle (c’est-à-dire qui touche à l’essence) de la société primitive, c’est d’exercer un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose, c’est d’interdire l’autonomie de l’un quelconque des sous-ensembles qui la constituent, c’est de maintenir tous les mouvements, internes, conscients et inconscients, qui nourrissent la vie sociale, dans les limites et dans la direction voulues par la société. La tribu manifeste entre autres (et par la violence s’il le faut) sa volonté de préserver cet ordre social primitif. en interdisant l’émergence d’un pouvoir politique individuel, central et séparé. Société donc à qui rien n’échappe, qui ne laisse rien sortir hors de soi-même, car toutes les issues sont fermées. Société qui, par conséquent, devrait éternellement se reproduire sans que rien de substantiel ne l’affecte à travers le temps.
pages 28-29
[...] une condition fondamentale d’existence de la société primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou, en d’autres termes, pour qu’une société soit primitive, il faut qu’elle soit petite par le nombre. Et, de fait, ce que l’on constate dans le monde des Sauvages, c’est un extraordinaire morcellement des « nations », tribus, sociétés en groupes locaux qui veillent soigneusement à conserver leur autonomie au sein de l’ensemble dont ils font partie, quitte à conclure des alliances provisoires avec les voisins « compatriotes », si les circonstances – guerrières en particulier – l’exigent. Cette atomisation de l’univers tribal est certainement un moyen efficace d’empêcher la constitution d’ensembles socio-politiques intégrant les groupes locaux et, au-delà, un moyen d’interdire l’émergence de l’État qui, en son essence, est unificateur.
page 29
[...] les villages tupinamba par exemple, qui rassemblaient plusieurs milliers d’habitants, n’étaient pas des villes ; mais ils cessaient également d’appartenir à l’horizon « classique » de la dimension démographique des sociétés voisines. Sur ce fond d’expansion démographique et de concentration de la population se détache – fait également inhabituel dans l’Amérique des Sauvages, sinon dans celle des Empires – l’évidente tendance des chefferies à acquérir un pouvoir inconnu ailleurs.
Qu’il nous suffise simplement de déceler, à un bout de la société, si l’on peut dire, la croissance démographique, et à l’autre, la lente émergence du pouvoir politique.
page 30
Chefferie et langage sont, dans la société primitive, intrinsèquement liés, la parole est le seul pouvoir dévolu au chef : plus que cela même, la parole est pour lui un devoir.
[...] c’est le discours des karai [hommes qui aux XVème et XVIème siècles entraînaient derrière eux les Indiens par milliers en de folles migrations en quête de la patrie des dieux ], c’est la parole prophétique, parole virulente, éminemment subversive d’appeler les Indiens à entreprendre ce qu’il faut bien reconnaître comme la destruction de la société.
pages 30-31
[...] si les prophètes, surgis du cœur de la société, proclamaient mauvais le monde où vivaient les hommes, c’est parce qu’ils décelaient le malheur, le mal, dans cette mort lente à quoi l’émergence du pouvoir condamnait, à plus ou moins long terme, la société tupi-guarani, comme société primitive, comme société sans État. Habités par le sentiment que l’antique monde sauvage tremblait en son fondement, hantés par le pressentiment d’une catastrophe socio-cosmique, les prophètes décidèrent qu’il fallait changer le monde, qu’il fallait changer de monde, abandonner celui des hommes et gagner celui des dieux.
page 31
[...] cette pensée sauvage, presque aveuglante de trop de lumière, nous dit que le lieu de naissance du Mal, de la source du malheur, c’est l’Un [« De l’un sans le multiple ». ].
page 32
[...] une autre équation plus secrète et d’ordre politique, qui dit que l’Un, c’est l’État.
[...] l’Indien Guarani dit que l’Un c’est le Mal, alors qu’Héraclite dit qu’il est le Bien. A quelles conditions penser l’Un comme Bien est-il possible ?
page 33
Dans le discours des prophètes gît peut-être en germe le discours du pouvoir et, sous les traits exaltés du meneur d’hommes qui dit le désir des hommes se dissimule peut-être la figure silencieuse du Despote.
L’histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l’histoire de la lutte des classes. L’histoire des peuples sans histoire, c’est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l’histoire de leur lutte contre l’État
page 36 Commentaires de l'éditeur
Les sociétés sont donc perçues comme étant des structures faites d'un réseau de normes complexes qui empêchent activement l'expansion d'un pouvoir despotique et autoritaire. En opposition, l'État est alors cette constellation législative émanant d'un pouvoir hiérarchique qu'elle légitime, tout particulièrement dans ces sociétés qui ont échoué à maintenir en place des mécanismes naturels qui l'empêchent de prendre cette forme. Il oppose ainsi les grandes civilisations andines aux petites unités politiques formées par les tribus amazoniennes.
On retiendra sa thèse principale : les sociétés dites « primitives » ne sont pas des sociétés qui n'auraient pas encore découvert le pouvoir et l'État, mais au contraire des sociétés construites pour éviter que l'État n'apparaisse. Dans Archéologie de la violence, Pierre Clastres s'oppose ainsi aux interprétations structuralistes et marxistes de la guerre dans les sociétés amazoniennes. Selon lui, la guerre entre tribus est une façon de repousser la fusion politique, et donc empêcher la menace d'une délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la trop grande taille d'une société.










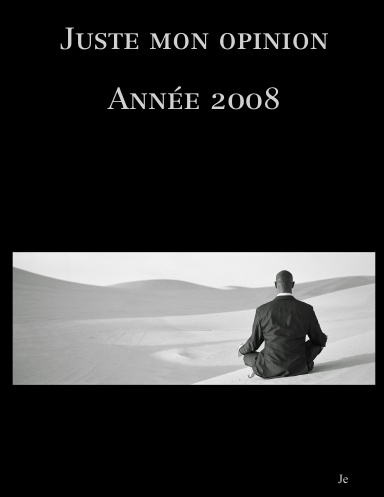
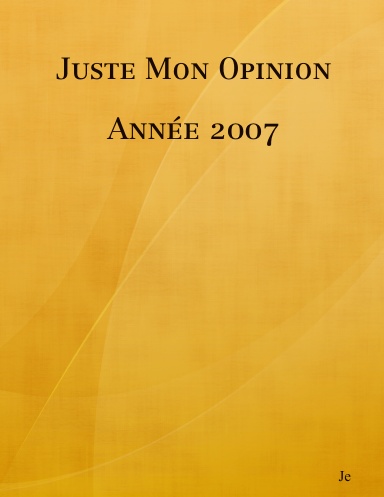

2 commentaires:
La guerre renforce le pouvoir du chef de l’État tandis qu'elle diminue le prestige du chef de la tribu (qui est un plutôt conciliateur).
Le premier est un chef de guerre; le second un chef de paix.
Très important :
"Une condition fondamentale d’existence de la société primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou, en d’autres termes, pour qu’une société soit primitive, il faut qu’elle soit petite par le nombre. Et, de fait, ce que l’on constate dans le monde des Sauvages, c’est un extraordinaire
morcellement des « nations », tribus, sociétés en groupes locaux qui veillent soigneusement à conserver leur autonomie au sein de l’ensemble dont ils font partie, quitte à conclure des alliances provisoires avec les voisins « compatriotes », si les circonstances – guerrières en particulier – l’exigent. Cette atomisation de l’univers tribal est certainement un moyen efficace d’empêcher la constitution
d’ensembles socio-politiques intégrant les groupes locaux et, au-delà, un moyen d’interdire l’émergence de l’État qui, en son essence, est unificateur."
Enregistrer un commentaire