Évincé de l'université Yale en 2007, David Graeber, « l’un des intellectuels les plus influents du monde anglo-saxon selon le New York Times », est aujourd'hui professeur à la London School of Economics.
Biographie
Les parents de Graeber, d'origine juive, étaient des intellectuels de la classe ouvrière autodidacte à New York. Ruth Rubinstein, sa mère, travaillait dans le secteur de l'habillement et jouait le rôle principal dans la revue de comédie musicale des années 1930, Pins & Needles, organisée par le Syndicat international des travailleuses du vêtement. Kenneth Graeber, son père, qui était affilié à la Ligue des jeunes communistes au collège, participa à la révolution espagnole à Barcelone et combattit dans la guerre civile espagnole. Il a ensuite travaillé sur des imprimantes offset.
Graeber a grandi à New York, dans un immeuble d'appartements coopératif décrit par le magazine Business Week comme "imprégné de politique radicale". Graeber est un anarchiste depuis l'âge de 16 ans, selon une interview qu'il a donnée à The Village Voice en 2005.
Il a un passé d'activiste social et politique, notamment du fait de sa participation à la protestation contre le Forum économique mondial à New York (2002). Il était membre du syndicat IWW.
Il fut chargé de cours d'anthropologie à l'Université Yale jusqu'à ce que l'université ne renouvelle pas son contrat en juin 2007, ce qui fit controverse à cause du soupçon de motivation politique à cette éviction. Il se fit indemniser une « année sabbatique » durant laquelle il donna un cours d'introduction à l'anthropologie culturelle et un autre intitulé Direct Action and Radical Social Theory. Puis, il occupa un poste de maître de conférences reader au sein du département d'anthropologie de l'Université de Londres de l'automne 2007 à l'été 2013. Il est actuellement professeur à la London School of Economics.
Il est l'auteur de Fragments of an Anarchist Anthropology (en français : Pour une anthropologie anarchiste) et Towards an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams).
Il a composé de vastes œuvres anthropologiques à Madagascar, et écrit sa thèse de doctorat (The Disastrous Ordeal of 1987: Memory and Violence in Rural Madagascar) sur ce pays.
En 2011, il publie une vaste monographie intitulée Debt: the First Five Thousand Years (Melville House ; publié en français sous le titre Dette : 5000 ans d'histoire, aux éditions Les liens qui libèrent en 2013). Dans cet ouvrage où il s'inspire notamment des thèses de Alfred Mitchell-Innes, il soutient la thèse que le système du troc n'a jamais été utilisé comme moyen d'échange principal durant 5000 ans d'histoire.
Fin 2011, il est l'une des figures de proue du mouvement Occupy Wall Street.
En août 2013, il publie l'article On the Phenomenon of Bullshit Jobs qui dénonce la bureaucratisation de l'économie et la multiplication des emplois inutiles.
En décembre 2014 il se rend entre autres avec Janet Biehl au Rojava (Kurdistan de Syrie) afin de se documenter sur l'expérience en cours d'auto-gouvernement. Ce voyage donne lieu à des visites d’écoles, de conseils communaux, d’assemblées de femmes, de coopératives nées de la “révolution du Rojava”.
En 2015, il publie Bureaucratie (The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy) où il soutient que les entreprises privées sont toutes aussi, voire davantage, bureaucratiques que le service public et que la bureaucratie est un fléau du capitalisme moderne. Pour lui, « Il faut mille fois plus de paperasse pour entretenir une économie de marché libre que la monarchie de Louis XIV. ».
Ouvrages en français
- Pour une anthropologie anarchiste [« Fragments of an Anarchist Anthropology »], Lux Éditeur, , 164 p. (ISBN 978-1612193748)
- Dette : 5000 ans d'histoire [« Debt: The First 5000 Years »], Les liens qui libèrent, , 624 p. (ISBN 979-1020900593)
- La Démocratie Aux Marges, Le Bord de l'eau, , 120 p. (ISBN 978-2356872968) ; reprise de l'article paru en 2005 dans le n°26 de la Revue du MAUSS.
- Comme si nous étions déjà libres [« The Democracy Project : A History, a Crisis, a Movement »], Lux Éditeur, , 280 p. (ISBN 978-2895961802)
- Des fins du capitalisme : Possibilités I [« Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire »], Payot, , 363 p. (ISBN 978-2228911511)
- Bureaucratie, l'utopie des règles [« The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy »], Les liens qui libèrent, , 304 p. (ISBN 9791020902917), Actes Sud, 2017.
- Bullshit jobs, 2018, Éd. Les liens qui libèrent. ISBN
Que reste-t-il de l'idéal démocratique ?
Revue du MAUSS
pages 41 à 89
p.44 [La démocratie], cet idéal s’est toujours basé sur un rêve impossible, le rêve d’un mariage entre les procédures et pratiques démocratiques d’une part, et les mécanismes coercitifs de l’État d’autre part. Ce qui en a résulté, ce ne sont pas des « démocraties », quelque sens que l’on donne à ce terme, mais des républiques ne recelant en général que peu d’éléments démocratiques.
p.46 n’est-il pas également possible d’établir une tout autre liste [que celle de Samuel Huntington] , par exemple en affirmant que la « culture occidentale » repose sur la science, l’industrie, la rationalité bureaucratique, le nationalisme, les théories raciales et sur une tendance irrépressible à l’expansion géographique, et d’en conclure que cette culture aurait culminé avec le IIIe Reich ?
p.48 Le terme de « civilisation » peut en effet être utilisé en deux sens tout à fait différents. Il peut tout d’abord désigner un type de société dans laquelle la vie sociale se concentre principalement dans des villes – comme le fait par exemple, un archéologue pour caractériser la vallée de l’Indus. Ou alors, ce terme peut signifier raffinement, finesse, créativité culturelle. La notion de « culture » présente elle aussi cette double signification. Elle peut être utilisée dans son sens anthropologique pour désigner certaines structures sensibles, certains codes symboliques que les membres d’une culture donnée intériorisent au cours de leur processus de socialisation et qui informent tous les aspects de leur vie quotidienne : la façon dont ils parlent, mangent, se marient, jouent de la musique, etc. Pour utiliser la terminologie de Bourdieu, on peut rapporter cet aspect de la culture à la notion d’habitus. En un autre sens, le terme peut être utilisé pour désigner ce que l’on appelle la « haute culture », soit les oeuvres les meilleures et les plus profondes produites par une élite artistique, littéraire ou philosophique.
p.50 Ainsi certains peuvent s’engager dans une célébration de l’Occident comme berceau de la liberté, alors que d’autres le dénoncent comme la source de l’impérialisme et de sa violence.
p.51 la notion même d’Occident est fondée sur un brouillage systématique de la distinction entre traditions textuelles et pratiques ordinaires. [...] une conception totalement idéalisée du comportement que les Occidentaux devraient adopter selon les textes philosophiques et scientifiques [Une telle position n’est pas sans cohérence intellectuelle. On pourrait la nommer « la théorie de la civilisation par les Grands Livres ».]
p.52 si la démocratie s’identifie à l’autogouvernement des communautés humaines, l’individu occidental est quant à lui défini comme un agent délié de tout lien communautaire.
p.52-53 Rousseau tendait à considérer la « délibération » davantage comme une mise en balance d’intérêts plutôt que comme un processus par lequel les sujets eux-mêmes se constituent, voire se forment [Manin, 1994]
p.53 l’Eurasie, durant la plus grande partie de son histoire, a été divisée en trois centres principaux : un système oriental, centré sur la Chine ; au Sud, un système centré sur ce qui est devenu l’Inde ; et une civilisation occidentale centrée quant à elle sur ce que nous appelons aujourd’hui le « Moyen-Orient » et s’étendant parfois au-delà, vers la Méditerranée.
p.53-54 L’Islam ressemble sous tellement d’aspects à ce qui sera plus tard appelé la « tradition occidentale » – même effort intellectuel mené pour articuler les Écritures judéo-chrétiennes et les catégories propres à la philosophie grecque, même accent mis dans la littérature sur l’amour courtois, même rationalisme scientifique et même juridisme, même monothéisme puritain et même impulsion missionnaire, même capitalisme mercantile en plein expansion, mêmes vagues périodiques de fascination pour le « mysticisme oriental », etc. – que seuls les préjugés historiques les plus tenaces ont pu aveugler les historiens européens et les empêcher de voir qu’il s’agissait bien là de la tradition occidentale, de comprendre que l’islamisation fut et continue d’être une forme d’occidentalisation et que c’est seulement à partir du moment où ils ont de plus en plus ressemblé à l’Islam que ceux qui vivaient dans les royaumes barbares du Moyen Âge européen en sont venus à ressembler à ce que nous appelons aujourd’hui l’« Occident ».
p.54 La constitution de ce système monde de l’Atlantique Nord s’opéra à travers d’inimaginables catastrophes : la destruction de civilisations entières, l’esclavage de masse, la mort d’au moins une centaine de millions d’êtres humains. Il produisit également ses propres formes de cosmopolitisme, par un mélange permanent des traditions africaines, amérindiennes et européennes.
p.54-55 Des communautés égalitaires ont existé à travers toute l’histoire humaine – et nombre d’entre elles étaient bien plus égalitaires que celle d’Athènes au Ve siècle av. J.-C. – et elles avaient toutes développé une forme ou une autre de procédure de décision pour régler leurs affaires collectives. Souvent ces procédures consistaient à rassembler tout le monde pour des discussions dans lesquelles tous les membres de la communauté – du moins en théorie – avaient voix au chapitre. Néanmoins, ces procédures ne sont jamais considérées comme ayant pu être à proprement parler « démocratiques ». La principale raison pour laquelle cet argument semble intuitivement justifié est que dans ces assemblées, on ne passait jamais au vote. Presque toujours, on visait plutôt le consensus.
p.55 les communautés humaines ont toujours préféré s’imposer la tâche bien plus difficile d’aboutir à des décisions unanimes. [...] La prise de décision consensuelle est typique des sociétés au sein desquelles on ne voit aucun moyen de contraindre une minorité à accepter une décision majoritaire, soit parce qu’il n’existe pas d’État disposant du monopole de la coercition, soit parce qu’il ne manifeste aucun intérêt ni aucune propension à intervenir dans les prises de décision locales. S’il n’y a aucun moyen de forcer ceux qui considèrent une décision majoritaire comme désastreuse à s’y plier, alors la dernière chose à faire, c’est d’organiser un vote.
p.55-56 le consensus ne ressemble en rien au fait de voter. Au contraire, nous avons affaire à une procédure de compromis et de synthèse qui a pour but de produire des décisions auxquelles personne ne trouvera d’objection suffisante pour refuser d’y consentir. Ce qui signifie qu’ici, les deux niveaux que nous avons l’habitude de distinguer – celui de la prise de la décision et celui de sa mise en oeuvre – sont de fait confondus. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit être d’accord. La plupart des formes de consensus incluent toute une variété de formes graduées de désaccord. L’enjeu est de s’assurer que personne ne s’en aille avec le sentiment que ses opinions ont été totalement ignorées, et par conséquent que même ceux qui pensent que le groupe a abouti à une mauvaise décision seront encouragés à donner leur acquiescement même passif.
p.56 La démocratie majoritaire ne peut donc émerger que lorsque deux facteurs sont conjointement à l’œuvre : 1) le sentiment que les gens doivent avoir un pouvoir égal dans la prise de décision au sein du groupe, et 2) un appareil de coercition capable d’assurer l’application de ces décisions. Dans la plus grande partie de l’histoire humaine, ces deux conditions n’ont été qu’exceptionnellement réunies au même moment. Là où existent des sociétés égalitaires, imposer une coercition systématique est jugé habituellement de façon négative. Parallèlement, là où un appareil de coercition existait pour de bon, il ne venait guère à l’esprit de ses agents qu’ils mettaient en œuvre une quelconque volonté populaire. Nul ne saurait contester l’évidence que la Grèce antique a été l’une des sociétés les plus compétitives que l’histoire humaine ait connues. Elle avait en effet tendance à faire de toute chose un objet de rivalité publique, de l’athlétisme à la philosophie ou à l’art dramatique, etc. Il n’est donc guère surprenant que la prise de décision politique ait connu elle aussi un sort semblable. Plus crucial encore est le fait que les décisions étaient prises par le peuple en armes. Aristote, dans sa Politique, remarquait que la constitution des cités-États grecques dépendait essentiellement de l’arme principale de leur armée : si c’était la cavalerie, alors il s’agirait d’une aristocratie en raison de l’importance du coût des chevaux ; si c’était l’infanterie hoplite, puissamment armée, il s’agirait d’une oligarchie, car n’importe qui ne peut assurer le coût de l’entraînement et des armures ; si, enfin, l’arme principale était la marine ou une infanterie légère, alors on pourrait s’attendre à une démocratie, car tout le monde sait ramer ou se servir d’une fronde. En d’autres termes, si un homme est armé, on a tout intérêt à prendre en compte son opinion.
p.56-57 lorsque Machiavel tenta de faire revivre la notion de république démocratique à l’aube de l’ère « moderne », il en revient immédiatement à la notion de peuple en armes.
p.57 le terme de « démocratie » lui-même, qui semble avoir été forgé par ses détracteurs élitistes comme une sorte d’insulte.« Démocratie » signifie littéralement la « force », voire la « violence » du peuple. Kratos, et non archos. Les élites qui ont forgé ce terme l’ont toujours considéré comme désignant quelque chose de proche de l’émeute populaire ou du règne de la populace.
Une question qui mériterait des recherches historiques est celle de savoir dans quelle mesure un tel phénomène fut effectivement encouragé par l’État. Je ne me réfère évidemment pas ici aux émeutes au sens littéral, mais à ce que j’appellerai les « miroirs des horreurs », c’est-à-dire ces institutions développées et soutenues par les élites en vue de renforcer le sentiment que toute forme de prise de décision par le peuple serait vouée à la violence, au chaos et l’arbitraire congénital de la populace. Je soupçonne d’ailleurs que de telles institutions sont le lot commun des régimes autoritaires.
les procédures propres à l’agora athénienne avaient pour but de maximiser la dignité du démos et la sagesse de ses délibérations – en dépit de formes de coercition cachées qui pouvaient parfois aboutir à des décisions terrifiantes et sanguinaires –, le cirque romain en était le parfait contraire. Il ressemblait bien davantage à des lynchages périodiques et sponsorisés par l’État.
p.58 Ce n’est que lorsque le terme de démocratie put être presque totalement transformé de manière à incorporer le principe de la représentation* qu’il a été réhabilité aux yeux des théoriciens politiques de bonne naissance et a pris le sens qu’il a aujourd’hui.
(*) Un terme qui lui aussi a une histoire très curieuse. Comme aimait à le rappeler Cornelius Castoriadis, ce terme désignait à l’origine les représentants du peuple devant le roi – les ambassadeurs en fait – et non ceux qui exerçaient eux-mêmes un quelconque pouvoir.
p.58 Dans presque tous les cas, les pères fondateurs de ce que l’on considère aujourd’hui comme les premières Constitutions démocratiques en Angleterre, en France et aux États-Unis, refusaient catégoriquement que l’on considère qu’ils s’efforçaient d’introduire la « démocratie » dans leurs pays.
p.59 « les fondateurs des systèmes électoraux modernes aux États-Unis et en France étaient ouvertement opposés à la démocratie. Cette hostilité à la démocratie peut en partie être expliquée par leur vaste connaissance des textes littéraires, philosophiques et historiques de l’Antiquité grécoromaine. Au regard de l’histoire politique, il était courant chez ceux-ci de se considérer comme les héritiers directs de la civilisation classique et de penser qu’au cours de l’histoire, d’Athènes et Rome jusqu’à Boston et Paris, les mêmes forces politiques se sont confrontées dans des luttes sans fin. Les fondateurs se rangeaient du côté des forces républicaines contre les forces aristocratiques et démocratiques. Et la république romaine constituait, tant pour les Américains que pour les Français, le modèle politique, alors que la démocratie athénienne était au contraire un contre-modèle méprisé » [Dupuis-Deri, 2004, p. 120].
p.59 L’idéal de la république romaine était inscrit dans le système de gouvernement américain ; les fondateurs s’étaient en effet efforcés d’imiter la « Constitution mixte » de Rome, en équilibrant éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. John Adams, par exemple, affirmait dans sa Defense of the Constitution (1797) qu’aucune société parfaitement égalitaire ne saurait exister ; que toute société humaine doit avoir un chef suprême, une aristocratie (basée sur la richesse ou fondée sur la vertu, comme « aristocratie naturelle ») et un public. Et pour lui, la Constitution romaine était la plus parfaite dans sa capacité à équilibrer les pouvoirs de chacun. La Constitution américaine était censée reproduire cet équilibre en mettant en place une présidence puissante, un sénat représentant les plus riches et une chambre des représentants chargée elle de représenter le peuple – les pouvoirs de celui-ci étaient en fait limité au contrôle populaire de l’affectation des impôts. Cet idéal républicain est au coeur de toutes les Constitutions « démocratiques » et, aujourd’hui encore, de nombreux conservateurs aiment à rappeler que l’« Amérique n’est pas une démocratie, mais une république ».
p.59-60 comme John Markoff [1999, p. 661] l’a souligné, « ceux qui se nommaient eux-mêmes démocrates à la fin du XVIIIe siècle se montraient très méfiants à l’égard des parlements, ouvertement hostiles aux partis politiques et critiques envers le secret du vote ; ils ne manifestaient aucun intérêt pour le droit de vote des femmes, parfois même ils s’y opposaient, et faisaient preuve d’une certaine indulgence face à l’esclavage ». Tout cela n’est, une fois de plus, guère surprenant de la part de ceux qui voulaient renouer avec la démocratie athénienne.
p.60 À partir des années 1820, celle-ci commença à ne plus être représentée sous la forme d’un cauchemar manifestant la violence propre à la psychologie des foules, mais comme l’incarnation d’un noble idéal de la participation publique [Saxonhouse, 1993]. Néanmoins, cela ne signifie pas que tout le monde, à ce moment-là, souscrivait au style de démocratie directe propre à Athènes, même au niveau local (c’est en fait bien pour cela que la réhabilitation d’Athènes fut possible). La plupart des hommes politiques ne faisaient en définitive que substituer un terme à un autre, « démocratie » au lieu de « république », sans en changer la signification.
p.63 Après la grande révolte de 1857 en Inde, l’Angleterre commença à employer la même stratégie dans ses propres colonies, soutenant consciencieusement « les grands propriétaires terriens et les petits roitelets au sein de l’Empire indien » . Tout cela était conforté, d’un point de vue intellectuel, par le développement au même moment des théories orientalistes qui affirmaient qu’en Asie, de tels régimes autoritaires étaient inévitables et les mouvements démocratiques non naturels ou inexistants11. « En résumé, la thèse de Huntington selon laquelle la civilisation occidentale aurait elle seule porté l’héritage du libéralisme, du constitutionnalisme, des droits de l’homme, de l’égalité, de la liberté, du respect du droit, de la démocratie, du libre marché et d’autres idéaux séduisants – tous ces nobles idéaux dont on dit qu’ils n’ont imprégné que de façon superficielle les autres civilisations – sonne faux aux oreilles de tous les familiers de l’histoire de l’Orient à l’âge des États-nations. Dans cette longue liste d’idéaux, il est difficile d’en trouver un seul qui n’ait pas été renié en tout ou partie par les autorités dirigeantes occidentales de l’époque dans leurs relations soit avec les peuples qu’elles soumettaient à la domination coloniale, soit avec les gouvernements sur lesquels elles tentaient d’établir leur suzeraineté. Et à l’inverse, il est tout aussi difficile d’en trouver un seul qui n’ait pas été défendu par les mouvements de libération nationale dans leur lutte contre les autorités occidentales. En défendant ces idéaux, les peuples non occidentaux mêlaient néanmoins ceux-ci avec ceux qui provenaient de leur propres civilisations dans des domaines où ils n’avaient que peu à apprendre de l’Occident » .
p.65 [C'est] cet enthousiasme populaire pour les idées de liberté et de souveraineté populaire qui a contraint les hommes politiques à adopter ce terme.
p.65 Dans les années quatre-vingt, deux historiens hétérodoxes américains [Johansen, 1982 ; Grinde, Johansen, 1990] ont rédigé des ouvrages dans lesquels ils suggéraient que certains éléments de la Constitution américaine – en particulier sa structure fédérale – avaient été inspirés en partie par la Ligue des six nations iroquoises et, plus généralement, que ce que nous considérons aujourd’hui comme l’esprit démocratique américain était redevable de l’exemple des Amérindiens. Certaines des preuves accumulées par Johansen étaient très convaincantes. L’idée de former une fédération des colonies fut de fait suggérée durant les négociations du traité de Lancaster en 1744 par Canasatego, un ambassadeur Onondaga, épuisé d’avoir à négocier avec autant de colonies distinctes. On trouve d’ailleurs toujours l’image qu’il employait pour représenter la force de l’union, un faisceau de treize flèches, sur le sceau de l’Union des États unis.
p.66 les valeurs d’égalité et de liberté individuelle si prégnantes dans les sociétés des régions forestières de l’Est ont constitué une source d’inspiration encore plus importante pour les notions d’égalité et de liberté défendues par les révolutionnaires américains dans leur lutte contre la Couronne britannique. Lorsque les patriotes de Boston déclenchèrent leur révolution en se déguisant en Indiens Mohawks et en jetant des ballots de thé anglais par-dessus bord, ils exprimaient très clairement ce qui leur servait comme modèle de la liberté individuelle.
p.66 les hommes politiques des colonies, lorsqu’ils discutaient des origines de leurs idéaux, se référaient inlassablement aux exemples antiques, bibliques ou européens : le Livre des Juges, la Ligue achéenne, la Confédération helvétique, les Provinces unies des Pays-Bas.
p.67 la Ligue – fonctionnant au consensus et accordant une place importante aux femmes – n’aurait raisonnablement pas pu inspirer un système américain qui, lui, avait recours au système majoritaire et n’accordait le droit de vote qu’aux hommes
les fondateurs s’identifiaient effectivement à la tradition classique, et c’est justement pour cette raison qu’ils étaient hostiles à la démocratie. Ils identifiaient la démocratie à l’égalité, à une liberté sans entraves, et dans la mesure où ils avaient une quelconque connaissance des coutumes indiennes, c’est précisément pour cette raison qu’ils les réprouvaient.
les Indiens ressemblaient aux anciens Germains en raison du fait que « le principe démocratique était en particulier si affirmé que la souveraineté effective résidait dans le corps du peuple »
p.68 Madison, et même Jefferson, avaient tendance à décrire les Indiens à la manière de John Locke, comme des exemples uniques de sociétés où la liberté n’est soumise ou limitée par aucun pouvoir étatique ou aucune forme systématique de coercition – une situation rendue possible du fait que les sociétés indiennes ne connaissaient aucune division significative de la propriété.
les rédacteurs des Constitutions furent pour la plupart des propriétaires fonciers, mais surtout, bien peu d’entre eux avaient eu l’occasion de se retrouver à discuter avec un groupe d’égaux – du moins jusqu’à ce qu’ils en viennent à siéger dans les parlements des colonies.
« Où et quand la démocratie fut-elle inventée ? » :
« Que le pouvoir politique puisse dériver du consentement des gouvernés plutôt que d’être octroyé par une autorité supérieure, pourrait bien avoir été une expérience des équipages de pirates à l’origine du monde atlantique moderne. Ces équipages non seulement élisaient leurs capitaines, mais étaient tout à fait familiers des mécanismes de contre-pouvoir (sous la forme des quartiers-maîtres et des conseils de navire) et des relations contractuelles entre les individus et les groupes (sous la forme d’articles consignés par écrit, spécifiant la part de butin accordée à chacun et le montant des indemnités en cas d’accident de travail) » [Markoff, 1999, p. 673, note 62].
p.69 l’organisation typique au xviiie siècle du bateau de pirates telle qu’elle a été reconstruite par des historiens comme Marcus Rediker [2004, p. 60-82] semble avoir été remarquablement démocratique. Les capitaines n’étaient pas seulement élus, ils opéraient habituellement comme les chefs de guerre amérindiens : un pouvoir absolu leur était confié pendant les poursuites ou les combats, mais sinon, ils étaient traités comme de simple hommes d’équipage. Même quand, sur certains bateaux, les capitaines se voyaient accorder des pouvoirs plus importants, l’accent était mis sur le droit de l’équipage à les démettre à tout moment – pour lâcheté, cruauté ou pour toute autre raison. Dans tous les cas, le pouvoir ultime reposait sur l’assemblée générale, qui tranchait souvent même sur les questions les plus mineures, et cela toujours, semble-t-il, par un vote majoritaire à main levée.
La composition des équipages était souvent extraordinairement hétérogène. « L’équipage du Black Sam Bellamy de 1717 était un “mélange hétéroclite de tous les pays”, composé d’Anglais, de Français, de Hollandais, d’Espagnols, de Suédois, d’Amérindiens, d’Afro-Américains et d’une vingtaine d’Africains qui avaient été libérés d’un bateau d’esclaves » [Rediker, 2004, p. 53]. En d’autres termes, nous avons affaire ici à un ensemble de personnes dont il est probable qu’elles avaient toutes une connaissance de première main d’une vaste palette de procédures de démocratie directe – depuis les things14 suédois aux assemblées de village africaines et aux conseils amérindiens, à partir desquels la Ligue des six nations s’est développée – et qui se trouvaient d’un seul coup devant la nécessité d’improviser une forme d’autogouvernement face à l’absence complète de tout État. Et de fait, il n’y avait guère de lieu plus propice au développement de nouvelles institutions démocratiques dans le monde atlantique à ce moment…
p.70 quel point était vivace et constante cette peur des dirigeants des communautés coloniales et des unités militaires que leurs subordonnés n’adoptent cette égalité et cette liberté individuelle propres aux Indiens.[...]
p.70-71 Cela était avant tout vrai des communautés constituées souvent d’esclaves en fuite et de domestiques qui « devenaient Indiens » en l’absence de contrôle des gouvernements coloniaux [Sakolsky, Koehnline, 1993], ou d’enclaves formées par ce que Linebaugh et Rediker [1991] ont appelé le « prolétariat atlantique » – cet ensemble bigarré d’anciens esclaves, de marins, de prostituées, de renégats, d’antinomiens et de rebelles –, qui se développait dans les villes portuaires du monde de l’Atlantique Nord avant l’émergence du racisme moderne et dont provient une part importante de l’impulsion démocratique de la révolution – américaine notamment.
p.71 Les colons qui débarquaient en Amérique se trouvaient en effet dans une situation tout à fait singulière : ayant fui la hiérarchie et le conformisme européens, ils se trouvaient face à des populations indigènes bien plus attachées aux principes d’égalité et d’individualisme qu’ils n’auraient pu l’imaginer ; et tout en contribuant massivement à leur extermination, ils n’en adoptèrent pas moins bon nombre de leurs coutumes, habitudes et attitudes.
Nous avons ainsi une succession graduée d’espaces ouverts à l’improvisation démocratique, des communautés puritaines de la Nouvelle-Angleterre, avec leur conseils municipaux, aux communautés des frontières, jusqu’aux Iroquois eux-mêmes.
p.72 les pratiques démocratiques, qu’on les définisse comme des procédures de décision égalitaires ou comme un mode de gouvernement par la discussion publique, tendent à émerger dans des situations où des communautés règlent leurs propres affaires hors de la portée de l’État. L’absence du pouvoir d’État signifie l’absence de tout mécanisme systématique de coercition pour mettre en application les décisions. Ce qui tend à aboutir soit à une certaine forme de processus consensuel, soit, dans le cas de formations essentiellement militaires telles que les hoplites grecs ou les bateaux de pirates, à un système de vote majoritaire. Les innovations démocratiques – et l’apparition de ce qui pourrait être appelé les valeurs démocratiques – ont tendance à émerger de ce que j’ai nommé « les zones d’improvisation culturelle », des espaces en général placés hors du contrôle des États et dans lesquels des personnes nourries de traditions et d’expériences différentes sont obligées d’imaginer des moyens pour régler leur vie commune. Les communautés des frontières à Madagascar ou dans l’Islande médiévale, les bateaux de pirates, les communautés de commerçants de l’océan Indien, les confédérations amérindiennes durant l’âge d’or de l’expansion européenne en constituent quelques exemples. Tout cela a bien peu à voir avec les grandes traditions littéraires et philosophiques considérées comme les piliers des grandes civilisations. De fait, à de rares exceptions près, ces traditions sont ouvertement hostiles aux procédures démocratiques et à ceux qui y ont recours16. Les élites gouvernantes ont, du même coup, eu tendance à ignorer ces formes ou à essayer de les éradiquer.
[...] création de systèmes représentatifs, sur le modèle de la république romaine. Enfin, sous la pression populaire, ces systèmes représentatifs furent plus tard renommés « démocraties », dont le modèle originel aurait été le modèle athénien.
p.73 Les historiens, qui s’appuient presque exclusivement sur des textes et s’enorgueillissent de n’employer que des dispositifs de preuve irréfutables, en concluent souvent – comme ils l’ont fait avec la théorie de l’influence iroquoise – qu’il est de leur responsabilité professionnelle de travailler comme si les nouvelles idées émergeaient de l’intérieur des traditions textuelles.
William Pietz [1985, 1987, 1988] décrit la vie des enclaves côtières où Vénitiens, Hollandais, Portugais et toutes sortes de marchands et d’aventuriers européens cohabitaient avec des marchands et des aventuriers africains, où des dizaines de langues différentes étaient parlées et où se mêlaient islam, catholicisme, protestantisme et religions ancestrales. Le commerce, dans ces enclaves, était régulé par ce que les Européens appelaient des « fétiches ».
p.73-74 les relations sociales se créent lorsqu’un groupe d’hommes s’entend pour instituer un pouvoir souverain habilité à recourir à la violence si les droits de propriété et les obligations contractuelles ne sont pas respectés.
p.74 La Chine et l’État-nation européen. –
Au début de la période moderne, les élites européennes conçurent progressivement un certain idéal de gouvernement, régissant une population homogène, parlant une même langue, soumise à un système juridique et administratif uniforme, ce système devant, éventuellement, être pris en charge par une élite méritocratique dont la formation devait principalement reposer sur l’étude de la littérature classique dans la langue vernaculaire du pays en question. Ce qui est étrange, c’est que l’on ne trouve aucun précédent à ce modèle d’État dans l’histoire européenne, alors qu’il correspond presque trait pour trait au système que les Européens croyaient avoir inspiré (et qu’ils ont dans une large mesure effectivement inspiré) à la Chine impériale17. Y a-t-il une quelconque preuve qui permettrait de soutenir une « théorie de l’influence chinoise » ? Dans ce cas, il y en a au moins une, même si elle peut paraître assez ténue. Le prestige du gouvernement chinois étant évidemment bien plus grand, auprès des philosophes européens, que celui des marchands africains, de telles influences ne pouvaient pas être totalement ignorées. De la fameuse remarque de Leibniz – selon laquelle ce sont les Chinois qui devraient envoyer leurs missionnaires en Europe et non l’inverse – aux œuvres de Montesquieu ou de Voltaire, on voit se succéder les philosophies politiques exaltant les institutions chinoises – en même temps d’ailleurs qu’une fascination populaire pour l’art, les jardins, le style vestimentaire et la philosophie morale des Chinois se fait jour –, et cela au moment même où l’absolutisme prend forme en Europe. Tout cela ne prendra fin qu’au XIXe siècle, lorsque la Chine sera victime de l’expansion impériale de l’Europe.
p.75 les puissances atlantiques se trouvaient au centre de vastes empires internationaux et d’un brassage permanent de savoirs et d’influences réciproques.
Ce n’est aussi qu’au milieu du xixe siècle – juste au moment où les puissances européennes commençaient à récupérer la notion de démocratie au sein de leur propre tradition – que l’Angleterre entreprit de mener une politique systématique de répression de tous les mouvements populaires qui, outre-mer, pouvaient présenter des potentialités démocratiques.
Comme Steve Muhlenberger et Phil Payne [1993 ; Baechler, 1985] l’ont montré, si on la définit simplement comme une modalité de la prise de décision à l’issue d’une discussion publique, la démocratie constitue un phénomène très courant.
Les historiens grecs qui écrivaient sur l’Inde, par exemple, reconnaissaient que nombre de communautés pouvaient légitimement être qualifiées de démocratiques.
p.75-76 Entre 1911 et 1918, de nombreux historiens indiens (K. P. Jayaswal D. R. Bhandarkar, R. C. Majumdar18) se plongèrent dans l’examen de certaines de ces sources, non seulement les récits grecs des campagnes d’Alexandre mais aussi des documents en pali datant des débuts du bouddhisme, le vocabulaire hindi ancien ainsi que des oeuvres de théorie politique. Ils découvrirent ainsi des dizaines de cas comparables à l’Athènes du ve siècle sur le sol de l’Asie du Sud : des villes et des confédérations politiques dans lesquelles tous les hommes, formellement qualifiés de guerriers – soit le plus souvent une très large proportion de la population masculine adulte –, disposaient du pouvoir de prendre d’importantes décisions collectivement, à travers une délibération publique au sein d’assemblées communautaires.
[...] qu’il s’agisse du gouvernement des monastères bouddhistes ou de celui des communautés de métier. Ces auteurs étaient donc en mesure d’affirmer que la tradition indienne, ou même hindoue, avait toujours été intrinsèquement démocratique. Et c’était là un argument puissant pour tous ceux qui luttaient pour l’indépendance.
p.76 le bouddhisme leur était favorable, tout particulièrement en la personne de Bouddha lui-même. La tradition brahmanique leur est, elle, systématiquement hostile. Certains des tout premiers tracts politiques en Inde contiennent des conseils adressés aux rois sur la manière d’endiguer le développement des institutions démocratiques, voire de les supprimer.
p.76-77 Ce qui importe, c’est que dans tous les cas, nous avons affaire à une élite politique – effective ou en puissance – qui s’identifie à une tradition de démocratie pour légitimer des formes essentiellement républicaines de gouvernement.
p.77 la cristallisation de pratiques démocratiques très anciennes dans la formation d’un système global au sein duquel les idéaux allaient et venaient dans toutes les directions, et l’adoption progressive – le plus souvent à contrecœur – de certaines d’entre elles par les élites.
L’argument général, dégagé par l’archéologue K. C. Chang, est le suivant : la civilisation de la Chine ancienne était fondée sur une idéologie complètement différente de celle de l’Égypte ou de la Mésopotamie. Il s’agissait essentiellement d’un prolongement de la cosmologie des premières sociétés de chasseurs, où le monarque remplaçait le shaman dans sa relation personnelle et exclusive avec les pouvoirs divins. Il en résulta une autorité absolue de celui-ci. Chang [2000, p. 7]
Le type d’État qui a émergé au troisième millénaire au Moyen-Orient incarne, par contraste, une sorte de rupture avec un autre modèle, davantage pluraliste, qui prit naissance lorsque les dieux et leurs prêtres en vinrent à être considérés comme indépendants de l’État.
p.77-78 C. C. Lamberg-Karlovsky [2000] affirme que la clé se trouverait dans la première apparition des notions de liberté et d’égalité dans la Mésopotamie ancienne, dans les doctrines monarchiques qui établissaient qu’un contrat social liait les autorités dirigeantes des cités-États et leurs sujets. C’est en ces termes que devrait être définie cette « rupture », et la plupart des contributeurs de cet ouvrage s’accordent à considérer qu’elle « ouvrait la voie à la démocratie occidentale » [Larsen, 2000, p. 122].
p.78 d’une conception occidentale de l’organisation sociale dans laquelle la souveraineté devait reposer non pas sur l’autorité du chef mais sur celle du conseil des anciens et l’assemblées des hommes en armes » [p. 59]. Gordon Willey [2000, p. 29], pour sa part, considère que le mouvement démocratique résulte du libre marché, dont il pense qu’il était plus développé en Mésopotamie qu’en Chine – et largement absent dans les royaumes mayas au sein desquels les autorités gouvernaient selon les principes du droit divin – et qu’« il n’y a aucune preuve d’un quelconque contre-pouvoir au sein de la chefferie ou de l’État * ».
(*) Il est tentant de suggérer que tout cela nous laisse le choix entre deux théories alternatives des origines de ce que Huntington nomme la « civilisation occidentale » : néolibérale ou crypto-fasciste. Mais ce serait injuste. Ces auteurs s’intéressent à un espace très large qui, plus tard, inclura l’Islam comme partie constitutive de ce bloc « occidental » dans lequel ils trouvent l’origine des idées occidentales de liberté (en fait, il est difficile de faire autrement dans la mesure où l’on ne sait presque rien de ce qui s’est passé en Europe à cette époque). La contribution vraisemblablement la plus marquante est celle de Gregory Possehl sur la civilisation harappéenne, la première civilisation urbaine de l’Inde, qui, au regard de ce que l’on peut en savoir aujourd’hui, semble n’avoir connu ni royauté ni État centralisé d’aucune sorte. La question est alors de savoir ce que cela nous dit sur l’existence de « démocraties » ou de « républiques » dans l’Inde ancienne. Serait-il possible, par exemple, que l’histoire des deux premiers millénaires de l’Asie du Sud soit celle de l’érosion progressive de formes politiques égalitaires ?
p.78 les « peuples celtes et germains primitifs » se réunissaient en assemblées
p.79 la civilisation maya classique est caractérisée par son absence de toute forme de « contre-pouvoir » (Willey décrit même les sanguinaires Aztèques comme moins autoritaires, en raison des formes de marché plus avancées qu’ils avaient développées), aucun de ces auteurs ne semble se demander à quoi ressembleraient la Rome antique ou l’Angleterre médiévale si elles étaient étudiées exclusivement à partir de bâtiments en ruines et de textes officiels gravés dans la pierre par le pouvoir… Si mon argument est juste, alors on peut dire que ce que font en fait ces auteurs, c’est de chercher les origines de la démocratie précisément là où ils ont le moins de chance de les trouver : dans les proclamations officielles d’États qui ont largement mis fin aux formes locales d’autogouvernement et de délibération collective, et dans les traditions littéraires et philosophiques qui leur en ont fourni la justification
p.79-80 la vague actuelle des mouvements altermondialistes luttant pour une justice mondiale a été en grande partie initiée par l’AZLN, l’Armée zapatiste de libération nationale, un groupe principalement composé de rebelles des Chiapas de langue maya, pour la plupart des campesinos qui ont formé de nouvelles communautés dans la forêt du Lacandon. Leur insurrection en 1994 a été explicitement menée au nom de la démocratie, terme par lequel ils désignaient quelque chose qui ressemblait bien plus au style athénien de la démocratie directe qu’aux formes républicaines de gouvernement qui se sont depuis approprié le mot. Les zapatistes ont développé un système très élaboré d’assemblées communautaires opérant par voie de consensus, complétées par des comités de femmes et de jeunes – afin de contrebalancer la domination traditionnelle des adultes mâles – et des conseils formés de délégués révocables. Ils affirment que ce système repose sur une radicalisation de la façon dont les communautés mayas se sont gouvernées pendant des millénaires. Nous savons que la plupart des communautés mayas des montagnes se sont gouvernées au moyen de certaines formes de système consensuel.
p.80 La crise de l’État
[...] les zapatistes n’ont rien de si insolite. Ils parlent tous une grande variété de langues mayas – tzeltal, tojalobal, ch’ol, tzotzil, mam –, proviennent de communautés qu’on a laissées traditionnellement se gouverner de façon autonome (notamment pour qu’elles puissent constituer des réserves de main-d’oeuvre indigène pour les ranchs et les plantations éloignées) et ont formé de nouvelles communautés, en grande partie multiethniques, sur de nouvelles terres dans le Lacandon [Collier, 1999 ; Ross, 2000 ; Rus, Hernandez, Mattiace, 2003]. En d’autres termes, ces communautés constituent un exemple classique de ce que j’ai appelé « des zones d’improvisation démocratique », soit des espaces composés d’un amalgame bigarré de peuples dont la plupart d’entre eux ont fait historiquement l’expérience de méthodes d’autogouvernement démocratique, et placés hors du contrôle immédiat de l’État.
p.81 d’un réseau international (People’s Global Action), basé sur les principes d’autonomie, d’horizontalité et de démocratie directe et composé de groupes aussi disparates que le mouvement des sans-terre brésilien (MST), l’association des paysans de l’État du Karnataka (Karnataka State Farmer’s Association, un groupe socialiste d’action directe indien se réclamant de Ghandi), le syndicat des postiers canadiens (the Canadian Postal Workers’Union) et de tout un ensemble de collectifs anarchistes d’Europe et du continent américain, ainsi que d’organisations indigènes du monde entier.
les principes du zapatisme – le rejet de l’avant-garde, la priorité accordée à la mise en oeuvre d’alternatives viables au sein de sa propre communauté comme moyen de subvertir la logique du capital mondial – ont eu une énorme influence sur des militants de mouvements sociaux qui ne connaissaient que très vaguement les zapatistes et n’avaient sûrement jamais entendu parler du PGA.
« Les zapatistes ont employé le terme de démocratie, mais dans un sens différent de celui du gouvernement mexicain. La démocratie pour les zapatistes n’est pas conceptualisée dans les termes de la philosophie politique européenne, mais dans ceux du mode d’organisation social maya, basé sur la réciprocité, les valeurs communautaires (et non individualistes), la valorisation de la sagesse plutôt que de l’épistémologie, etc. [...] les conceptions libérales de la démocratie et celles, indigènes, de la réciprocité et de l’organisation de la communauté en vue du bien commun peuvent entrer en dialogue » [Mignolo, 2002, p. 180].
p.82 affirmer que « les zapatistes n’ont pas d’autre choix que d’employer ce terme » de démocratie est tout simplement erroné. Ils ont à l’évidence le choix. D’autres groupes d’origine indigène en ont fait de fort différents. Le mouvement Aymara en Bolivie, pour choisir un exemple parmi d’autres, a, lui, choisi de rejeter totalement le mot « démocratie » au motif qu’au regard de l’expérience de son peuple, ce mot a été uniquement employé pour désigner des systèmes qui lui ont été imposés par la violence22. Ses membres considèrent donc leurs propres traditions de prise de décision égalitaire comme étrangères à la démocratie.
p.82-83 le « terme que l’hégémonie politique leur impose » est, dans ce cas, lui-même le fruit d’un compromis en tension. S’il ne l’était pas, nous ne pourrions disposer d’un terme grec forgé à l’origine pour décrire une forme d’autogouvernement communautaire et appliqué par la suite à des républiques basées sur le système représentatif.
p.83 Durant les deux derniers siècles, les démocrates ont tenté de greffer les idéaux du gouvernement direct du peuple sur l’appareil coercitif de l’État. Au final, ce projet s’est révélé tout simplement impossible. Les États, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être véritablement démocratisés. Ils ne sont rien d’autre que des moyens de réguler la violence. Les fédéralistes américains étaient très réalistes quand ils affirmaient que la démocratie ne convient pas à une société fondée sur des inégalités de richesse, dans la mesure où un appareil de coercition est nécessaire pour protéger les richesses et pour tenir en respect cette « populace » à laquelle la démocratie prétend donner le pouvoir.
Athènes fut un cas unique à cet égard, parce qu’elle représenta en fait un moment de transition. Il y avait certainement des inégalités de richesse et même, vraisemblablement, une classe dirigeante, mais il n’y avait pas d’appareil de coercition institutionnalisé. C’est la raison pour laquelle les historiens ne s’accordent pas sur la question de savoir s’il s’agissait véritablement d’un État.
C’est précisément lorsque l’on prend en considération la question du monopole de la force par l’État moderne que les prétentions de la démocratie se révèlent être un fatras de contradictions.
p.84 Ce n’est pas un hasard si les États-Unis, un pays qui s’enorgueillit toujours de son esprit démocratique, ont pu prétendre diriger le monde en mythifiant, voire en déifiant leur police.
Francis Dupuis-Deri [2002] a forgé le terme d’« agoraphobie politique » pour désigner cette suspicion à l’égard des formes de prise de décision et de délibération publique qui traversent la tradition occidentale, notamment dans les oeuvres de Constant, Sieyès ou Madison, ainsi que dans celles de Platon ou d’Aristote.
Ce n’est en effet que lorsqu’il devient absolument clair que les discussions et les réunions publiques ne sont plus elles-mêmes les médiums de la prise de décision politique, mais, au mieux, des moyens de la soumettre à la critique, de l’influencer ou de faire des suggestions aux décideurs politiques, qu’elles peuvent être considérées comme sacro-saintes. Ce qui est plus grave, c’est que cette agoraphobie n’est pas seulement partagée par les hommes politiques et les journalistes professionnels, mais aussi, et dans une large mesure, par le public lui-même.
Le phénomène du « miroir des horreurs », par lequel les élites gouvernantes encouragent des formes de participation populaire propres à rappeler sans cesse au public combien il est incapable de gouverner, semble dans de nombreux États modernes avoir atteint un état de perfection sans précédent.
p.84-85 Walter Benjamin [1978] la résume avec élégance en soulignant que tout ordre juridique qui revendique le monopole du recours à la violence doit être fondé sur un pouvoir autre que lui-même, ce qui veut dire qu’il doit inévitablement être fondé sur des actes illégaux au regard du système juridique antérieur. La légitimité d’un système juridique repose donc nécessairement sur des actes de violence criminelle. Selon le droit sous la juridiction duquel ils étaient encore placés, les révolutionnaires américains et français furent bien après tout coupables de haute trahison.
p.85 Autant la solution de droite – selon laquelle seuls des leaders inspirés incarnant la volonté du peuple, qu’il s’agisse de pères fondateurs ou de Führer, peuvent instituer ou mettre un terme aux ordres constitutionnels – que la solution de gauche – selon laquelle ces ordres ne gagnent leur légitimité qu’en vertu de révolutions populaires le plus souvent violentes – conduisent à des contradictions pratiques sans fin. De fait, comme le sociologue Michael Mann le suggère à mots couverts [1999], bon nombre des massacres du xxe siècle dérivent de l’une ou l’autre des versions de cette contradiction. L’exigence simultanée de créer un appareil de coercition uniforme sur toute l’étendue de la planète et de maintenir la prétention de cet appareil à recevoir sa légitimité du « peuple » a conduit à un besoin constant de définir qui est précisément supposé être ce « peuple » : « Dans tous les tribunaux allemands des quatre-vingt dernières années – de la République de Weimar, du régime nazi, de la RDA à la République fédérale –, les juges ont toujours eu recours à la même formule : “In Namen des Volkes”, “au nom du peuple”. Les tribunaux américains préfèrent la formule : “L’affaire du peuple contre X” » [Mann, 1999, p. 19]. En d’autres termes, le « peuple » doit être invoqué en tant qu’autorité propre à autoriser le recours à la violence, en dépit du fait que toute proposition de démocratisation de ces dispositifs coercitifs a toutes les chances d’être considérée avec horreur par les personnes concernées. Mann suggère que les tentatives mises en oeuvre pour dépasser cette contradiction, pour recourir aux appareils coercitifs afin d’identifier et de constituer un « peuple » dont les responsables de ces appareils se vantent qu’il soit à l’origine de leur autorité, ont été responsables d’au moins soixante millions de morts au cours du seul xxe siècle. C’est dans un tel contexte que j’aimerais suggérer que la solution anarchiste – selon laquelle il n’y a pas de véritable solution à ce paradoxe – est loin d’être déraisonnable. L’État démocratique a toujours constitué une contradiction.
p.85-86 Le processus de globalisation a simplement mis en lumière quels en étaient les soubassements les plus douteux en suscitant le besoin de structures de prise de décision à une échelle planétaire, là où justement toute tentative de maintenir les prétentions de la souveraineté populaire – et ne parlons pas de la participation – serait à l’évidence absurde. La solution néolibérale consiste naturellement à affirmer que le marché constitue la seule forme de délibération publique véritablement nécessaire, et à réduire peu ou prou le rôle de l’État à sa fonction coercitive. Dans un tel contexte, la réponse zapatiste – abandonner l’idée que la révolution suppose la prise de contrôle de l’appareil de coercition de l’État et lui substituer le projet d’une refondation de la démocratie par l’auto-organisation de communautés autonomes – ne manque pas de pertinence. C’est la raison pour laquelle une obscure insurrection dans le sud du Mexique a pu provoquer un tel émoi, tout d’abord dans les cercles radicaux. La démocratie semble ainsi retourner aux lieux de sa naissance : les espaces interstitiels. La question de savoir si elle peut aujourd’hui s’étendre au monde entier sous cette forme relève désormais d’une décision qui n’est pas celle des chercheurs, mais repose au bout du compte sur notre capacité d’action en tant que citoyens (au plan local et au plan global).










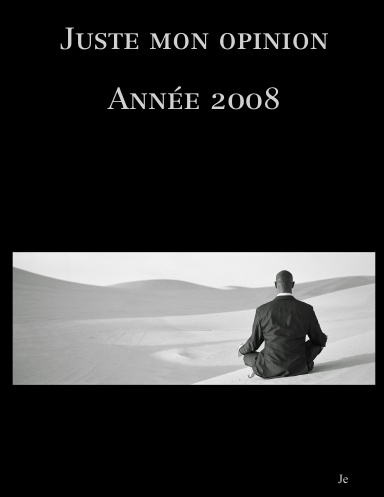
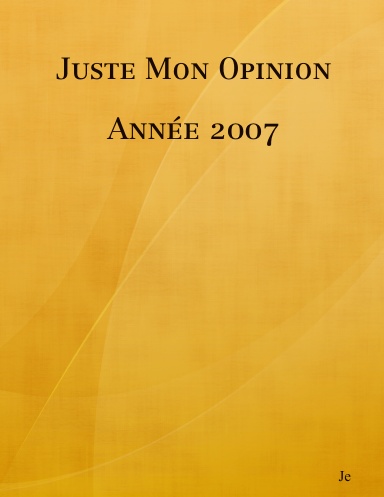

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire