Source : https://youtu.be/cTVTk9Q-Ljg
Frédéric Lordon, La malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Paris, Les liens qui libèrent, 2014, 304 p., 20,50 €.
Un
spectre hante l’Europe : le spectre de la déflation salariale
généralisée. Cette situation est ainsi le produit des politiques
d’austérité développées à la suite du sauvetage des banques
(indispensable mais réalisé sans aucune contrepartie) par les États,
suite à la crise de la finance privée advenue en 2008. Face à cette
menace, de quelles marges de manœuvre disposent les institutions
européennes ? À lire Frédéric Lordon, il n’y en a aucune et l’affaire
est entendue pour des raisons qu’il décrit très précisément dans la
première partie intitulée « impasses de l’Europe ». Le cadre néolibéral
de l’Europe actuelle a offert, sur un plateau, une position souveraine à
la finance, au détriment des peuples. Ce cadre dépossède les États de
toute possibilité de mener une véritable politique économique digne de
ce nom, par l’adhésion, via les traités idoines, au dogme de la
limitation des déficits budgétaires et à celui d’une Banque centrale
européenne, dont la mission exclusive consiste à encadrer l’inflation en
dessous du seuil de 2 % par an. Dogmes qui n’ont d’ailleurs pas grand
chose à envier à la planification soviétique. La conclusion de Lordon
est nette : « L’Union n’a pas d’autre politique que constitutionnelle
[…]. Les désastreuses politiques d’austérité présentes ne sont en rien
l’effet de quelque “décision conjoncturelle” que ce soit. Elles sont les
résultats du fonctionnement mécanique des dispositions du traité de
l’UE et du pacte de stabilité » (p. 43). Dans le second chapitre, Lordon
montre que ce cadre néolibéral a été conforté sous Sarkozy par le « two pack » et le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) voté sous Hollande.
Enfin, selon Lordon, on ne peut comprendre cette obstination de
l’Europe néolibérale à persister dans son être, sans mettre en évidence
la position dominante qu’occupe l’Allemagne dans la détermination de la
politique monétaire menée par la Banque centrale européenne, dont
« l’indépendance », apparaît clairement mise en cause par la volonté
d’une majorité d’Allemands de faire imposer, par la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe, l’arrêt du programme de rachat de dettes
souveraines mis en œuvre en septembre 2012.
Lordon en tire une conclusion implacable : « ce qui compte avant tout
n’est donc pas que la banque centrale soit formellement indépendante en
soi, mais qu’elle soit d’abord substantiellement “allemande” puis, mais
secondairement, indépendante s’il y a lieu de protéger sa germanité »
(p. 81).
Pour Lordon, comme pour d’autres économistes réunis par Cédric Durand, il faut donc « en finir avec l’Europe »
(ou plus précisément avec l’Europe dans sa forme « néolibérale »).
S’inspirant de Naomi Klein, Frédéric Lordon indique une voie possible de
« stratégie du choc » pour permettre aux peuples, asservis à la sphère
financière, de reprendre leur destin politique en main. Pour se faire,
Lordon n’y va pas par quatre chemins : il n’y a d’autre option sur la
table que le défaut pur et simple sur le surplus de dette provoqué par
la crise de la finance privée de 2007 : soit 26,4 points de PIB de 2007
à 2012 pour la France, 44,9 points pour l’Espagne, 60,5 points pour le
Portugal, 92,4 points pour l’Irlande, etc.. Surplus de dette et
récession consécutive à un credit crunch sans précédent : le
taux de croissance annuel de l’encours de crédit des sociétés non
financières était d’environ 12 % en septembre 2008 contre 0,5 % en
février 2014 (avec un taux négatif, jamais observé sur la série, de
-2,3 % en janvier 2010). Cette situation entraîne mécaniquement une
violente récession économique et une explosion du chômage à des niveaux
encore jamais atteints. Faire défaut sur la dette publique ré-ouvrirait
(car cette possibilité s’est déjà offerte en 2008) une opportunité de
saisir les banques et de créer un « système socialisé du crédit ». Dans
cette nouvelle configuration du capitalisme, la banque peut enfin être
au service des agents ordinaires et donner réellement corps à l’utopie
de la coopérative bancaire sans succomber aux sirènes des produits
dérivés (comme cela avait été le cas de la « filiale » Natixis, créée en
2006 par les Caisses d’épargne et les Banques populaires).Voilà une
piste qui devrait mériter toute l’attention des partisans d’une « autre
économie », baptisée « sociale et solidaire », si toutefois ils aspirent
sérieusement à incarner une alternative réelle à l’ordre économique
dominant.
Outre
la stratégie du défaut sur la dette souveraine, sortir de la monnaie
unique actuelle (l’euro) constitue l’autre étape indispensable pour
s’émanciper radicalement du cadre néolibéral constitutionnalisé par les
traités. C’est ici tout l’objet du septième chapitre de l’ouvrage, qui
est programmatique et où l’auteur développe les tenants et aboutissants
de ce qui n’est pas qu’un simple mot d’ordre lancé au débotté, mais qui
devrait réellement être pris au sérieux. Ainsi, nous dit Frédéric
Lordon : « le retour au national a pour immense vertu de
“déconstitutionnaliser” le problème, c’est à dire en envoyant promener
les traités, de rapatrier instantanément dans le périmètre de la
délibération démocratique ordinaire les questions stratégiques – banque
centrale, place des marchés de capitaux, formes du financement des
déficits et des dettes – qui en ont été exclues » (p. 148). Le retour au
national, outre qu’il ne doit pas être confondu avec le nationalisme,
est l’étape la plus simple, selon l’auteur, car les institutions de la
délibération politique sont déjà là. Du fait de la position dominante de
l’Allemagne dans l’ordre monétaire européen et de l’opposition de sa
Cour Constitutionnelle du rachat des dettes souveraines par la Banque
centrale européenne, la construction d’un « autre euro » est
structurellement impossible. Il n’y a donc d’autre option que d’en
sortir. L’intérêt immédiat d’une sortie de l’euro serait de restaurer la
possibilité d’ajustement de change en dévaluant une monnaie alors
redevenue nationale. L’auteur précise que les monnaies nationales ne
seront convertibles qu’auprès de la Banque centrale européenne et qu’il
s’agit donc de supprimer, purement et simplement, les intermédiaires
privés du marché des changes dans le but de fonder ces ajustements sur
un accord politique non contraint par la spéculation financière. Le
chapitre se clôt sur une annexe technique décrivant les mécanicismes
d’ajustement de change internes et externes dans le cadre de la
« monnaie commune » (par opposition à la monnaie unique).
La
thèse de Frédéric Lordon est ainsi que la domination allemande de
l’ordre monétaire européen ne laisse aucun espoir quant à la possibilité
de la réformer sous l’effet d’une, aussi soudaine qu’improbable,
conversion des dominants à la vertu. Contrairement à la position
défendue par certains,
la croyance dans une « union politique de l’euro » n’a aucune chance
d’advenir si le cadre actuel est conservé. Une telle obstination de
l’européisme à persister dans son être ne peut, selon l’auteur, que
conduire tout droit à l’austérité généralisée, dont la résurgence de
partis néonazis (comme Aube Doré en Grèce) constitue la traduction
politique. La conclusion de l’ouvrage est d’une lucidité sèche : si nous
laissons à l’extrême droite le monopole de la Nation et de la
souveraineté populaire tout en prétendant maintenir le cadre de la
monnaie unique, nous nous condamnons à l’agonie de la déflation
salariale, soit un contexte de tumultes et de colère particulièrement
défavorable à toute délibération politique rationnelle. Ou bien nous
choisissons d’ouvrir, comme nous y invite l’auteur, une voie de sortie
de la configuration néolibérale du capitalisme, voire une sortie du
capitalisme lui-même, pour les plus friands de rupture radicale. Les
sciences sociales, lorsqu’elles ne s’enferment pas dans une posture de
critique pour la critique, parviennent parfois à faire plus qu’à
éclairer les enjeux (ce qui est déjà très bien). Elles se révèlent
parfois capables de tracer des voies d’émancipation populaire. C’était
le pari de cet ouvrage et il est, selon nous, parfaitement réussi.
Source : https://lectures.revues.org/14465
Présentation de l'éditeur
L’européisme est devenu le pire ennemi de l’Europe. Ne voulant plus que « l’Europe » intransitivement, c’est-à-dire sans le moindre égard pour ses contenus concrets, prêt s’il le faut à martyriser des peuples entiers, en Grèce, au Portugal ou en Espagne, il est devenu une obstination aveugle auquel il est temps de mettre un coup d’arrêt. Au-delà de ses pires désastres économiques, sa tare majeure, et congénitale, est politique : le déni absolu de toute expression des souverainetés populaires. Certains, à gauche, continuent cependant de croire qu’on pourra changer l’euro austéritaire en un euro social. Mais, la crise présente l’a assez démontré, une monnaie unique aimable suppose d’être parachevée par une union politique authentique… que l’européisme présuppose sur le mode de la pure pétition de principe sans jamais vouloir en analyser les exigeantes (et improbables) conditions de possibilité.Aussi bien l’urgence économique et sociale que la disponibilité immédiate des institutions matérielles et symboliques de la souveraineté commandent alors de réexaminer de près l’option des monnaies nationales. Sous deux codicilles cependant : 1) reconstruire les concepts de souveraineté et de nation d’une manière qui les rendent irrécupérables par l’extrême-droite ; 2) réaffirmer que défaire la monnaie européenne, de toute façon aussi mortifère que non-viable, n’exclut nullement de continuer à œuvrer pour l’approfondissement résolu de tous les autres liens entre les peuples européens – et enfin de faire Europe autrement que par l’économie ! –, ni même de penser à refaire un commun monétaire européen, sous la forme non plus d’une monnaie unique mais d’une monnaie commune.










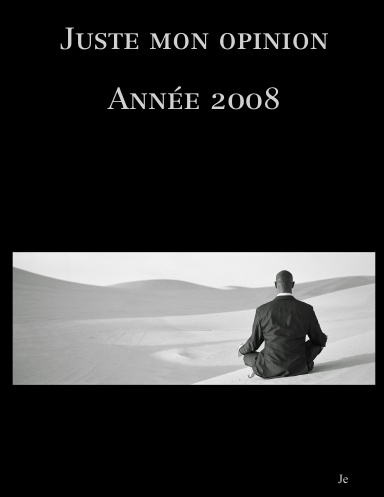
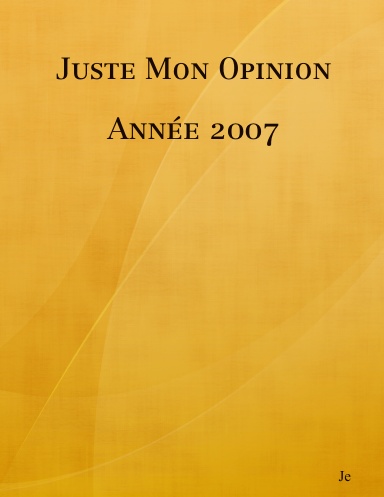

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire